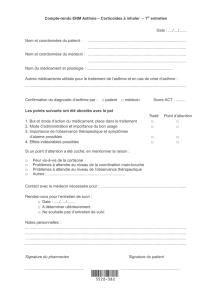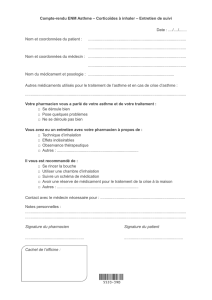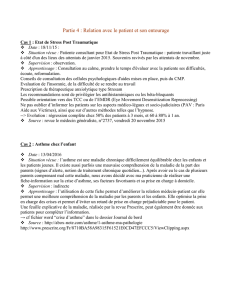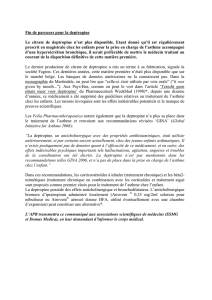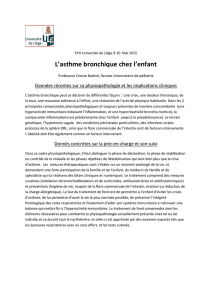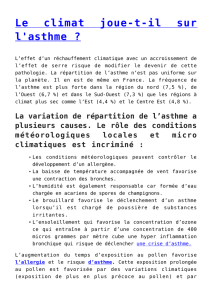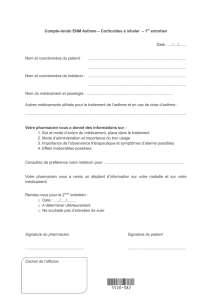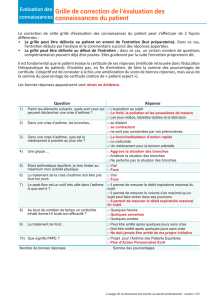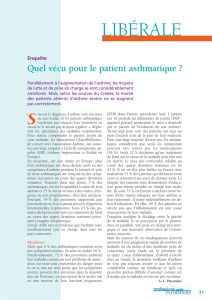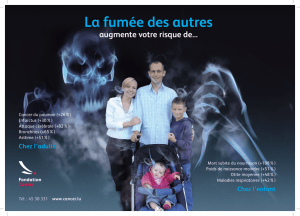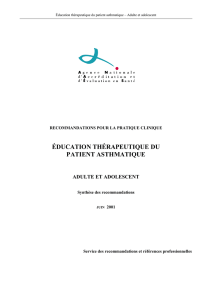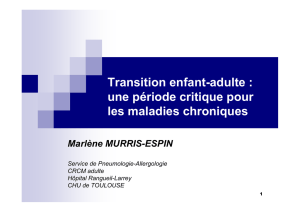L`asthme en Poitou-Charentes - ORS Poitou

Mai 2012
SOMMAIRE
ASTHME
E
n France, plus de 4 millions de personnes sont asthmatiques (6,7 % de la popula-
tion et 9 % des enfants). L’asthme provoque 1 000 décès par an chez les moins de
65 ans. Il s’agit de la première maladie chronique de l’enfant et la 1ère cause d’ab-
sentéisme scolaire. Cette maladie est responsable de 600 000 journées d’hospitalisation et
de 7 millions de journées d’arrêt de travail par an [1].
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique dont la gravité et la fréquence varient
d’une personne à l’autre et qui se caractérise par des crises récurrentes où l’on observe
une gêne respiratoire et une respiration sifflante. Les symptômes peuvent se manifester
plusieurs fois par jour ou par semaine et s’aggravent chez certains sujets lors d’un effort
physique ou pendant la nuit. Lors d’une crise d’asthme, les bronches se resserrent ce qui
entraîne un essoufflement et une respiration sifflante. Un asthme mal contrôlé peut occa-
sionner une perturbation du sommeil, une fatigue diurne et de l’absentéisme scolaire et au
travail.
L’asthme ne se guérit pas mais on peut, par une prise en charge adaptée, contrôler les
symptômes et donner une bonne qualité de vie à ceux qui en sont atteints. Les médica-
ments d’action rapide permettent de soulager la crise. En cas de symptômes persistants, le
malade doit prendre quotidiennement un traitement pour empêcher l’inflammation
bronchique et prévenir l’apparition des symptômes et des crises. Les principaux facteurs
de risque sont une prédisposition génétique (atopie) et l’exposition au tabac, à la pollution
ou aux allergènes de l’environnement . C’est une maladie chronique responsable d’une
inflammation bronchique entraînant une obstruction réversible et variable dans le temps.
I- Situation épidémiologique
II- Dépistage de l’asthme
III- Diagnostic de l’asthme
IV- Prise en charge de l’asthme
V- Qualité de vie des personnes
asthmatiques
VI- Ressources et actions exis-
tantes au niveau national et/ou
régional
Ce bulletin est publié dans le cadre de la journée mondiale de l’asthme du 3 mai 2012.
COMITE DE PILOTAGE
1
L’asthme en Poitou-Charentes
Faits marquants
En 2009, 1 461 séjours en hôpital ont été enregistrés pour asthme. Un tiers de ces hospitalisations concer-
naient des enfants âgés de 1 à 4 ans.
Cette pathologie comptabilise 62 décès annuels moyens et 230 nouvelles admissions en ALD
Une surmortalité masculine régionale depuis 2006 malgré une diminution de la mortalité en corrélation
avec une modification des thérapeutiques
Des facteurs professionnels responsables d’un cas d’asthme sur dix, mais peu indemnisés
Des facteurs de risque (génétiques, tabagisme passif, obésité) et des facteurs déclenchants (tabac, allergè-
nes : pollution intérieure et extérieure, alimentation) connus.
En 2011, 25 918 personnes en Poitou-Charentes de moins de 45 ans sont des asthmatiques persistants, soit
3,2 % de la population
Une qualité de vie altérée en cas d’asthme non contrôlé
Intérêt d’un suivi thérapeutique régulier afin d’éviter les crises, qui peuvent avoir de graves conséquences.
Des ressources régionales existantes, avec cependant une densité de pneumologues moins élevée qu’au
niveau national.
POITOU-CHARENTES BULLETIN D’OBSERVATION
BOS
Bulletin
Observation
Santé
Le comité de pilotage est composé
de : Eric Ben Brik (UCPPE), Catheri-
ne Berson (DIRECCTE), Evelyne
Boura (PMI Vienne), Julie Debarre
(ORS), Mickaëlla Fontaine (Centre
d’éducation des maladies respira-
toires chroniques, CHU), Huguette
Martinez (ASSTV Vienne), Julie Mul-
liez (Service d’EFR et Centre régio-
nal d’allergologie, CHU), Mélanie
Pubert (ORS), Chantal Simmat
(Inspection académique Vienne)
Nathalie Texier (ORS), Martine
Vivier-Darrigol (ARS).
Nous tenons à remercier chacun
des membres de ce comité de pilo-
tage ainsi que le CoRIM, la COSA de
l’ARS, l’ArcMSA, le RSI, pour leur
aide dans l’élaboration de cette
plaquette.
Rédacteurs :
Julie Debarre (ORS)
Nathalie Texier (ORS)

2
I - La situation épidémiologique de l’asthme en Poitou-Charentes
BOS Asthme- ORS Poitou-Charentes - Mai 2012
Les hospitalisations pour motif d’asthme (PMSI MCO)
L’asthme, quand il est insuffisamment contrôlé, peut conduire à des
hospitalisations qui, pour certaines, pourraient être évitées par une
prise en charge adaptée.
En 2009, 1 461 séjours de courte durée pour asthme ont été enre-
gistrés en Poitou-Charentes (soit 1,7 % des séjours annuels to-
taux). Les hommes représentent 52 % des hospitalisations.
Un tiers de ces hospitalisations concernent un enfant de 1 à 4 ans, soit
455 hospitalisations annuelles.
Le taux d’hospitalisation pour asthme est très élevé chez les moins
de 4 ans, particulièrement chez les garçons. Chez les moins de 15 ans,
ce taux est plus élevé chez les garçons que chez les filles mais cette
tendance s’inverse après 15 ans.
Le Poitou-Charentes a un niveau de recours à l’hospitalisation pour
asthme comparable à celui de la France. Seul, le département des
Deux-Sèvres a un indice de recours supérieur à celui de la France de
28 %, en Vienne et en Charente, ces taux sont inférieurs au niveau
national (21 % et 15 %).
Tauxd’hospitalisationpourasthmeselonl’âgeetlesexeenPoitou‐
Charentesen2009(pour10000habitants)
Sources:PmsiMCO,Insee2008 ExploitationORSPoitou‐Charentes
Prévalence chez les adultes
En 2006, 10,2 % des adultes français déclarent avoir eu des symptômes d’as-
thme au moins une fois au cours de leur vie dont 6,7 % au cours des douze
derniers mois précédant l’enquête. Parmi ces derniers, 47 % prennent un
traitement de fond. [1]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Moins
d’unan
1‐4ans 5‐14
ans
15‐24
ans
25‐34
ans
35‐44
ans
45‐54
ans
55‐64
ans
65‐74
ans
75‐84
ans
85ans
ouplus
Hommes Femmes
Les données de l’activité médicale recueillies dans le cadre du Programme de médicalisation des
systèmes d’information en médecine, chirurgie et obstétrique (PMSI MCO) permettent d’analyser les
maladies motivant les recours hospitaliers dans les unités de soins de courte durée. L’unité de base est le séjour,
un même patient ayant pu effectuer plusieurs séjours.
Les affections de longue durée (ALD) pour asthme
Sur la période 2007-2009, la région enregistre 2 605 nouvelles admis-
sions en ALD pour « insuffisance respiratoire chronique grave ». Parmi
celles-ci 27 % ont un diagnostic d’asthme (34 % en France), soit 230
nouvelles admissions annuelles.
Les taux régionaux de nouvelles admissions sont significativement
inférieurs à ceux de la France métropolitaine pour les deux sexes (12
contre 21 pour 100 000 habitants chez les hommes et 14 contre 25 pour
100 000 habitants chez les femmes). Cette situation se retrouve égale-
ment à l’échelle des territoires de santé. Sur cette période, les nouvelles
admissions en ALD concernent plus souvent les femmes que les hom-
mes dans la région (respectivement 131 contre 99 déclarations en
moyenne annuelle). La tranche d’âge la plus touchée est celle des 45-74
ans chez les femmes et celle des 0-14 ans chez les hommes.
Au 31 décembre 2010, dans la région, 5 894 personnes sont en ALD
pour « Insuffisance respiratoire chronique grave », soit 2,3 % de l’ensem-
ble des ALD (3,3 % en France) dans la population affiliée au régime
général. Si on considère que 27 % d’entre elles ont un diagnostic d’as-
thme, 1 563 personnes seraient exonérées du ticket modérateur du fait
de leur asthme. Par ailleurs, en 2006, 8 % des asthmatiques déclaraient
être en ALD au titre de leur asthme [1].
TauxcomparatifsdenouvellesadmissionsenALDpourinsuffisancerespi‐
ratoirechroniquegraveavecundiagnosticd’asthmeselonlesexeetle
territoiredesanté‐Période2007‐2009(pour100000hab.)
Tranches d’âge Hommes Femmes Ensemble
0-14 ans 35 25 60 (26,2 %)
15-44 ans 19 27 46 (19,8 %)
45-74 ans 30 53 84 (36,3 %)
75 ans et + 14 26 41 (17,7 %)
Total 99 131 230 (100,0 %)
Sources:Cnamts,CCMSA,RSI ExploitationORSPoitou‐Charentes
*Différence significative observée avec la France métropolitaine au seuil de 5 %
Un malade peut être exonéré du ticket modérateur par la Sécurité Sociale pour affection de longue durée
(ALD) au titre de l’insuffisance respiratoire chronique grave (ALD 14) s’il vérifie un certain nombre de critères
cliniques, spirographiques et thérapeutiques [1]. Ces critères, dans le cas de l’asthme, correspondent à un
asthme sévère. Une personne est admise en ALD sur décision du médecin conseil de l’assurance maladie.
Nombred’admissionsannuellesenALDpourinsuffisancerespiratoire
graveavecundiagnosticd’asthmeparsexeetâge
auniveaurégional‐Période2007‐2009
Sources:Cnamts,CCMSA,RSI,Insee2008ExploitationORSPoitou‐Charentes
Charente Charente-Maritime
NO
Charente-Maritime
SE
Deux-Sèvres Vienne Région
19,3
11,8*
9,6*
7,0*
11,0* 11,7*
18,2*
15,5*
12,1*
9,4*
14,4* 13,8*
Hommes Femmes

3
BOS Asthme - ORS Poitou-Charentes - Mai 2012
La mortalité liée à l’asthme
Sur la période 2004-2009, le Poitou-Charentes enregistre 62 décès
annuels moyens par asthme. Les trois cinquième des décès sont
féminins.
Par rapport à la France, le Poitou-Charentes montre une surmortalité
significative par asthme à partir de 2006 chez les hommes (42 %
en 2007-2009). Les décès sont plus nombreux aux âges avancés
(à partir de 70 ans). Par contre, chez les femmes, il n’existe pas de
différence significative par rapport à la France.
Le taux de mortalité est en diminution chez les hommes depuis le
début des années 1990. Chez les femmes, la diminution s’observe
seulement depuis les années 2000. Cette baisse progressive du taux
de mortalité est en partie due à la commercialisation en 2001 de pro-
duits associant dans un même flacon corticoïdes et B2LDA inhalés,
avec une meilleure observance du traitement de fond [4].
Evolutiondutauxcomparatifdemortalitéparasthmeselonlesexe
enPoitou‐CharentesetenFrancede1990à2009(pour100000hab.)
Sources:Scoresanté(InsermCépiDc,Insee(RP2006))ExploitationORSPoitou‐Charentes
Donnéeslisséessur3ans:l’annéeindiquéeestl’annéecentraledelapériode(ex:2004=2003‐2005)
Evolutionsdestauxuniquementsurlacauseprincipalededécès
Note:lesannées1999et2000nesontpasreprésentéescomptetenudupassageàlaCim10etde
modificationdanslecodagedescausesdedécèsparasthme.
Les données de mortalité sont renseignées à partir des certificats de décès remplis par le médecin et
fournies par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm CépiDC). Ces données sont
exhaustives au niveau national. L’asthme entraînant de nombreuses complications, celles-ci sont fréquem-
ment indiquées comme étant la cause initiale de décès. C’est pourquoi l’étude de la mortalité par asthme
repose sur l’analyse des certificats de décès mentionnant un asthme en cause initiale de décès mais aussi
en causes associées (codes CIM10 : J45 et J46).
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Hommes‐ PCh Hommes‐ France
Femmes‐ PCh Fe mmes‐ France
Agent Profession ou secteur d’activité
Isocyanates (polyuréthanes) Peintre, industrie de l’isolation et des produits plastiques
Bois variés Menuisier, ébéniste, secteur de la construction
Colorants Textiles, coiffeur
Anhydrides, amines Industrie plastique, coiffeurs
Persulphate Industrie alimentaire, conserverie, cuisinier
Chlore et ammoniac Nettoyage
Formaldéhyde, glutaraldéhyde Personnel hospitalier, métiers de la santé, laboratoire
tanneur et industrie des cosmétiques
Médicaments Industrie pharmaceutique, personnel hospitalier
Métaux Soudeur, industrie métallurgique
Latex Professionnel de la santé
Farine et céréales Boulanger, pâtissier
Animaux Professions liées aux animaux
Lesagentsetlesprofessionsousecteursd’activitéàrisque
Sources : Anaes, Afssaps [5], [7]
Au niveau national, les données issues de ces consultations de pathologies professionnelles et environnementales dénombrent 2 914 person-
nes pour un diagnostic d’asthme en lien avec le travail de 2001 à 2009. Les métiers où le nombre de cas est élevé sont : les artisans et ouvriers de
type artisanal, (surtout chez les hommes), les personnels des services et vendeurs (prédominance des femmes), les ouvriers et employés non qua-
lifiés (femmes) et les conducteurs d’installations et de machines (hommes). Sur ces 9 années d’observation, une diminution des cas d’asthme en
lien avec le travail est constatée. Cette baisse concerne essentiellement les expositions aux allergènes tels que la farine, le bois, les isocyanates.
Une diminution de l’exposition au latex et aux aldéhydes a été mise en évidence dans le secteur de la santé, témoignant d’une modification des
pratiques professionnelles. Ce rapport montre également l’absence de modifications pour certains secteurs d’activité comme la coiffure. [9]
L’ asthme d’origine professionnel
L’asthme professionnel est caractérisé par une obstruction bronchique
variable au cours du temps et/ou une hyperréactivité bronchique, induites
par l’inhalation de poussières, fumées, gaz ou vapeurs présents dans
l’environnement du travail. Les facteurs professionnels pourraient être
responsables d'un cas d'asthme sur dix chez l'adulte dans les pays indus-
trialisés [6], voire davantage selon des publications récentes. L'asthme
professionnel affecte des sujets jeunes et actifs. Certaines professions sont
très exposées à des agents irritants responsables d’asthme parfois sévère
(cf. tableau ci contre).
Lorsqu’un malade est atteint d’un asthme d’origine professionnel, il peut
demander réparation au titre de la maladie professionnelle. En 2009,
2 maladies professionnelles ont été reconnues en Poitou-Charentes
pour le régime général et 11 pour le régime agricole. Cependant, ces
reconnaissances n’incluent pas les artisans pourtant particulièrement
exposés à des facteurs professionnels induisant de l’asthme. En 2011, dans
l’unité régionale de consultation de pathologies professionnelles et envi-
ronnementales (UCPPE), seulement 3 cas d’asthme ont été comptabili-
sés [8].

Les symptômes
Le symptôme le plus connu est le sifflement expiratoire, qui témoigne d’une difficulté à respirer. D’autres signes cliniques peuvent également s’y
associer : une toux survenant parfois par quinte pendant la nuit ; un essoufflement (dyspnée) et une oppression thoracique. Ces symptômes sont
caractérisés par leur prédominance nocturne, leur caractère récidivant, l’existence d’un facteur déclenchant possible (allergène, irritant, exercice,
froid, médicaments, infections des voies aériennes), leur variabilité dans le temps et leur réversibilité sous broncho-dilatateur [5].
Le dépistage
Chez un individu, un interrogatoire clinique va permettre l’identification des
facteurs de risque et des facteurs déclenchants (extérieurs à l’individu) suscep-
tibles de provoquer cet asthme.
Les facteurs de risque
Facteurs génétiques : l’origine en partie génétique de l’asthme ne fait au-
jourd’hui plus de doute. Avoir un parent asthmatique augmente le risque
que l’enfant le soit également. Mais aucun gène n’a été identifié.
Le tabac est un irritant bronchique majeur. Le tabagisme chez la mère
durant la grossesse et le tabagisme passif augmente le risque d’asthme chez
l’enfant.
Alimentation et obésité : Il n’y a, a priori, plus de doute sur la réalité des liens
entre obésité et asthme. Des études récentes montrent que la fréquence de
l’asthme est supérieure chez les obèses que chez les sujets à poids normal.
L’obésité s’accompagne souvent d’un essoufflement à l’effort. On sait aussi
que l’obésité favorise le reflux gastro-oesophagien, ou le syndrome
d’apnées du sommeil. Le contrôle de l’asthme serait également plus difficile
chez l’obèse.
D’après l’étude de l’Irdes [1], les catégories sociales les plus défavorisées souf-
frent davantage d’asthme et sont plus souvent insuffisamment contrôlées.
Les facteurs déclenchants
L’environnement domestique : le tabac, les allergènes : les acariens, les poils
ou plumes d’animaux, les moisissures, le latex, certains aliments (arachide,
œufs…) et des polluants de l’air intérieur (fumée de cheminée, aérosols, …)
L’environnement extérieur : la pollution atmosphérique, le changement
climatique et les allergènes atmosphériques (pollens, ambroisie).
Le débitmètre de pointe (ou « peak flow »)
Cet appareil permet de mesurer le débit expiratoire de pointe (DEP) d’une personne et de le comparer au DEP théorique. Il peut mettre en évi-
dence une gêne respiratoire. Des mesures régulières permettent d’évaluer l’importance du rétrécissement bronchique.
BOS Asthme - ORS Poitou-Charentes - Mai 2012
II - Le dépistage de l’asthme
Dépistage de l’asthme du nourrisson de moins de 36 mois [10]
L’asthme du nourrisson de moins de 3 ans est essentiellement clinique. Il n’existe pas d’outil de
diagnostique spécifique en routine : il est évoqué sur l’anamnèse, l’étude du carnet de santé,
l’examen clinique et une radiographie de thorax normale en période intercritique. Sont en faveur
du diagnostic d’asthme la présence des signes suivants :
Répétition d’épisodes de toux et de sifflements (>=3), souvent favorisés par les infections
virales, les irritants en particulier le tabagisme passif, l’exercice ou les émotions.
La prédominance nocturne des symptômes
La normalité de l’examen clinique entre les crises, et l’absence de retentissement sur la
courbe staturo-pondérale.
La présence de signes d’atopie personnels (eczéma atopique, rhinite allergique, allergie
alimentaire) et familiaux (asthme, rhinite allergiques et eczéma atopique chez les parents et/
ou dans la fratrie)
La radiographie du thorax de face est indispensable dans la démarche diagnostique. Elle
permet d’éliminer des diagnostics différentiels importants tels que les malformations et
l’inhalation de corps étranger. L’efficacité d’un traitement antiasthmatique d’épreuve renfor-
ce le diagnostic.
Contrôlé Partiellement
contrôlé
Non contrôlé
Nombre et fréquence
d’apparition des critères
toutes 1 ou 2 critères sur
une semaine
Au moins 3 critères
sur une semaine
Symptômes diurnes Aucun ou pas + 2 f/s > 2 fois/semaine
Limitation des activités Aucune Toute limitation
Symptômes nocturnes Aucun Tout symptôme nocturne
Besoin trait. de secours Aucun ou pas + 2 f/s > 2 fois/semaine
Fonction pulmonaire Normale
Exacerbation (crise) Aucune Une ou plusieurs
fois/an
Une par semaine
Diminution < 80 %
Niveauxdecontrôledel’asthmeselonleGINA2006
Source : IRDES [1]
4
III - Le diagnostic de l’asthme
Lors du diagnostic de l’asthme, un bilan de santé est réalisé, afin d’évaluer la sé-
vérité de la maladie et d’en rechercher la cause ainsi que d’éventuelles complica-
tions.
Les stades de sévérité et le contrôle de l’asthme
Le consensus international GINA 2006 classe les asthmatiques selon quatre sta-
des de gravité à partir des critères cliniques : stade intermittent (pour environ la
moitié des asthmatiques), stade persistant léger (30 %), stade persistant modéré
(10 %) et stade persistant sévère (10 %). En 2009, ce même consensus suggère de
compléter cette classification par une évaluation périodique du contrôle de l’as-
thme, jugée plus pertinente car tenant compte de la stratégie thérapeutique
régulièrement révisée.
L’ambroisie est une plante sauvage qui nuit à la santé. Le risque d’allergie lié au
pollen de l’ambroisie n’apparaît que dans le courant du mois d’août lorsque les fleurs
libèrent du pollen. Dans certaines régions, cette plante est très répandue (Rhône Alpes)
et se développe progressivement en Poitou-Charentes. Un site
internet régional a été mis en place pour diffuser de l’informa-
tion sur cette plante : http:// www.ambroisie-poitou-
charentes.fr.
Asthme et Allergies
Tous les allergènes peuvent provoquer des crises d’asthme : acariens, pollens, latex, moisissures, médicaments….
L’atopie est l’aptitude à présenter un certain nombre de manifestations cliniques au contact d’allergènes. Selon l’IRDES [1], les asthmatiques sont plus nom-
breux à déclarer une rhinite allergique que les non asthmatiques (plus d’un quart contre 5 % ) ou un eczéma (10 % contre 5 %), soulignant un contexte fréquent
d’atopie.

5
BOS Asthme- ORS Poitou-Charentes - Mai 2012
IV - La prise en charge de l’asthme
Le suivi thérapeutique
1) Débitmètre de pointe » (ou peak-flow) : Le patient peut se le procurer en pharmacie et permet une autoévaluation du souffle afin de dépister la
survenue des crises et de les traiter plus rapidement. Une mesure à domicile du souffle avec un appareil d’utilisation simple.
2) Les examens complémentaires
Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) : le souffle est mesuré à l’aide d’un débitmètre (débits expiratoires,
volumes pulmonaires). Ces examens permettent d'apprécier la sévérité de l'asthme, l'efficacité des traitements préalable-
ment prescrits et l'amélioration des chiffres obtenus après la prise de bronchodilatateurs.
La radiographie thoracique permet de vérifier que l’asthme n’est pas associé à une autre maladie pulmonaire.
Le bilan allergologique : l’identification d’allergènes est recherchée afin d’éviter les crises. Dans certains cas, une désensibilisation pourra être
tentée.
L’éducation thérapeutique
Elle s’inscrit dans le parcours de soins du patient et a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son observance aux traitements
prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas obligatoire et ne peut conditionner le taux de remboursement des actes et des médica-
ments afférents à l’asthme. Les programmes d’éducation thérapeutique du patient peuvent se réaliser suite à un séjour hospitalier ou sous forme de
consultations.
Les professionnels de santé consultés
Le premier professionnel de santé à consulter est le médecin géné-
raliste ou le pédiatre pour les enfants. En 2010, 1 910 médecins
généralistes exercent dans le secteur libéral. Leur répartition sur le
territoire est très inégale puisqu’un quart des cantons bénéficie de
moins de 77 généralistes pour 100 000 habitants quand le quart le
mieux loti bénéficie de plus de 116 médecins pour 100 000 habi-
tants. Les agglomérations sont généralement mieux dotées que les
territoires ruraux. Globalement, les départements de la Vienne et de
la Charente-Maritime ont des densités supérieures aux deux autres
départements. En 2012, 126 pédiatres sont répartis principalement
dans les centres urbains de la région avec une densité moins élevée
qu’au niveau national (1,2 pédiatres pour 5 000 enfants contre 2 en
France).
D’autres professionnels peuvent également intervenir : kinésithéra-
peutes, oto-rhino-laryngologues (ORL). Ces derniers sont au nom-
bre de 62 et répartis dans les centres urbaines du Poitou-Charentes.
En cas de suspicion d’asthme, le patient pourra être orienté vers un
pneumologue ou pneumo-pédiatre afin de mettre en place un
suivi spécialisé adapté. En Poitou-Charentes, 67 pneumologues
sont recensés, en secteur libéral ou hospitalier, avec une densité
inférieure au niveau national (3 contre 4,1 en France pour 100 000
hab.)
Une fois le diagnostic posé, une consultation chez un allergologue
pourra être indiquée afin d’identifier s’il s’associe à un terrain allergi-
que. Les écoles de l’asthme (cf. partie ressource p 7) permettent d’in-
former et d’éduquer le patient.
Les techniques d’inhalation
Ces techniques sont à adapter à chaque patient, à son âge et à sa capacité à prendre le traitement à inhaler, sous forme de
poudres, de spray ou de nébulisateurs. Par exemple, la chambre d’inhalation qui est un réservoir permet d’inhaler plus facile-
ment le produit sans effectuer la synchronisation « mains/poumons » que les jeunes enfants et les bébés ne peuvent pas
pratiquer.
Densité de généralistes
(pour 100 000 hab.)
Densitédemédecinsgénéralistes(2010)etrépartitiongéographique
desd’oto‐rhino‐laryngologues(ORL),pédiatresetpneumologues
(2012)
Effectif ORL
Effectif de pneumologues
Effectif de pédiatres
Source : ARS (Cosa), Insee 2007
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%