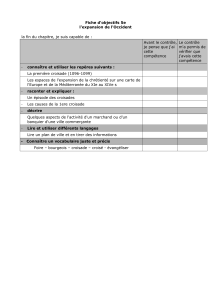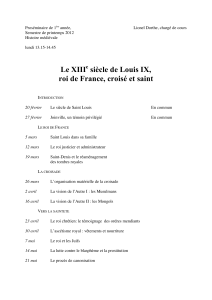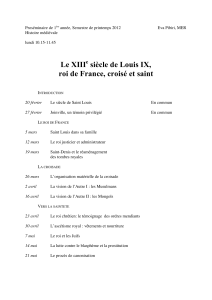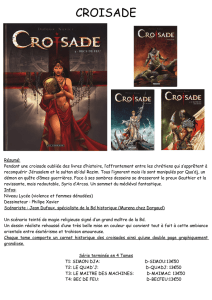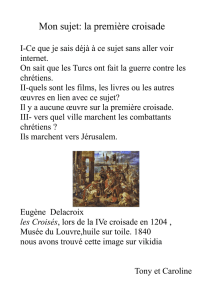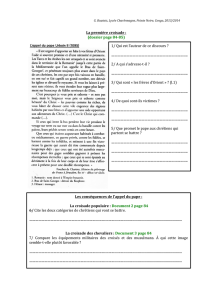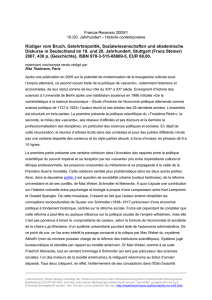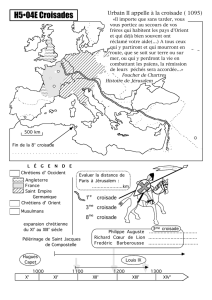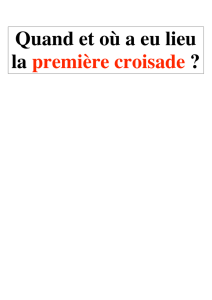(Hg.), Crusading and Warfare in the Middle

Zitierhinweis
copyright
Balard, Michel: Rezension über: John Simon / Nicholas Morton
(Hg.), Crusading and Warfare in the Middle Ages. Realities and
Representations, Farnham: Ashgate Publishing, 2014, in:
Francia-Recensio, 2015-3, Mittelalter – Moyen Âge (500–1500),
heruntergeladen über recensio.net
First published:
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia...
Dieser Beitrag kann vom Nutzer zu eigenen nicht-kommerziellen
Zwecken heruntergeladen und/oder ausgedruckt werden. Darüber
hinaus gehende Nutzungen sind ohne weitere Genehmigung der
Rechteinhaber nur im Rahmen der gesetzlichen
Schrankenbestimmungen (§§ 44a-63a UrhG) zulässig.

Francia-Recensio 2015/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)
John Simon, Nicholas Morton (ed.), Crusading and Warfare in the Middle Ages.
Realities and Representations. Essays in Honour of John France, Farnham,
Surrey (Ashgate Publishing) 2014, XXV–231 p. (Crusades – Subsidia, 7),
ISBN 978-1-4094-6103-6, GBP 63,00.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Michel Balard, Paris
Il est d’usage que les collègues et amis d’un professeur prenant sa retraite lui offrent en hommage un
volume de »Mélanges«: un livre souvent composite, parfois fort éloigné des thèmes de recherche du
dédicataire. Ce n’est pas le cas avec le présent ouvrage. En effet, John France a consacré toute sa
carrière scientifique à l’étude de la guerre médiévale et des croisades, deux thèmes que l’on retrouve
dans les quinze études réunies dans ce volume.
Après une brève introduction et la liste des travaux de John France entre 1968 et 2013,
Clifford J. Rogers prend position dans la controverse portant sur l’essor de la cavalerie à l’époque de
Charles Martel. L’attribution des »bénéfices« permettant l’entretien du cavalier aurait favorisé l’essor
de cette arme, alors que Bernard Bachrach soutient au contraire que la cavalerie n’est pas la
principale arme militaire des Carolingiens. Reprenant le sujet, Rogers montre, en s’appuyant sur les
récits des batailles de 784 contre les Saxons, de 876 entre Charles le Chauve et Louis le Jeune et de
891 (bataille de Dyle) que les Francs préfèrent de loin combattre à cheval, ce qui est pour eux un
gage de succès. Richard Abels s’intéresse à la Bible, conservée à la bibliothèque Pierpont-Morgan et
illustrée de 59 miniatures représentant des scènes de guerre. Plutôt que d’y voir une illustration de la
guerre pratiquée au XIIIe siècle davantage sous la forme de pillages et de dévastations que de
batailles rangées, l’auteur démontre que l’artiste a voulu représenter des scènes de violence fondées
sur l’idéologie de la croisade et illustrant les valeurs de la chevalerie, la recherche frénétique de la
prouesse. Il y aurait ainsi un fossé entre la réalité de la guerre et sa représentation.
Analysant la découverte d’une tombe étrusque en 1959, portant des graffiti incisés au début du
XIIIe siècle, Denys Pringle y voit la représentation d’un trébuchet, là où le premier éditeur du
document, Curzi, imaginait une corne d’abondance accouplée à un étendard templier. Nicholas
Morton s’interroge, quant à lui, sur la connaissance des Turcs, que pouvait avoir l’Occident avant la
première croisade. Rassemblant toutes les sources disponibles – chroniques et lettres de croisade – il
démontre que l’on utilise généralement le terme générique de »païens« pour définir l’ennemi, les rares
mentions de Turcs étant parvenues par des familiers de l’Empire byzantin, marchands, pèlerins ou
missionnaires. Benjamin Kedar relève qu’à Bagdad en 1099 et à Alexandrie en 1103 a été récitée la
lettre-poème par laquelle le shaykh al-Qaffal al-Shashi répondait à une lettre du basileus Nicéphore
Phocas (vers 966), prédisant le triomphe futur de l’islam. Serait-ce une première réaction du monde
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

musulman à l’arrivée des croisés, à une date (1105) où al-Sulami publiait son traité sur le djihad?
Thème peu étudié, l’espionnage au temps de la première croisade, a retenu l’attention de
Susan Edgington. Relevant toutes les mentions d’exploratores ou de speculatores, elle montre que les
prisonniers et les populations locales sont sources d’information pour les croisés dans leur
cheminement vers Jérusalem. Bernard et David Bachrach analysent sous l’angle de l’histoire militaire
les »Gesta Tancredi« de Raoul de Caen. Influencé par les historiens grecs et romains et par Isidore
de Séville, pour décrire la carrière militaire de Tancrède, Raoul écrit une œuvre moitié en prose quand
il connaît les événements par des témoins sûrs, moitié en vers pour exalter les valeurs épiques de son
héros. Historienne des ordres religieux-militaires, Helen Nicholson montre que l’association entre la
mort au combat et la palme du martyre se développe à l’occasion des conquêtes de Saladin, régresse
dans la première moitié du XIIIe siècle et reprend quelque vigueur après la chute d’Acre (mai 1291),
pour encourager le recrutement pour la croisade ou les projets qui la promeuvent.
Les chansons de croisade fleurissent entre 1187 et 1229. Alan Murray s’intéresse à celles qu’a
composées le poète Friedrich von Hausen, familier de Frédéric Ier Barberousse, avant le départ des
troupes allemandes pour la troisième croisade. Peut-être même les a-t-il chantées au cours de
l’expédition, avant de mourir dans une bataille contre les Turcs en 1190.
Simon John retrace l’histoire de la connexion entre Godefroy de Bouillon et le mythique Chevalier au
Cygne. Grâce à celle-ci, la réputation de Godefroy de Bouillon, encore bien terne au XIIe siècle,
l’emporte au siècle suivant sur celles de ses pairs de la première croisade, bien qu’elle ne soit pas
universellement acceptée. Les chartes de croisade, bien étudiées par Jonathan Riley-Smith pour le
début du XIIe siècle, offrent à Daniel Power l’occasion de s’intéresser au comte Jean Ier de Sées qui,
dans une charte de 1189 adressée aux sénéchaux de Normandie et du Maine, dispose de ses biens
en faveur de son fils aîné, avant son départ pour la croisade, énumère ses dettes en chargeant son
héritier de les régler, et pourvoit aux besoins de sa famille. Un document d’une précision
exceptionnelle, ici publié, illustrant les préparatifs détaillés d’un départ pour la croisade.
L’Afrique du Nord reste presque inconnue des Occidentaux à la fin du XIe siècle, comme le remarque
Bernard Hamilton, à l’exception peut-être de la Basse-Égypte. Les premiers contacts avec les Nubiens
n’ont lieu qu’au début du XIIIe siècle, avant que s’établisse une communauté monastique éthiopienne
à Jérusalem après 1244. Peter Edbury, étudiant la »Chronique d’Ernoul«, s’intéresse à la démarche
de Thoros II d’Arménie, mort en 1168, qui aurait proposé de repeupler le royaume de Jérusalem en y
amenant 30 000 Arméniens. Il voit dans ce projet, jamais suivi d’effet, une référence à la faiblesse du
royaume, due aux rivalités entre les grands et aux péchés du clergé. Les plans de croisade élaborés
en Occident après 1291 font l’objet de l’étude de Malcolm Barber qui démontre que ni les ordres
militaires, ni l’aide de Byzance, ni l’alliance avec les Mongols n’étaient capables de provoquer un
sursaut de l’Occident pour recouvrer la Terre sainte. Enfin, Kelly DeVries analyse l’attitude des
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Mongols venus au Proche-Orient, plus en dévastateurs en quête de butin, qu’en conquérants désireux
d’une installation durable. En raison de la faiblesse numérique des troupes mongoles, Ayn Jâlût est
davantage une défaite mongole qu’une victoire des mamlûks.
Les quinze contributions ainsi offertes à John France apportent des points de vue nouveaux sur
l’histoire de l’art militaire et des croisades, deux domaines dans lesquels le dédicataire s’est
particulièrement illustré au cours d’une longue carrière scientifique, très brillante.
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
1
/
4
100%