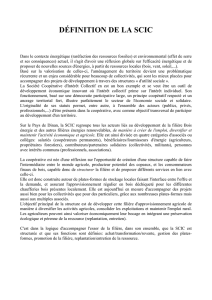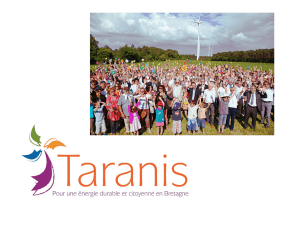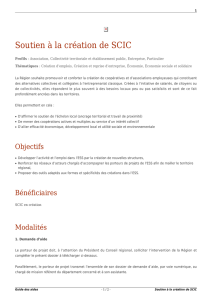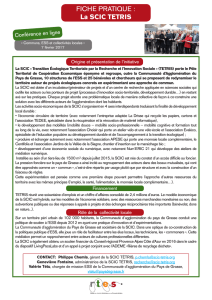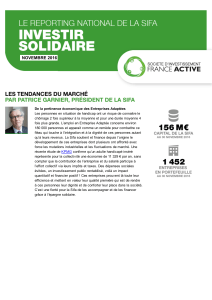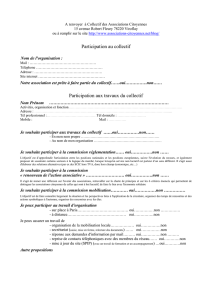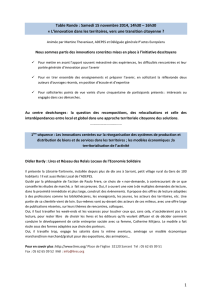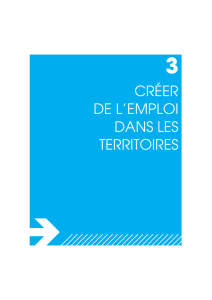Lire le dossier

10 PARTICIPER Octobre . Novembre . Décembre 2011 PARTICIPER Octobre . Novembre . Décembre 2011 11
)Dossier(
«… il manquait
en France un
échelon pour des
entreprises d’utilité
sociale»
S
Créé par la loi du 17 juillet 2001 (suivie par le décret du 21 février
2002), le statut Scic, Société coopérative d’intérêt collectif, fête
son 10e anniversaire. Avec près de 200 entreprises sous statut
Scic à fin 2010 dans tous les métiers et deux nouvelles créations
chaque mois, la pertinence du statut n’est plus à démontrer. Le
bilan des dix années passées permet aussi d’identifier les amé-
liorations nécessaires pour répondre aux enjeux d’un développe-
ment économique multi-partenarial dans de nombreuses filières
en France.
Un bilan positif et
porteur de perspectives
10 ans des Scic
entreprendre en Scic
à l’Économie solidaire en 2000 a permis
au projet de loi de griller les étapes. A
l’époque délégué interministériel, Hugues
Sibille a participé à l’élaboration du projet :
« il manquait en France un échelon pour des
entreprises d’utilité sociale, qui garde l’équi-
libre entre l’activité économique et l’utilité
sociale. On voulait aussi impliquer des collec-
tivités locales dans le tour de table, tout en
continuant à être candidat à des subventions.
Il y a dix ans, et encore aujourd’hui, on a be-
soin d’entrepreneurs motivés, parce qu’il n’y a
pas d’avantage particulier à se mettre en Scic.
Il n’y a que de l’intérêt collectif ! »
Alix Margado, délégué Scic à la CG Scop et
l’un des meilleurs connaisseurs du statut
en France, rappelle les objectifs initiaux
des promoteurs du statut: « réunir plusieurs
acteurs dans une même structure, plutôt que
de créer des groupements avec des statuts
diérents, autrement dit faire un projet éco-
i l’aventure a commencé avec la loi de 2001
pour les toutes premières Scic, qui ont
chacune leur histoire particulière et éton-
nante, elle était un peu antérieure pour
tous ceux qui ont œuvré à la naissance
d’un statut d’entreprise dédiée à l’intérêt
collectif. Trois courants de réflexion ont
donné naissance à la Scic: le programme
européen Digestus, grâce auquel les Fran-
çais ont appris à connaître les formes exis-
tantes ailleurs, comme les coopératives
sociales italiennes ; l’expérimentation ter-
ritoriale menée par la Confédération géné-
rale des Scop et le Groupement national
de la coopération (aujourd’hui Coop FR,
qui représente toutes les familles coopéra-
tives en France) ; et enfin les apports de la
Délégation interministérielle à l’économie
sociale. L’idée d’une loi pour un nouveau
statut était dans l’air.
L’arrivée-surprise d’un secrétaire d’Etat
Picture tank/ Raphael Trapet
Participer 641

12 PARTICIPER Octobre . Novembre . Décembre 2011
)Dossier(
nomique global ; réaliser ce projet dans une
logique décentralisée, c’est-à-dire soit sur un
marché local, soit dans une lière spécialisée
pallier les manques statutaires des autres
types d’entreprises quant à l’utilité sociale
(ni les associations, ni les coopératives de
consommateurs ne peuvent avoir de salariés
dans la gouvernance ; les Scop ne peuvent
y associer leurs clients) et enn anticiper le
désengagement nancier programmé des
pouvoirs publics ». Si les Scic ont connu
quelques échecs, comme pour tout type
de création d’entreprise, c’était le plus
souvent parce que le modèle économique
n’était pas assez solide. En revanche, la
complexité apparente du sociétariat a plu-
tôt aidé les porteurs à aner leur projet et
à régler leurs priorités.
Sur le terrain, après quelques réticences
initiales, des collectivités territoriales ont
mis un pied, et même les deux, dans les
Scic. Ancien dirigeant de la Scop Scodec,
le député des Deux-Sèvres, Jean Grellier
s’est tout de suite intéressé à cette inno-
vation juridique. Il a suscité la création de
Scic, comme Cinémas Bocage et continue
de soutenir de nouveaux projets, comme
un centre d’accueil pour la petite enfance
ou une société de bois-énergie. À l’Assem-
blée nationale, Jean Grellier essaye de
convaincre ses collègues des atouts des
Scic.
Simplication et développement
en lières
Beaucoup d’idées fleurissent pour arriver
à faire passer les Scic de 200 à 500 dans
les trois prochaines années, comme le
souhaite Hugues Sibille : « la simplication
de l’agrément préfectoral serait une bonne
AGRICULTURE
LE BOOM DES CIRCUITS COURTS
Proximité, agriculture biologique, circuit court, coopérative d’intérêt collectif, voilà
des mots qui vont bien ensemble. La lière agricole est sûrement une des voies
pour lesquelles la formule Scic peut apporter de bonnes réponses. Depuis plusieurs
années, la CG Scop a notamment noué des partenariats avec la Fédération
nationale des Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole), pour trouver
d’autres façons de faire localement, et plus récemment avec la FNAB (Fédération
nationale de l’agriculture biologique). En lien avec le milieu agricole, plusieurs Scic
de production et de commercialisation de bois-énergie (des plaquettes de chauf-
fage issues des haies) ont trouvé leur modèle économique et leur public.
En Normandie, les acteurs de l’agriculture bio, réunis au sein d’Inter Bio Norman-
die, ont créé en 2008 une Scic, nommée presque à l’identique Inter Bio Normandie
Services pour développer des actions auprès de la restauration collective des deux
régions normandes. La volonté des agriculteurs et transformateurs bio était de
construire un outil économique pour subvenir aux besoins de la restauration col-
lective, en créant une plateforme logistique pour faciliter les livraisons de produits
bio normands dans les restaurants. Un pari déjà gagné avec deux salariés et une
soixantaine de clients : lycées, collèges, restaurants scolaires, cuisines centrales.
Cela constitue autant de nouveaux débouchés pour les agriculteurs bio.
ENVIRONNEMENT
INVENTER LES MÉTIERS VERTS DE DEMAIN
Dans les secteurs de l’environnement, du recyclage ou des
énergies renouvelables, beaucoup de techniques ou de process
restent à inventer. Le multisociétariat de la Scic est un terreau
particulièrement adapté pour des innovations qui touchent
notre vie quotidienne. À Angoulême, deux Scic jumelles, Revi
+ et Envie 2E s’occupent de la question des déchets, des pro-
fessionnels ou des particuliers. « Revi + nous a permis de faire
notre réputation, évoque Jean-Pierre Caume, le gérant. Nous
sommes reconnus pour la qualité de notre travail et pour la
rigueur de notre gestion. » Revi + est une association qui s’est
transformée en coopérative en 2004. C’est aussi une entreprise
d’insertion, qui fait 600 000 euros de chire d’aaires, avec
une dizaine de salariés, dont la moitié en insertion. Pour fran-
chir de nouvelles étapes, elle vient de s’installer, avec Envie 2E,
dans des locaux ambant neufs.
Les collectivités locales, en particulier le Grand Angoulême, se
sont associées à l’aventure dès le départ, en entrant au capital.
La Chambre de commerce est aussi entrée au capital, dans la
catégorie des usagers. Toutefois, dans ce secteur, les besoins
en capitaux restent importants. « Les investissements pour
les nouveaux locaux se sont élevés à 2 millions d’euros, mais
l’intérêt collectif en vaut la chandelle. »
Hugues Sibille : « la simplication de
l’agrément préfectoral serait une bonne
chose ».
Participer 641

12 PARTICIPER Octobre . Novembre . Décembre 2011 PARTICIPER Octobre . Novembre . Décembre 2011 13
chose. En parallèle, il faut aussi améliorer
l’accompagnement, comme le font déjà les
Unions régionales des Scop, et aussi l’accès
aux nancements pour les coopératives qui
atteignent une taille critique. Enn, il fau-
drait peut-être faire co-exister deux types
de coopératives d’intérêt collectif : celle qui
existe actuellement et une seconde, dans une
logique de partenariat public-privé, comme il
existe deux modèles de coopératives sociales
en Italie ».
De son côté, Jacques Cottereau, vice-pré-
sident de la CG Scop, confirme le potentiel
des Scic dans les territoires : « elles ap-
portent des solutions nouvelles aux territoires,
des solutions qui sont à la fois économiques
et sociales. Dans une coopérative, les gens
s’écoutent et discutent. Cela permet d’aboutir
aux meilleurs services et aux meilleurs coûts
sur un territoire. Il y a une attente forte des ci-
toyens sur l’économie ». Par exemple, dans la
Scic Centre d’abattage de Chalais Sud Cha-
rente, agriculteurs, bouchers, salariés et
élus, qui sont présents dans les catégories
d’associés de la Scic, débattent ensemble
de toutes les décisions économiques, qui
doivent être bonnes pour l’entreprise, et
aussi pour les usagers et pour le territoire.
Beaucoup d’autres secteurs apparaissent
ainsi propices à un développement des
Scic dans les territoires. On peut penser à
l’eau, l’énergie ou la santé, mais aussi à la
culture, à la garde d’enfants ou aux mai-
sons de retraite.
Pascal Trideau, directeur général de la CG
Scop, insiste pour sa part sur la dimension
du vivre-ensemble : « dans une Scic, on co-
construit le projet. L’approche entrepreneu-
riale n’empêche pas de prendre en compte
les besoins des diérentes parties prenantes.
SANTÉ
UN SECTEUR À DÉFRICHER
La santé est un autre secteur dans lequel la gestion privée avec un
intérêt collectif en associant toutes les parties prenantes devrait
apporter une réponse adaptée. De nombreuses Scic oeuvrent en
particulier à l’insertion des personnes handicapées. En 2009, l’Ate-
lier des gens de mer, à Oléron (Charente-Maritime), est devenu la
première entreprise adaptée sous forme Scic. Elle donne du travail
à des personnes handicapées, le plus souvent d’anciens marins-
pêcheurs «débarqués», ayant subi des accidents. Aujourd’hui, ils
réalisent des prestations haut de gamme, en réparant des lets de
pêche. « Depuis le début, nous avons le soutien des élus locaux
et de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) qui ont
compris l’intérêt de notre projet », souligne Thierry Leques, le fonda-
teur de toutes ces structures qui vont bientôt réunir 80 salariés
en insertion et 30 encadrants. Il faut dire qu’avec les coopératives
maritimes, la Scic ne leur paraît pas si éloignée. « Le statut nous
a permis de nous positionner comme des entrepreneurs, des pro-
fessionnels et pas simplement comme des travailleurs sociaux»,
arme Thierry Leques. Le Québec et le Japon ont déjà lancé des
projets d’entreprises dans le secteur de la santé, liant implication
des usagers, construction autour de besoins locaux et ancrage
territorial. Avec l’Atelier des gens de mer, on assiste au démarrage
de telles initiatives en France.
CULTURE
CONCILIER L’ART ET L’ÉCONOMIE
Le secteur culturel et artistique est lui aussi fortement coopératif. L’artis-
tique et l’économique y sont liés sans que l’un l’emporte sur l’autre, les
artistes sont impliqués dans la gouvernance de l’entreprise et des collectifs
se créent là où les personnes sont souvent isolées. « Avant de passer de Sarl
en Scic, nous étions déjà proches des valeurs et des pratiques de l’économie
sociale, se souvient Noëlle Tatich, gérante de la Scic Atla, la première école
de musiques actuelles en France, située dans le 18e arrondissement parisien.
Nous avions une vingtaine d’associés, qui acceptaient de ne pas recevoir
de dividendes. Quand ce nouveau statut est apparu, c’est l’habit qui nous
allait. Nous sommes sortis de la notion de pouvoir pour aller vers une
entreprise partagée. » L’Ecole Atla donne des possibilités de développement
artistique à des musiciens professionnels et leur trace des pistes pour qu’ils
vivent de leur métier. Le Village Atla regroupe plusieurs structures, dont
la coopérative d’activités et d’emploi Clara, qui s’occupe aussi d’artistes
en diculté. Depuis qu’elle a été retenue par la Ville de Paris pour gérer le
centre musical Barbara, qui accueille des nouveaux groupes, son activité
s’est accrue. L’équipe monte désormais jusqu’à une quarantaine de profes-
seurs et les élèves sont toujours plus nombreux. Elle est une des premières
Scic en termes de chire d’aaires.
Jacques Cottereau : « les Scic apportent
des solutions nouvelles aux territoires ».
© Pascal Langlois
Participer 641

14 PARTICIPER Octobre . Novembre . Décembre 2011
)Dossier(
Depuis le dépôt, le 28 juillet dernier, d’une
proposition de loi du député Jean-Luc
Warsmann sur « la simplication du droit
au service de la croissance et de l’emploi »,
dans la lignée d’un rapport remis au Prési-
dent de la République, les Scic attendent
pour la n de l’année, des avancées sur
leur statut. La proposition de loi est en
discussion à l’Assemblée nationale et au
Sénat.
La première simplication proposée porte
sur l’aménagement, voire la suppression
de l’agrément. Selon les termes du rap-
port, « une telle mesure serait de nature
à encourager la création de Sociétés coo-
pératives d’intérêt collectif dont le nombre
a augmenté de 220 entre 2002 et 2010,
soit en moyenne deux créations par mois…
Ce type de sociétés permet de créer ou de
maintenir bon nombre d’activités qui dis-
paraîtraient ou n’existeraient pas sans un
partenariat décloisonné au niveau local ».
La deuxième mesure propose de faire béné-
cier les Scic des régimes scaux du mécé-
nat et d’autres agréments, pour avoir droit
à des aides à l’emploi réservées à des orga-
nismes reconnus pour leur gestion désin-
téressée. Rappelons que les Scic, comme
toutes les entreprises de droit commun,
ne peuvent bénécier de mécénat et sont
par ailleurs soumises à la règle européenne
dite de minimis. Enn, la dernière propo-
sition porte sur les collèges de vote et les
quorums en assemblée générale.
En savoir plus : www.economie.gouv.fr/
les/rap-warsmann.pdf
ENQUÊTE DE LA CG SCOP : QUI SONT LES SCIC ?
Le service études de la
CG Scop a mené une
enquête nationale
auprès de toutes les
Scic an d’en dresser
un bilan après 10
ans d’existence. Au
nombre de 190 à n
décembre 2010, les Scic
en activité ont presque
doublé au cours de
ces trois dernières
années, augmentant
en moyenne au rythme
de deux nouvelles Scic
par mois (cf. visuel1).
Actuellement, plus
d’une Scic sur quatre
est en activité depuis plus de cinq ans
(cf.visuel 2). Sur le territoire métropolitain,
on note une relative concentration des Scic
dans la moitié sud.
Les créations de Scic sont pour 59 % d’entre
elles des créations ex-nihilo, les autres étant
issues de transformations d’organisations
existantes, souvent une association (31 %
35 %
Moins de 2 ans
38 %
Entre 2 et 5 ans
Répartition des Scic selon leur âge
Les Scic en activité au 31 décembre 2010
27 %
Plus de 5 ans
0
50
9
55
98
133
190
100
150
200
2002 2004 2006 20082010
35 %
Moins de 2 ans
38 %
Entre 2 et 5 ans
Répartition des Scic selon leur âge
Les Scic en activité au 31 décembre 2010
27 %
Plus de 5 ans
0
50
9
55
98
133
190
100
150
200
2002 2004 2006 20082010
La Scic apporte de la valeur ajoutée écono-
mique et sociale. Il faut amplier l’approche
par lières dans les nouveaux secteurs : santé,
environnement, éducation ». Bâtir des pro-
jets économiques citoyens, cela rejoint les
ambitions d’autres réseaux depuis long-
temps impliqués dans des partenariats
avec les coopératives, comme la FN Cuma
ou plus récemment la Fnab (agriculture
biologique), l’Acepp (Association des col-
lectifs enfants parents professionnels), des
réseaux d’éducation populaire ou encore
des Ehpad (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes). La
première crèche de l’Acepp sous forme
Scic est par exemple née cette année. Un
signe annonciateur de l’arrivée prochaine
de nouveaux bébés Scic ?
Éric Larpin
Rapport Warsmann :
des avancées pour les Scic ?
des cas). Par ailleurs, 68 % sont des Scic
SARL et les autres des SA.
En termes de gouvernance, les assemblées
générales des Scic comptent en moyenne
80 personnes physiques ou morales asso-
ciées . En plus des salariés et des béné-
ciaires, de nombreux autres types d’asso-
ciés participent au pilotage de l’entreprise,
et parmi eux, des collectivités territoriales
au sein de 37 % des Scic.
Aujourd’hui, une Scic sur six est active
dans un domaine scientique ou tech-
nique, souvent en rapport avec les métiers
de l’environnement. L’industrie, y compris
la distribution d’électricité et la gestion des
déchets, ainsi que le commerce occupent
chacun plus de 10 % des Scic. D’autres
secteurs se distinguent tels les services, la
santé et l’action sociale, la culture, l’ensei-
gnement.
Les Scic ont presque doublé ces 3 dernières années.
Label Route, plate-forme de logistique urbaine, marque sa volonté d’être ecace
écologiquement
Participer 641
1
/
4
100%