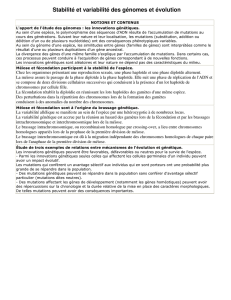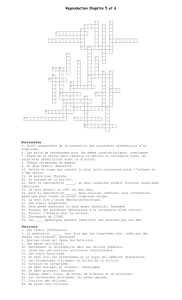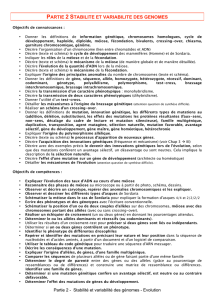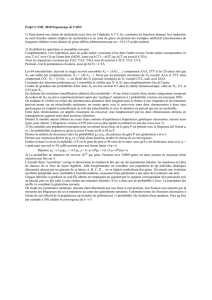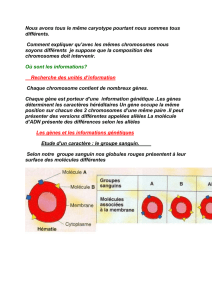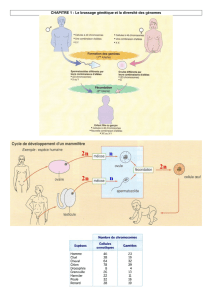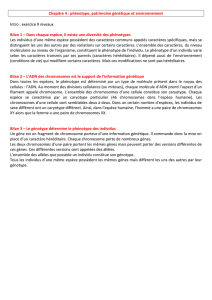T S Stabilité et variabilité des génomes Evolution

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution - 1
Ac-Poitier
__________________
Term S
__________________
Enseignement
obligatoire
Stabilité et variabilité des génomes
Evolution
DOSSIER 4 - Sommaire :
I/ La méiose et la fécondation assurent la stabilité de l’espèce
Le cycle de développement des êtres vivants sexués nécessite une alternance de phase haploïde et diploïde. La
méiose permet de produire des gamètes haploïdes, la fécondation rétablit la diploïdie. Des accidents méiotiques
conduisent à des anomalies de nombre des chromosomes. Les individus porteurs de telles anomalies
chromosomiques meurent ou sont lourdement handicapés.
II/ La méiose et la fécondation assurent également la variabilité de l’individu
La méiose est une succession de 2 divisions. Lors de la première division un brassage interchromosomique a
lieu donnant naissance à une diversité de gamètes. Lors de cette première division, des crossing-over peuvent
apparaître en prophase, ce qui génèrent encore d’autres gamètes différents, d’autant plus qu’un second
brassage interchromosomique en métaphase 2 de la seconde division accompagne ce brassage
intrachromosomique. Enfin, la fécondation en associant au hasard encore, les gamètes produits, accentue
encore la diversité des individus possibles à chaque génération par le jeu de combinaisons allèliques originales.
III/ Les sources d’innovations génétiques : mutations et duplications géniques
Le Polymorphisme allèlique est le fruit de mutations d’allèles pré-existant, mutations qui peuvent avoir des
répercutions phénotypiques plus ou moins graves sur l’individu et sur l’espèce. Des duplications de gènes
augmentent le nombre de gène au sein du génome d’une espèce. Le génome actuel des espèces reflète leur
histoire génétique en cumulant des mutations et duplications au fil des générations.
IV/ Le devenir des innovations génétiques : Génomes et évolution
Les innovations génétiques, gènes et allèles issus respectivement des duplications géniques et mutations d’allèles
pré-existants, sont favorables, défavorables ou neutres pour le porteur si elles sont somatiques et pour l’espèce
si elles sont portées par les gamètes. La sélection naturelle tri l’innovation génétique dans un environnement
donné tandis que la dérive génétique fixe ou élimine la nouveauté génétique par le jeu du hasard quel que soit
l’environnement où apparaît l’innovation génétique. Des mutations portant sur des gènes de développement
peuvent avoir des conséquences phénotypiques considérables. L’émergence de la lignée humaine pourrait
s’expliquer par de telles mutations. Samuel Remérand 2002
Le pol
ymorphisme
phénotypique d’Harmonia
axyridis implique un
polymorphisme génétique,
indispensable aux
phénomènes évolutifs.
D’après Modern
Genetics, , The
Benjamin/
Cummings
Publishing
Company, Inc
1984.

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution -
2
Introduction
Le caryotype humain comporte 46 chromosomes, nombre caractéristique de l’espèce Homo sapiens.
Les 2/3 des 30.000 gènes que portent ces 46 chromosomes sont identiques chez tous les individus; les gènes
impliqués dans les communications nerveuse et hormonale ou encore les gènes architectes responsables du plan
d’organisation d’un être vivant, appartiennent à ce groupe. Ces gènes comme le caryotype sont spécifiques de
l’espèce et participent à la stabilité de l’espèce.
Le 1/3 des gènes restant existe sous plusieurs formes ou allèles. Ces allèles sont responsables, avec
l’environnement, des phénotypes variants ou alternatifs, c’est-à-dire des différences constatées entre individus.
Le polymorphisme de certains gènes, source de variabilité, est à la base de l’unicité de l’individu, de la
défense de l’organisme (Dossier 7) et de l’évolution des espèces.
Quels mécanismes assurent à la fois la stabilité de l’espèce tout en préservant voir créant la
variabilité au sein de cette même espèce ?
I/ La méiose et la fécondation assurent la stabilité de l’espèce
¢ A l’échelle de plusieurs millions d’années, une espèce est stable. Cette stabilité est marquée
notamment par la conservation, de génération en génération, du caryotype dont le nombre et la forme des
chromosomes sont caractéristiques d’une espèce (Doc. 1).
¢ La stabilité du caryotype de l’espèce est assurée au cours du développement de l’individu par la
reproduction sexuée ou plutôt procréation qui comprend deux phénomènes fondamentaux : méiose et
fécondation (Doc. 1).
I-1 Le cycle de développement est caractérisé par l’alternance d’une phase haploïde et d’une
phase diploïde (Doc. 1)
¢ La reproduction sexuée repose sur la formation de gamètes haploïdes : chaque gamète possède un
seul chromosome de chaque paire. Ces cellules à n chromosomes sont produites par la méiose. La
fécondation permet de reconstituer le stock chromosomique diploïde, spécifique à chaque espèce : la
réunion des n chromosomes du spermatozoïde avec les n chromosomes de l’ovule forme un œuf contenant 2n
chromosomes.
¢ Le cycle de développement de toutes les espèces à reproduction sexuée est marqué par une
alternance de phase diploïde et de phase haploïde. La phase diploïde domine la phase haploïde chez les
mammifères, la phase haploïde est plus longue chez les mousses ou le champignon Sordaria.
I-2 La méiose présente une succession de deux divisions
¢ L’interphase précède la méiose. La cellule duplique pendant la phase S son ADN. (1ère S, Doc. 2)
¢ La première division réduit le nombre de chromosome : division réductionnelle (Doc. 3)
Au début de la méiose, la cellule est diploïde, elle possède donc 2n chromosomes.
R Les chromosomes homologues s’apparient pendant la prophase. La prophase débute avec la
condensation de chaque chromosome. Puis, vient la phase originale de la méiose : les chromosomes homologues
s’apparient, pour former des tétrades ou bivalents, grâce à des séquences nucléotidiques particulières qui
permettent de les aligner au gène près (sauf dans les cas de duplications des gènes !, voir infra). Des
enjambements ou Crossing-over donnent naissance à des contacts ou chiasmas qui unissent les deux
chromatides.
R Les paires de chromosomes s’ordonnent pendant la métaphase. Les paires de chromosomes
se trouvent alignées en plaque équatoriale.
R Les chromosomes homologues sont séparés pendant l’anaphase. Les chiasmas qui unissaient
les chromosomes pendant les phases antécédentes se rompent. Les échanges de fragments de chromosomes
sont alors fréquents et entraînent des recombinaisons géniques. Les deux lots de chromosomes homologues
sont entraînés chacun vers une extrémité de la cellule (sans se couper au niveau des centromères).

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution - 3
Doc. 1
:
La stabilité du caryotype de l’espèce, caractéristique à chaque espèce,
est assurée
au cours du
cycle de développement de l’individu par
la reproduction sexuée. Quelque soit l’espèce à reproduction
sexuée considérée, la sexualité comprend deux phénomènes fondamentaux
: méiose et fécondation qui
séparent deux phases haploïde et diploïde, en alternance.
Champignon
Sordaria
Mammifère
Homo sp.
D’après SVT Term S, Bordas,
2002, modifié Remérand 2002.

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution -
4
Doc. 2
:
L’interphase
précède la méiose.
La cellule duplique pendant la phase S son ADN
.
D’après SVT 1ère S, Bordas, 2001, modifié Remérand 2001.
D’après aide
-
mémoire
SVT 2de/1ère et Terminale,
éditions Bordas 1994.
D’après SVT 1
ère
S, éditions
Bordas 1993.

Enseignement Obligatoire de TermS - Dossier 4 : Stabilité et variabilité des génomes et évolution - 5
Doc. 3
: La méiose est une succession de 2 divisions. La première est réductionnelle (elle réduit de
moitié le stock chromosomique), la seconde équationnelle ( elle correspond à une mitose classique).
D’après Biologie terminale D, éditions Bordas 1983, modifié Remérand 2002.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%