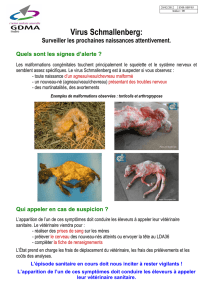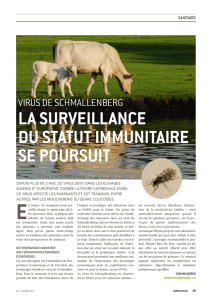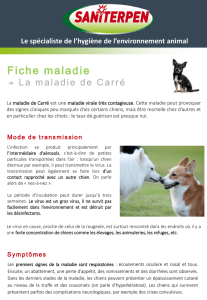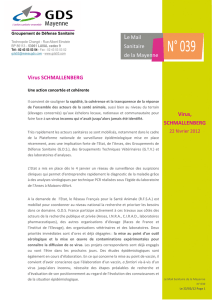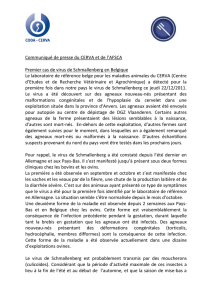Quel est l`impact du virus de Schmallenberg?

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Quel est l’impact du
virus
de Schmallenberg?
Un nouveau virus a été identifié par des
chercheurs allemands en 2011 : le virus
de Schmallenberg (du nom de la ville où
il a été découvert). En Europe, plus de
2000 élevages, principalement ovins,
mais bovins et caprins également, sont
actuellement touchés par cette maladie
dont les conséquences sont lourdes. Le
Département de médecine vétérinaire
des FUNDP tente de mieux comprendre
le virus et d’en évaluer l’impact, grâce à
une approche pluridisciplinaire.
Le virus de Schmallenberg est un arbovirus.
Cela signifie qu’il est véhiculé par les
arthropodes hématophages (suceurs de sang),
tels les moustiques ou les moucherons
piqueurs, probablement en cause dans ce
cas-ci. « Les animaux adultes infectés
présentent différents symptômes, dont,
notamment, une dégradation de l’état
général, une forte fièvre, de la diarrhée et
une perte d’appétit » a expliqué Benoît
Muylkens, chercheur à l’Unité de Recherche
Vétérinaire Intégrée (URVI, membre de
NARILIS), lors de la séance d’informations
aux éleveurs, organisée à Namur en février
dernier. « Même si les signes cliniques
disparaissent après une semaine, le virus a
eu le temps de s’amplifier dans le sang,
pendant trois à cinq jours ».
Conséquences ? « Si une femelle est
infectée alors qu’elle est gestante, elle
transmet directement le virus à son fœtus. Si
l’infection se passe au moment de la mise
en place du tissu nerveux et du système
locomoteur, elle entraîne des malformations
sévères de ces deux systèmes. Dès lors,
certains agneaux arrivent mort-nés, d’autres
sont non viables » explique le chercheur.
Dans d’autres cas, les malformations rendent
les accouchements très difficiles, voire
impossibles.
« Parmi les 140 agneaux nés en janvier
au Centre du mouton de l’Université,
23 ont été atteints par le virus »
Parmi les 140 agneaux nés en janvier au
Centre du mouton de l’Université, 23 ont
été atteints par le virus. Ces derniers sont,
soit morts avant ou à la naissance, soit nés
avec une malformation telle qu’ils ont dû
être euthanasiés. Cela montre combien le
virus est dommageable, surtout quand on
sait que dans certains des 80 élevages
belges touchés, 60 % des fœtus ont été
atteints…
Le Centre du mouton au service de la
recherche, de l’enseignement et des éleveurs
Comme en 2006-2007 suite à l’émergence de la
maladie de la langue bleue (Fièvre catarrhale
ovine), les activités du Centre du mouton
s’inscrivent dans un contexte de recherche,
d’enseignement et service à la communauté. Ce
troupeau sentinelle permet d’apporter des réponses
précieuses quant à l’émergence et la propagation
du nouveau virus et il joue pleinement son rôle
pour l’enseignement des étudiants en médecine
vétérinaire puisqu’ils viennent nombreux pour
assister aux agnelages et au suivi des agneaux
nouveau-nés. Certains étudiants peuvent même
participer aux travaux de recherche dans le cadre
de leur travail personnel de fin de 1er cycle.
L’équipe du Centre du Mouton se tient également
prête pour répondre aux nombreuses questions des
éleveurs de mouton qui sont désemparés face à
cette nouvelle maladie.

Lors de la séance d’information à laquelle 300
personnes, principalement des éleveurs, ont
participé, les scientifiques namurois ont
donc expliqué comment réagir à ce virus, au
regard des éléments qu’ils ont observés.
« La période de contamination du bétail
coïncide avec les périodes d’activité des
insectes vecteurs de la maladie. En raison
des durées de gestation différentes des
espèces cibles (5 mois pour la brebis, 9 mois
pour la vache), on peut redouter que des
nouveaux cas apparaissent à une fréquence
plus élevée dans les élevages bovins dans
les mois à venir. Une surveillance accrue
des vêlages est conseillée en raison des
difficultés de mise-bas qui ont pu être
observées » a expliqué le professeur
Nathalie Kirschvink, directeur du
Département de médecine vétérinaire
namurois et partenaire du projet.
Recherche pluridisciplinaire
L’URVI étudie ce virus à partir d’une approche
pluridisciplinaire : leurs recherches font
appel à la physiologie, à l’anatomie, à la
virologie et à l’embryologie. Elles sont
menées également en collaboration avec
différents laboratoires de référence, belges
et étrangers.
« Nous espérons ainsi présenter, d’ici
quelques mois, un profil type de progression
de la maladie. Les données récoltées
seront précieuses pour la mise au point et la
validation de nouveaux tests diagnostiques
plus sensibles que la méthode disponible
aujourd’hui » annonce Nathalie Kirschvink.
« C’est dans cette optique également que
nous proposons aux éleveurs un ques-
tionnaire destiné à mieux évaluer la présence
de la maladie de Schmallenberg et des
pertes qu’elle cause dans les élevages en
Belgique (255 sont touchés actuellement).
Les données récoltées permettront de
dresser une image de la sévérité de
l’atteinte clinique et de l’évolution épidé-
miologique et virologique associée. Elles
seront comparées à celles de nos collègues
vétérinaires, entomologistes et virologistes
européens ». En juin, un symposium ras-
semblera, au Royaume-Uni, les scientifiques
qui étudient les différentes questions
soulevées par cette émergence virale. À
cette occasion, les possibilités de
développement d’un vaccin pourront être
évaluées.
E.D.
Libre Cours n° 84 – avril 2012
1
/
2
100%