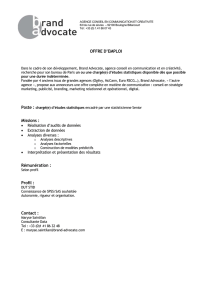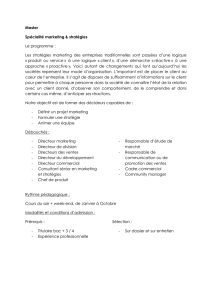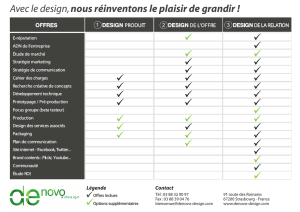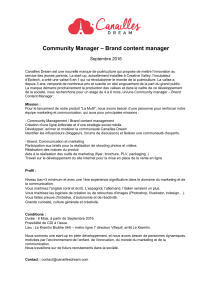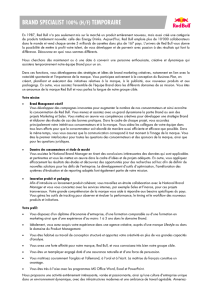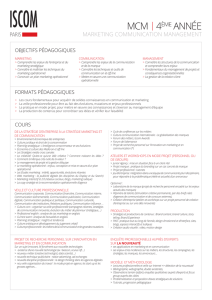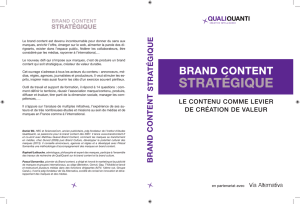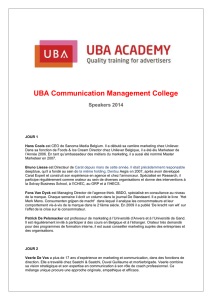Vers un nouveau concept de marque : l`alter-marque

1
Exemples (à suivre impérativement) :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Vers un nouveau concept de marque : l’alter-marque
Frédéric A
UBRUN
Université Lumière Lyon 2 - ELICO
Résumé : La marque est un concept complexe et mouvant. Dans un contexte de crises, nous
sommes en droit de nous interroger sur l’avenir de la marque : va-t-elle évoluer vers un
modèle alternatif correspondant davantage aux mutations sociétales en cours ? Notre réflexion
s’inscrit dans le champ des Sciences de l’Information et de la Communication en étudiant
l’évolution du concept de marque d’un point de vue sociosémiotique. En considérant la
marque comme un système à part entière, l’alter-marque constituerait le méta-système
approprié à la crise.
Mots-clés : crise, alter-marque, sociosémiotique, brand equity, peak brand
Abstract : Towards a new concept of ‘brand’: the alter-brand
The term ‘brand’ reflects a complex and unstable concept. In a context of crises, we are
entitled to wonder about the future of the brand : is it going to evolve towards an alternative
model more in line with the current societal changes ? Our reflection falls within the field of
Information and Communication Sciences by studying the evolution of the concept of brand
from a socio-semiotics point of view. When considering the brand as a system in its own
right, the alter-brand would constitute the appropriate meta-system to the crisis.
Keywords : crisis, alter-brand, socio-semiotics, brand equity, peak brand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
L’objectif de cet article est de montrer la manière dont le « marketing des idées » dont
parle Bernard Floris opère dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
1. La marque employeur, un concept aux contours flous
L’une des premières publications portant sur ce sujet date des années 1990 (Ambler &
Barrow, 1996). En 1998, Etienne Segrétain publie un ouvrage en France portant sur le
marketing des ressources humaines. Dans une version plus récente, le marketing des
ressources humaines est défini par Philippe Liger comme une nouvelle approche de la relation
salariés et entreprises qui :

2
« consiste à considérer les collaborateurs, présents ou potentiels, comme des clients,
au sens le plus noble. Il s’agit d’appliquer la logique et les techniques du marketing et de la
communication pour : attirer des candidats, les recruter et bien les intégrer ; fidéliser des
collaborateurs impliqués » (Liger, 2007, p. 9).
Pour Serge Panczuk et Sébastien Point, c’est : « un nouvel état d’esprit fondé sur des
techniques marketing adaptées aux ressources humaines pour que l’entreprise et sa DRH
puissent se vendre, fidéliser et se renouveler » (Panczuk & Point, 2008, p. 4). Certains aspects
de ces définitions se retrouvent dans les discours des professionnels interrogés comme le
montre cet extrait :
« La marque employeur c’est créer l’identité qui permet aux futurs collaborateurs du
groupe de se reconnaître, de se projeter, et de s’identifier. Il s’agit de les attirer pour qu’ils
viennent vers l’entreprise. C’est l’objectif de la marque employeur. C’est du marketing vers
nos futurs collaborateurs ».
Toutefois, la perception de la marque employeur par d’autres responsables RH est
moins claire :
« La marque employeur c’est la résultante de pas mal de choses. C’est la résultante de
ce que les leaders vont chercher à imposer, ou à véhiculer par une communication de
recrutement ; c’est aussi la résultante du vécu des salariés qui vont l’exprimer d’une manière
plus ou moins formelle dans leurs relations personnelles, quelles soient écrites ou orales ».
En dépit de ces différentes acceptions, soulignons que l’objet tire sa source du
marketing des ressources humaines à l’instar des marques produit dont l’origine provient des
Sciences de Gestion et du marketing (Lewi & Lacoeuilhe, 2007).
1.1. Evolution et enjeux de la marque employeur
La médiatisation des pratiques communicationnelles des entreprises en France portant
sur leur marque employeur s’observe dans les années 2000 et plus spécifiquement entre 2003
et 2008 (avant la crise économique mondiale).
1.1.1. Titre de troisième niveau (Times New Roman 12, italique)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Bibliographie
David A. Aaker, Building Strong Brands, Simon & Schuster, 2002, 400 pages.
Françoise Benhamou, L’économie du star-system, Odile Jacob, 2002, 367 pages.
Benoît Heilbrunn, La marque, Collection « Que sais-je », PUF, 2010, 128 pages.
Eric J. Arnould et Craig J. Thompson, « Consumer culture theory (CCT) : Twenty Years of
Research », Journal of Consumer Research, n°4, 2005, p. 868-882.
Philippe Bouquillion, Bernard Miège, Pierre Moeglin, « La question des industries
créatives en France », Observatoire des mutations des industries culturelles, Série
Perspectives transversales, 2010, 17 pages, [en ligne] : http://www.observatoire-
omic.org/pdf/Bouquillion_Miege_Moeglin_industries_creatives_France.pdf. [Consulté le 12
juin 2012].

3
Hélène Laurichesse, « The Brand’s Strategy in the Movie Industry : The Twilight’s saga »
Actes de la conférence internationale « Cinéma, Art, Technologie », du 28 au 30 Juillet 2010,
Avanca, Portugal, p. 80-90.
Stéphane Magne, « La perception des stratégies de marques dans l’audiovisuel :
le cas des sagas chez les jeunes », Communication non publiée présentée au colloque du
LARA « La stratégie de marque dans le secteur audiovisuel », 5-6 Avril 2012, Université
Toulouse 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
McDonald’s se montre accessible en invitant ses consommateurs à venir tels qu’ils
sont. La campagne d’affichage propose sous format de cartes d’identité des portraits d’une
même personne vue sous différents angles, amplifiant ainsi le phénomène de fragmentation
des identités, tout en jouant avec les codes culturels des consommateurs à travers la mise en
situation de personnages fictionnels dans le fast-food américain.
« Figure 1 : fragmentation des identités » « Figure 2 : intertextualité »
La marque McDonald’s a profité de la crise économique et sociale pour changer de
discours, mais également de posture. En adoptant un discours postmoderne reposant tantôt sur
la fragmentation des identités (Figure 1), tantôt sur l’intertextualité (Figure 2), la marque
revendique un changement de discours plus axé sur l’accessibilité et la connivence avec ses
consommateurs.
1
/
3
100%