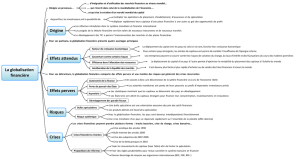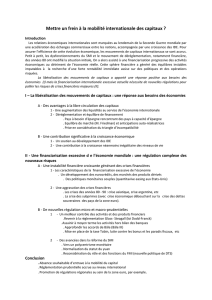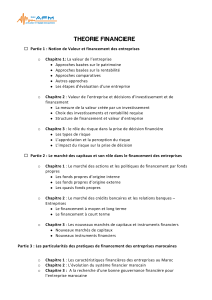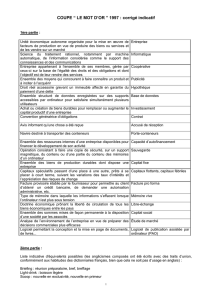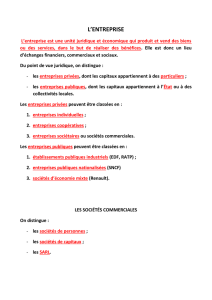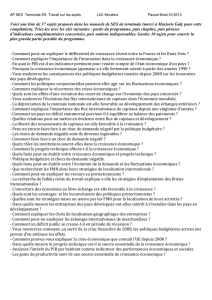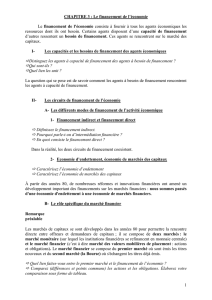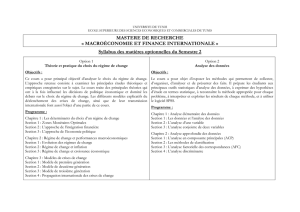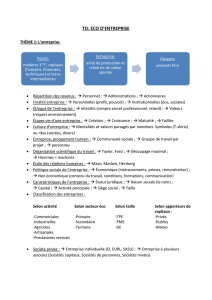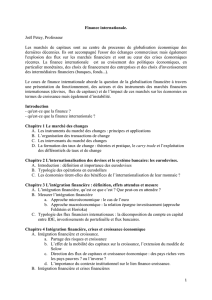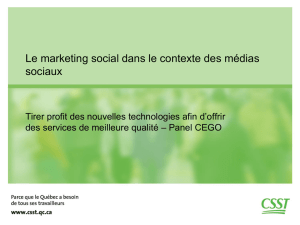2ème Conférence Euro%Africaine en Finance et Economie (CEAFE

2ème Conférence Euro-Africaine en Finance et
Economie (CEAFE)
Volatilité du Taux de Change, Mobilité du Capital
et Crises de Change : Cas de la Tunisie
Helali KAMEL1
Département Des Méthodes Quantitatives Appliquées, FSEG Sfax.
and
Trabelsi AMEL2
Unité de Recherche en Monnaie et du développement infrastructure (MO.DEVI), FSEG
Sfax.
Version: 2008
Résumé
Vu l’importance de la volatilité du taux de change et l’enlèvement prématuré des
contrôles de capitaux qui peut contribuer à l’instabilité de la monnaie dans le contexte
de la libéralisation …nancière, nous essayerons de présenter un modèle économétrique en
fonction de certaines variables macroéconomiques, et variables de contrôle, pour proposer
des facteurs de défenses et limiter l’ampleur de nouvelles crises …nancières.
Notre objectif dans cet article est d’étudier la stabilité macroéconomique réalisée dans
un contexte du taux de change ‡exible dans les pays émergents. De même, le renforcement
poursuivi par la libéralisation graduelle du commerce et des mouvements de capitaux,
ayant pour résultat la couverture de risque de change et l’intégration croissante dans
l’économie mondiale.
En d’autres termes, le but de ce travail est, compte tenu des travaux récents, de tenter
de présenter l’e¤et du taux de change ‡exible sur l’instabilité …nancière, d’ajouter d’autres
variables d’études plus satisfaisantes à l’analyse des crises de change, et la réalisation de
la croissance, et de proposer des possibilités plus élargies pour contrôler la mobilité des
capitaux et la stabilité économique.
Key Words: Volatilité du Taux de Change, Mobilité du Capital, Crises de
Change, Croissance Economique.
Classi…cation JEL: F150, F320, F200, G150, N100
1. INTRODUCTION
Les années 80-90 sont marquées par une forte volatilité des taux de change
qui accroît l’incertitude dans les échanges commerciaux et défavorise la croissance
mondiale. La volatilité stimule la spéculation qui, alimentée par les mouvements de
1Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de SFAX. Route de l’Aérodrome Km 4 B.P.
1088. 3018 Sfax TUNISIE. Casier n: 188. Kamel.Helali@fsegs.rnu.tn / helalikpu@yahoo.fr
2Amel.Trabelsi@fsegs.rnu.tn / amel_elloumitrabelsi@yahoo.fr
1

capitaux, aggrave la déconnexion des taux de change par rapport aux fondamentaux
économiques (balance des paiements, in‡ation, taux d’intérêt...). Un tel régime est
très di¢ cile à défendre contre des attaques spéculatives, surtout lorsque le système
…nancier du pays est faible. En e¤et, la hausse des taux d’intérêt nécessaire pour
consolider le régime de change mine sérieusement le système …nancier et peuvent
même provoquer une crise. Beaucoup de crises …nancières ont été précédés par une
accélération des entrées des capitaux.
L’adoption d’un tel régime de change occupe une place importante en macroé-
conomie internationale. La succession des crises cambiaires depuis plus d’une ving-
taine d’années a dé…nitivement placé la soutenabilité des régimes de changes …xes
au centre des débats de la macroéconomie ouverte contemporaine.
Les ‡ux de capitaux constituent l’un des éléments importants des crises de
change mexicaine et asiatique. Pour éviter l’instabilité …nancière, des respons-
ables de politiques et des économistes proposent de limiter la mobilité des capitaux
dans les pays émergents par des mesures de contrôle. Que doit-on penser de cette
proposition ? Pour cela nous sommes sur le chemin d’avoir « qu’elle est l’impact
des contrôles de capitaux par l’utilisation de certaines variables de contrôles sur les
crises de change pour certains pays émergents dans un contexte de régime de change
‡exible a…n de ressortir l’e¤et de cette ‡exibilité sur la croissance économique de
certains de ces pays ?» .
Notre but est donc d’étudier l’impact de la libéralisation …nancière (volatilité
du taux de change, mobilité des capitaux, régime ‡exible, crises de change,. . . ) sur
la croissance économique de certains pays émergents tout en mettant l’accent sur
la Tunisie.
Vu l’importance relation entre la libéralisation des ‡ux de capitaux, l’instabilité
du taux de change, les régimes adoptés, les crises …nancières et la croissance économique.
Nous allons estimer dans ce travail ; l’impact de certaines variables macroéconomiques
et de contrôles, avec la circulation des capitaux, sur les crises de change pour
certains pays émergents en particulier la Tunisie et certains pays de la zone de
l’Amérique latine dans un contexte de régime ‡exible
La question qui se pose ainsi : « Quelles sont les e¤ets de la volatilité du taux de
change et la mobilité capital sur la croissance économique pour la Tunisie compar-
ativement aux pays semblables et qui ont connu des restrictions macroéconomiques
: l’ajustement structurel ? » .
La réponse à cette question traitera évidemment en grande partie l’instabilité
…nancière de ces pays émergents depuis la libéralisation du compte capital.
Vu l’importance de la volatilité du taux de change et l’enlèvement prématuré
des contrôles de capitaux qui peut contribuer à l’instabilité de la monnaie dans
le contexte de la libéralisation …nancière, nous essayerons de présenter un modèle
économétrique en fonction de certaines variables macroéconomiques, et variables de
contrôle, pour proposer des facteurs de défenses et limiter l’ampleur de nouvelles
crises …nancières. Après la démonstration de certaines variables macroéconomiques
et variables de contrôles utilisées dans les di¤érentes générations et par plusieurs
économistes et chercheurs, nous expliquerons dans ce travail la …abilité de certaines
variables dans la prévention des crises de change en jouant sur le compte capital, le
taux de change e¤ectif réel, les réserves étrangères, le crédit domestique, l’agrégat
monétaire M2, le taux de croissance de l’économie, l’investissement direct étranger.
En d’autres termes, le but de ce travail est, compte tenu des travaux récents, de
tenter de présenter l’e¤et du taux de change ‡exible sur la croissance et d’analyser
les indicateurs d’alertes d’instabilité …nancière, d’ajouter d’autres variables d’études
2

plus satisfaisantes à l’analyse des crises de change, et la réalisation de la croissance,
et de proposer des possibilités plus élargies pour contrôler la mobilité des capitaux
et la stabilité économique.
2. L’EXPLICATION THÉORIQUE DES CRISES DE CHANGE
Certaines économistes suggèrent que les crises de change les plus retentissantes
de la dernière décennie sont intervenues dans des contextes de taux de change …xes
et que les taux de change ‡exibles sont moins vulnérables aux attaques spécula-
tives. Ceci est vrai pour les crises à l’intérieur du mécanisme de change européen
en 1992-1993, au Mexique en 1994-95, dans les pays d’Asie du sud-est en 1997, en
Russie en 1998, au Brésil en 1999, en Turquie en 2001. Ces épisodes avaient conduit
le FMI à la …n des années quatre-vingt-dix à préconiser l’abandon des changes …xes
traditionnels, jugés trop vulnérables, au pro…t de solutions « en coin » : changes
‡ottants ou de changes …xes dits « durs » , comme les currency boards. Cependant,
l’e¤ondrement du currency board argentin au début de l’année 2002 a décrédibil-
isé ce type de régime, forçant le FMI à adapter sa doctrine : ce sont désormais
l’ensemble des taux de change …xes qui sont déconseillés aux pays émergents, au
pro…t de la mise en ‡ottement des monnaies avec cible d’in‡ation
Dans de nombreux pays émergents, si les régimes à parité …xe rigide ne sont pas
la solution, le ‡ottement libre constitue peut-être une voie plus prometteuse. Mal-
heureusement, l’expérience de l’après-guerre indique que ce régime extrême peut
aussi présenter des lacunes, du moins du point de vue des marchés émergents. Cer-
tains observateurs ont fait remarquer que très peu d’économies, aussi bien industri-
alisées qu’émergentes, laissent vraiment leur monnaie ‡otter librement. Comme il
a déjà été mentionné, bon nombre des pays ayant o¢ ciellement un taux de change
‡ottant ont de toute évidence peur du ‡ottement. Ils interviennent couramment
en vue de stabiliser le cours externe de leur monnaie et paraissent disposés à sac-
ri…er d’autres objectifs intérieurs, comme la stabilité des prix et le plein emploi,
pour défendre un taux de change particulier. De plus, les problèmes semblent plus
graves et les écarts par rapport à un véritable ‡ottement des changes plus impor-
tants dans le cas des économies émergentes. Les taux de change prétendument
‡ottants a¢ chent fréquemment des ‡uctuations comparables, par leur ampleur, et
une évolution générale similaire à ce que l’on observe dans les pays ayant une parité
…xe; il arrive même qu’ils soient moins variables que dans ces autres pays.
Cette peur du ‡ottement serait attribuable à partir les études à trois facteurs :
a- Le premier est une profonde dé…ance envers les marchés, dont l’évolution
est perçue par un grand nombre d’économies émergentes comme pernicieuse et
imprévisible.
b- Le deuxième est le fait que les dépréciations qui frappent la monnaie de ces
pays vont habituellement de pair avec une contraction de l’économie plutôt qu’avec
une expansion. Plutôt que d’aider à stabiliser la croissance et l’emploi après un
choc externe, les ‡uctuations des taux de change tendent à exacerber les tensions
et provoquent ainsi des perturbations économiques plus grave. Ce résultat tient en
partie à l’absence d’un mécanisme crédible d’ancrage des attentes, tel qu’une cible
d’in‡ation. De plus, une part considérable de la dette des secteurs public et privé
de maints pays à marché émergent est souvent libellée dans une devise étrangère,
de sorte que le fardeau du service de la dette s’alourdit lorsque la monnaie nationale
se déprécie.
c- Le troisième facteur a trait à l’incapacité manifeste de nombreuses économies
3

émergentes à appliquer une politique monétaire contra cyclique e¢ cace. Dans bien
des cas, l’indépendance que confère un régime de changes ‡ottants à la politique
monétaire a simplement conduit à une in‡ation chronique. En conséquence, les
conditions monétaires ont tendance à se resserrer à la suite d’un ralentissement de
l’économie ou d’une dépréciation de la monnaie nationale, plutôt qu’à s’assouplir
de façon à amortir le choc.
Une première génération de modèles, initiée par Krugman (1979), donne un
rôle central aux fondamentaux (dé…cit extérieur, in‡ation...) dans l’explication
des crises de change, une deuxième famille de modèles, due notamment à Obstfeld
(1986), accorde une importance centrale aux anticipations auto-réalisatrices dans
l’explication des crises de change, et une troisième génération de modèles (Krugman
(1998) et Radelet & Sachs (1998, 1999)) qui combine les deux premiers modèles.
2.1. L’explication par les fondamentaux : le modèle de première
génération
C’est à Krugman (1979) que l’on doit l’explication des causes de la spécula-
tion par les fondamentaux économiques. Jusqu’au début des années 90, les crises
de change ont eu tendance à obéir à un scénario à peu près identique : un pays
ayant un régime de change …xe et poursuivant des dépenses budgétaires exces-
sives se trouve contraint d’engager une politique monétaire expansive pour …nancer
le dé…cit budgétaire, ce qui a pour e¤et de relancer l’in‡ation, d’entraîner une
appréciation réelle de la monnaie nationale et de creuser le dé…cit de la balance
commerciale. Cette situation devient de moins en moins soutenable au fur et à
mesure que s’amenuisent les réserves de change utilisées pour maintenir le cours de
la monnaie. Les attaques spéculatives se portent sur la monnaie en question lorsque
le coût devient excessif ; aussitôt, les réserves s’e¤ondrent, poussent les autorités
à abandonner la politique de …xité des changes. Cette première explication priv-
ilégie l’incompatibilité entre politiques macroéconomiques et maintien de l’objectif
de change. Dans ce contexte, l’attaque spéculative précipite la dévaluation ten-
due inéluctable par le mauvais état des données économiques fondamentales. La
politique d’ancrage est maintenue jusqu’à épuisement des réserves de change.
Cette explication est apparue inadaptée à l’occasion de la crise du SME de
1992-1993, qui a touché entre autres les francs français. Delà, la crise du franc peut
être analysée à partir de « fondamentaux » élargis, comprenant tous les facteurs
in‡uençant les anticipations de change. Dans ce cas, la crise est provoquée par le
coût à court terme (en terme de croissance et d’emploi) de la défense de la parité
: les marchés spéculent alors sur le fait que le gouvernement ne pourra supporter
durablement ce coût. Les attaques des marchés sont alors auto réalisatrices plus
celles-ci sont violentes, plus la défense de la monnaie est coûteuse pour l’activité
(taux d’intérêt prohibitif) et donc plus la tentation est grande de dévaluer.
2.2. Les modèles de deuxième génération
La deuxième génération de modèles, due notamment à Obstfeld (1986), donne
un poids crucial aux anticipations auto réalisatrices dans l’explication des crises
de change. Selon cette approche, pour qu’une crise de change survienne, il su¢ t
que les agents anticipent que leur attaque spéculative entraînera un changement
de politique économique et une dépréciation future de la monnaie. Le caractère
auto réalisateur de la spéculation provient d’une relation de circularité entre les
4

anticipations du marché et la politique monétaire de la Banque centrale. Alors
que la crédibilité d’une parité dépend de la détermination des autorités à défendre
celle-ci, la détermination des autorités dépend réciproquement de la crédibilité de
la parité.
En e¤et, une parité peu crédible (surévaluée) impose aux responsables de la
politique monétaire des taux d’intérêt élevés, qui augmentent le coût de maintien
d’une parité …xe et rendent la dévaluation plus probable (Jeanne (1996)). Les crises
du SME illustrent cette explication. Cependant, comme l’ont souligné Frankel &
Rose (1996), le mauvais état des « fondamentaux » joue également un rôle crucial
dans la majorité des crises.
Ces modèles sont issus des travaux de Eichengreen, Rose & Wyplosz (1996) et
de Flood & Marion (1996). Selon cette seconde approche, ce sont les spéculateurs
qui provoquent la dévaluation, indépendamment des fondamentaux économiques
tels qu’ils sont dé…nis de manière étroite dans le modèle traditionnel. Bien que
les politiques macroéconomiques suivies soient compatibles avec les politiques de
change, les changements dans les anticipations des agents, ou encore l’évolution
contraire des conditions économiques, minent la détermination des pouvoirs publics
à défendre l’objectif de change et conduisent à un nouvel équilibre. Les changements
dans les anticipations des agents modi…ent l’issue de l’arbitrage e¤ectué par les
pouvoirs publics entre la défense du taux de change et certains autres objectifs
économiques, tels que la lutte contre le chômage par exemple. Selon cette approche,
ce sont les attaques qui modi…ent les données du problème et poussent les autorités
à renoncer à l’objectif de change, d’où l’importance, dans ce cadre, des attaques
spéculatives dites autoréalisatrices.
2.3. Les modèles de la troisième génération
Krugman (1998) et Radelet & Sachs (1998, 1999), s’attachent aux crises de
1994-1995 et de 1997-1998 dont la crise de l’Asie du Sud Est. En e¤et, la crise
asiatique ne peut être expliquée ni par les modèles de première génération, ni par
les modèles de deuxième génération, elle fera partie des crises systémiques dans
le cadre de la …nance internationale contemporaine ; c’est ce qui a nécessité le
développement de nouvelles modélisations théoriques de risque systémique et des
processus des contagions.
C’est en réponse à la crise Asiatique, que se sont apparus les modèles de
troisième génération (Krugman, 2001).Cette modélisation insiste sur l’implication
de la vulnérabilité du secteur bancaire dans la crise asiatique ; la fragilité du sys-
tème …nancier est due essentiellement a deux facteurs ; la liquidité et l’Asymétrie
d’information.
Suite aux fortes entrées de capitaux en 1993 dans les pays émergents d’Asie, la
liquidité disponible a augmenté, ce qui a induit les banques nationales à mal évaluer
les risques de défaut. La crise asiatique prenant naissance en Thaïlande (suite à
la dévaluation qui a augmenté les taux sur les dettes et a accéléré les sorties de
capitaux), s’est répercutée par l’e¤et de contagion à l’ensemble des pays asiatiques
(Corée, Indonésie, etc.. . . ).
Les Modèles de troisième génération ne sont pas des modèles qui traitent l’évolution
du régime de change et/ou les di¢ cultés sur les réserves de change. Ils se proposent
à transposer certains modèles initialement présentés en économie fermée. (Mod-
èle de Run bancaire (Dimond & Dybvig, 1983) ou des modèles de désajustements
d’échéances au sein des bilans Bancaires (Bernanke & Gertler, 1989) pour proposer
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%