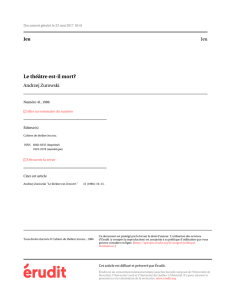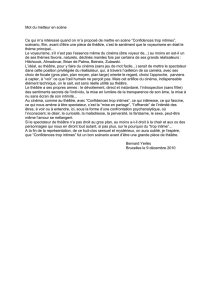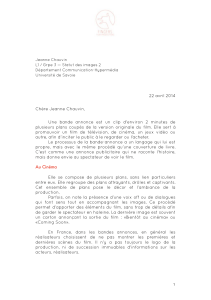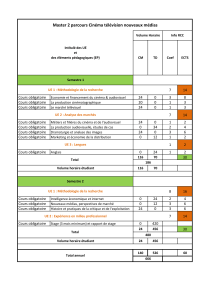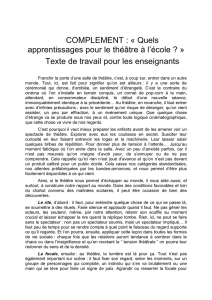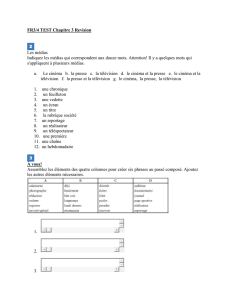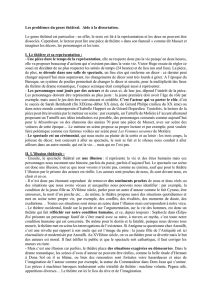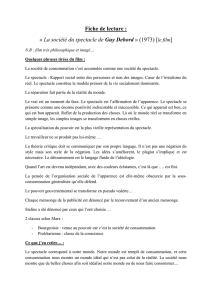une revue de scénographie/scénologie n°3 — juin

PAVILLON BOSIO
UNE ÉCOLE DE SCÉNOGRAPHIE
école supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco
Les arts plastiques et la scène Gilbert Della Noce
Jan Lauwers, un frère humain Jan Lauwers
Pensées Les dispositifs vidéo en question
Mathilde Roman La vidéo et la scène :
déplacements et mutations Béatrice Picon-Vallin
Les diositifs vidéo en queion : hioire et aualité
Pierrick Sorin J’aimerais ne jamais faire de
scénographie Scénographie de la mémoire
Ondine Bréaud-Holland De l’image scénique
Georges Didi-Huberman Éloge de la table,
ou la scène hétérotopique Cécilia Bezzan Poface
ADDENDA Dominique Païni Scénographier le cinéma
Ondine Bréaud-Holland Regards sur le feival
d’Avignon Thibault Vanco Une pensée nomade
une revue de scénographie/scénologie n°3 — juin 2011 — 13 €
juin
•••
•••
n°3

D
Isabelle Lombardot, direrice du Pavillon Bosio
C
Cécilia Bezzan
Ondine Bréaud-Holland
Michel Enrici
Isabelle Lombardot
Maxime Matray
Mathilde Roman
C
Maxime Matray
R
Violette Fos
Dépôt légal : à parution
Numéro : -
Le logotype du Pavillon Bosio e
de Nicolas Roagni et Michaël Lorenzi.
La revue Pavillon e publiée avec le soutien de la
. La Société pour la Geion des Droits
d’Auteur joue un véritable rôle de mécène culturel
en Principauté. Elle coédite des colleions de
disques, soutient des projets culturels (création,
commandes…) et pédagogiques (notamment
les maer classes de l’Académie de musique).
Enfin, elle remet chaque année des bourses
d’études artiiques deinées à aider des élèves à
poursuivre des études supérieures artiiques.
La revue Pavillon e composée, principalement, en
Baskerville Ten Pro et imprimée à Monaco sur papier
recyclé Cyclus offset par Graphic Service .
R
Jean-Charles Curau, Direeur des affaires
culturelles, Jean-Chriophe Maillot, chorégraphe,
direeur des Ballets de Monte-Carlo, Chriian
Raimbert, adjoint au Maire et tous les intervenants.
n° 3 — juin 2011
une revue de scénographie/scénologie
éditée par le Pavillon Bosio
1, avenue des Pins 98000 Monaco
+377 93 30 18 39
http://www.pavillonbosio.com
école supérieure
d’arts plaiques
de la ville de Monaco
PAVILLON
BOSIO
UNE ÉCOLE
DE SCÉNOGRAPHIE

Le CoLLoque «Arguments»
6 Introduion
par Isabelle Lombardot
8 Programme du colloque
9 Présentation des intervenants
argument 1
Les arts plaiques et la scène
10 Jan Lauwers, un frère humain
par Gilbert Della Noce
12 Pensées
par Jan Lauwers
argument 2
Les diositifs vidéo en queion
24 La vidéo et la scène :
déplacements et mutations
par Mathilde Roman
28 Les diositifs vidéo en queion :
hioire et aualité
par Béatrice Picon-Vallin
38 J'aimerais ne jamais faire
de scénographie
par Pierrick Sorin
argument 3
Scénographie de la mémoire
54 De l'image scénique
par Ondine Bréaud-Holland
58 Éloge de la table,
ou la scène hétérotopique
par Georges Didi-Huberman
74 Poface
par Cécilia Bezzan
ADDenDA
80 Le cinéma, l'écran et la cimaise
par Dominique Païni
86 Regard sur le feival d'Avignon
par Ondine Bréaud-Holland
90 Une pensée nomade
par ibault Vanco
sommAire

Les Arts
pL Astiques
et LA sCène
Le CoLLoque
«Arguments»
—
16/17
DéCembre
2009

Février
2008. Ne pas jouer avec les choses
mortes : tel était le titre, sous forme
d’injonion, de l’exposition de la Villa Arson à Nice. Il
s’agissait de queionner le atut des décors, accessoires
et coumes, une fois terminé le numéro de l’artie.
Juillet 2009, quelques kilomètres et mois plus loin.
Le Nouveau Musée National de Monaco, Villa Sauber,
inaugure, avec une exposition intitulée Étonne-moi, une
manifeation — qui durera de juillet 2009 à décembre
2010 — célébrant le centenaire des Ballets Russes et réu-
nissant les entités culturelles de la principauté.
L’exposition joue, sans complexe, avec « les choses
mortes » ayant initié et accompagné les mêmes ballets:
dessins, gouaches, maquettes, coumes, images ani-
mées, rideaux de scène, accessoires, correondances
et photographies, toutes ces œuvres et archives qui
témoignent aujourd’hui de cette prolifique période.
Étonnant.
Décembre 2009. Le Monaco Dance Forum prend
le relais et célèbre à son tour le centenaire des Ballets
Russes, au sein du Grimaldi Forum. Compagnies et dan-
seurs sont invités pour revisiter le légendaire répertoire.
Le Pavillon Bosio rejoint la troupe, inalle le décor et
son troisième colloque de scénographie/scénologie. La
thématique s’impose comme une évidence et s’inscrit
dans cette aualité: nous devions nous interroger sur
la relation que les arts plaiques — entendre aussi la
performance — entretiennent avec la scène. Non, cette
hioire n’e pas nouvelle. Quels en étaient et quels en
sont les enjeux? Qui infiltre qui? Qui nourrit qui? Qui
survit à qui? Qu’exhume-t-on? Quel en e l'héritage ?
E-ce le même récit? E-ce un souffle de vie que les arts
plaiques viennent chercher auprès de ces corps – de la
lumière et du vivant –, en participant avec eux au jeu de
la représentation?
Juin 2011. La revue Pavillon réunissant les aes du
colloque voit enfin le jour. Je remercie nos auteurs et nos
leeurs pour leurs interventions et leur patience. Mais
tournons la page, Lever de rideau, je vous invite à prendre
part à notre réflexion. ✦
introDuCtion
Isabelle Lombardot
9
Fresque réalisée par les étudiants du Pavillon Bosio pour
la scénographie du Monaco Dance Forum, 2009 []
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
1
/
51
100%