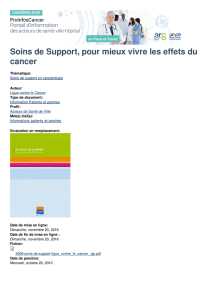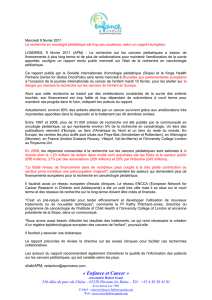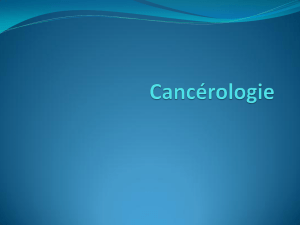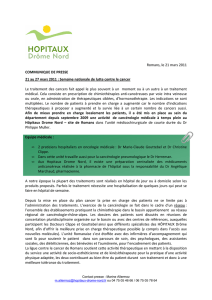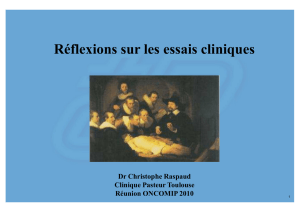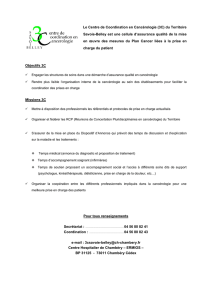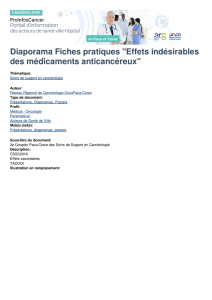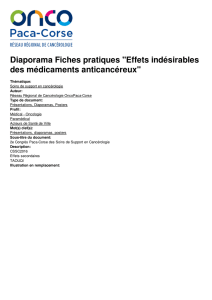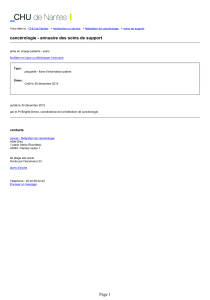Paris, le 16 mai 2008

DOSSIERDEPRESSE
La cancérologie
à l’AP-HP
Uneorganisationauservicedes
patientsetdel’innovation
20juin2012

Paris,le20juin2012
Communiquédepresse
La cancérologie à l’AP-HP,
une organisation au service des patients et de l’innovation
L’AP‐HPprendencharge30%despatientsatteintsdecancerenÎle‐de‐Franceetsuitàcetitreplusde
83500patientschaqueannéedont55000nouveauxcas.L’Institutionestprésentesurtouslestypesde
cancer(sein,gynécologie,digestif,urologie,thorax,orl&thyroïde,dermatologie,hématologie,neuro‐
oncologie…)etpratiquetouslesmodesdetraitement:chirurgie,radiothérapie,chimiothérapie…en
hospitalisationcomplète,partielleouàdomicile.Elleassureainsiàlafoisunepriseenchargedeproximité
etderecoursdel’ensembledescancers.Lespatientsviennentd’Ile‐de‐FrancemaiségalementdelaFrance
entièrevoiredel’étranger,notammentdanslescasdestumeurslesplusrares
ActeurmajeurdelarecherchecliniqueenFrance,l’AP‐HPoccupeuneplaceincontournabledansle
domainedelarechercheencancérologie.Eneffet,elleaparticipéen2011à582essaiscliniquesdanscette
disciplinedont25ciblésspécifiquementsurlespersonnesâgéeset42surlesenfants.Elleaassuréla
promotionde125essaisdont84recherchesbiomédicales.L’institutionestdeplusimpliquéedansles
grandsprojetsderecherchetellequel’InstitutUniversitaired’Hématologie(IUH)del’hôpitalSaint‐Louisou
PACRI,allianceparisiennedesinstitutsderechercheencancérologie(PRESSorbonneParisCité,IGR,
InstitutCurie,IUH…).
Soucieused’améliorerlaqualitédelapriseenchargedesmaladesatteintsdecancer,l’Institutions’est
engagée,dès2009,dansunprocessusdelabellisationinternerépondantlargementauximpératifsduplan
cancer2.
Aujourd’huil’AP‐HPs’estorganiséeencentresintégrés,véritablescentresdecancérologiedanslesgroupes
hospitaliers,etencentresexperts,lieuxd’excellencedansunespécialité.Aveccettedémarche,quis’inscrit
dansunedynamiquedeprogrèscontinu,l’AP‐HPrendsonoffredesoinsencoreplusclaireetplusvisible.
Cetteorganisation,permetàl’AP‐HPd’optimiserleparcourspatientgrâceàunepriseenchargeprécoce,
coordonnéeetglobaledespatientsàtouslesstadesdelamaladie.Toutenayantaccèsauxdernières
innovations,lepatientbénéficiedel’ensembledel’offredesoinsdugroupehospitalier.Ilestsoignénon
seulementpoursoncancermaisaussipourl’ensembledespathologiesassociées,effetssecondaires...
Deparsadimensionhospitalo‐universitaire,cetteorganisationdynamiselarechercheclinique,appliquée
etfondamentale,toutendéveloppantlescoopérationsintra‐AP‐HPethorsAP‐HP,parexempledansle
cadredeprojetsterritoriaux.
PourMireilleFaugère,Directricegénéraledel’AP‐HP«Cettenouvelleorganisationdelacancérologieest
représentativedel’ambitiondel’Institution:offriràtouslespatientsunepriseenchargecomplèteetdes
soinspersonnalisésainsiqu’unaccèsauxdernièresinnovations».
Contactspresse
Servicedepresse‐Tél:0140273722‐courriel:ser[email protected]
2

Sommaire
Lacancérologieàl’AP‐HP,
uneorganisationauservicedespatientsetdel’innovation
L’AP‐HP,unacteurmajeurdelacancérologie .............................................................4
L’améliorationdelapriseenchargeducancer,unenjeustratégique ..........................................................4
L’AP‐HPoccupeuneplacedominanteencancérologie..............................................................................4
Diversitédesprisesencharge.....................................................................................................................5
Deséquipementsdepointe ........................................................................................................................6
Unenjeustratégique:passerd’unemédecined’organeàunepriseenchargeglobale...........................6
Lessoinsdesupport,uneapprocheglobaledelapriseencharge ............................................................8
Uneorganisationàlahauteurdesenjeux......................................................................................................9
Unedémarcheconcertée............................................................................................................................9
Lalabellisationencentreintégréetencentreexpert................................................................................9
Desprisesenchargespécifiquesàl’AP‐HP ................................................................11
Lapriseenchargeenoncogériatrie .............................................................................................................11
Lesunitésdecoordinationenoncogériatrie(UCOG)del’AP‐HP .............................................................11
Lapriseenchargedescancerschezl’enfantetl’adolescent.......................................................................13
Canceretviedelafemme............................................................................................................................14
Canceretgrossesse...................................................................................................................................14
Préserverlafertilitédesfemmestraitéespouruncancer .......................................................................14
Lapriseenchargedescancersraresàl’AP‐HP ............................................................................................15
Larechercheencancérologieàl’AP‐HP.....................................................................17
L’AP‐HP,unacteurmajeurdelarecherchecliniqueettranslationnellesurlecancerenFrance ...............17
L’AP‐HP,1erpromoteurfrançaisenrecherchecliniqueencancérologie .................................................17
L’AP‐HPimpliquéedanslesappelsàprojetsnationauxetrégionaux,pourunaccèstoujoursplus
précoceàl’innovationthérapeutique.......................................................................................................18
Desprojetsderecherchesinnovants........................................................................................................19
Uneimplicationdanslesgrandsprojetsderecherchesurlecancer...........................................................20
Undesdeuxprojets«Prometteurs»desInvestissementsd’avenir:l’InstitutSaint‐Louis.....................20
PACRI,unPôlehospitalo‐universitaireencancérologie‐PHU‐Cancer.....................................................20
LeDépartementhospitalo‐universitairedel’AP‐HPimpliquédanslecancer,DHU‐VIC ..........................21
Glossaire
Annexe:L’offredesoinsencancérologieàl’AP‐HP
3

L’AP‐HP,unacteurmajeurdelacancérologieL’AP‐HP,unacteurmajeurdelacancérologie
Siletraitementdescancersetlestauxdeguérisonprogressentchaquejour,lenombredenouveauxcas
croittoutaussirapidement.En25ans(1980‐2005),l’incidencedescancersenFranceaquasimentdoublé
chezl’homme(+93%)etchezlafemme(+84%).
Siletraitementdescancersetlestauxdeguérisonprogressentchaquejour,lenombredenouveauxcas
croittoutaussirapidement.En25ans(1980‐2005),l’incidencedescancersenFranceaquasimentdoublé
chezl’homme(+93%)etchezlafemme(+84%).
Lecancerestlapremièrecausededécèschez
l’hommeetlapremièrecausededécèsex‐æquoavec
lesmaladiescardio‐vasculaireschezlafemme.
Lecancerestlapremièrecausededécèschez
l’hommeetlapremièrecausededécèsex‐æquoavec
lesmaladiescardio‐vasculaireschezlafemme.
Lacancérologie,uneactivité«encadrée»
Pourla1èrefoisen2009,l’ARSadélivrédes
autorisationsdetraitementdescancersaux
hôpitauxremplissantlesseuilsd’activitéet
répondantauxcritèresd’agrémentsetaux
mesurestransversalesdequalitépourla
chirurgie,lachimiothérapieetlaradiothérapie.
Lesautorisationssontdonnéespour5ans,des
visitesdeconformitésesontdérouléesen2011
afindeconfirmerlesautorisations.
Lecancerduseinreprésenteàluiseul50%des
nouveauxcasdecancerchezlafemme,etceluidela
prostate70%desnouveauxcaschezl’homme.Chezla
femme,les3cancerslesplusfréquentssontlecancer
dusein,lecancerducôlon‐rectumetlecancerdu
poumon.Chezl’homme,ils’agitducancerdela
prostate,ducancerdupoumonetducancerducôlon‐
rectum.
Lecancerduseinreprésenteàluiseul50%des
nouveauxcasdecancerchezlafemme,etceluidela
prostate70%desnouveauxcaschezl’homme.Chezla
femme,les3cancerslesplusfréquentssontlecancer
dusein,lecancerducôlon‐rectumetlecancerdu
poumon.Chezl’homme,ils’agitducancerdela
prostate,ducancerdupoumonetducancerducôlon‐
rectum.
L’améliorationdelapriseenchargeducancer,unenjeustratégiqueL’améliorationdelapriseenchargeducancer,unenjeustratégique
L’AP‐HPestl’établissementdesoinsquiprendenchargeleplusgrandnombredemaladesatteintsde
cancerenIle‐de‐France.L’AP‐HPhébergeégalementuntrèsgrandnombred’unitésderecherchede
l’InsermoudesUniversitésaveclesquellesellecontractualisel’enseignementdesétudiantsencarrièrede
santéetdesinternes,futursspécialistesencancérologieetenspécialitésd’organes.Ellepossèdeenfinun
plateaumédico‐chirurgical,d’imagerieetdebiopathologieuniqueparsadiversitéetsamodernité.
L’AP‐HPestl’établissementdesoinsquiprendenchargeleplusgrandnombredemaladesatteintsde
cancerenIle‐de‐France.L’AP‐HPhébergeégalementuntrèsgrandnombred’unitésderecherchede
l’InsermoudesUniversitésaveclesquellesellecontractualisel’enseignementdesétudiantsencarrièrede
santéetdesinternes,futursspécialistesencancérologieetenspécialitésd’organes.Ellepossèdeenfinun
plateaumédico‐chirurgical,d’imagerieetdebiopathologieuniqueparsadiversitéetsamodernité.
L’AP‐HPoccupeuneplacedominanteencancérologieL’AP‐HPoccupeuneplacedominanteencancérologie
Auregarddel’activitédesautresgrandscentresd’Ile‐de‐France,l’AP‐HPestle1erétablissementdela
régionIle‐de‐Franceencancérologie.Elleprendencharge30%despatientsenIle‐de‐Franceetsuitàce
titreplusde83500patientschaqueannéedont55000nouveauxcas.
Auregarddel’activitédesautresgrandscentresd’Ile‐de‐France,l’AP‐HPestle1erétablissementdela
régionIle‐de‐Franceencancérologie.Elleprendencharge30%despatientsenIle‐de‐Franceetsuitàce
titreplusde83500patientschaqueannéedont55000nouveauxcas.
5,9
17,8 8,8
30,2%36,8%36,1%
0
10
20
30
40
50
60
Chirurgie Radiothérapie Chimiothérapie
AP‐HP
IGR
InstitutCurie&R.Huguenin
Autresétablissements
4

Lacancérologieestuneactivitémajeuredel'AP‐HP.Ellereprésenteen201120%desséjoursen
hospitalisationcomplète(soit120372séjours)et51%del’hospitalisationpartielle(soit304685séances).
Parailleurs,l’AP‐HPestlepremieracteurfrançaisdelarechercheencancérologieetleplusgrandcentre
européentoujoursdanscedomaine.
Diversitédesprisesencharge
L’AP‐HPestprésentesurtouslestypesdecancer(sein,gynécologie,digestif,urologie,thorax,orl&thyroïde,
dermatologie,hématologie,neuro‐oncologie…)ettouslessegmentsdelapriseencharge:chirurgie,
radiothérapie,chimiothérapie…enhospitalisationcomplète,partielleouenhospitalisationàdomicile.Elle
assureàlafoisunepriseenchargedeproximitéetderecoursdel’ensembledescancers,notammentpour
lapriseenchargedestumeurslesplusraresdontlespatientsproviennentd’Ile‐de‐France,detoutela
France,voiredel’étranger.
Touslesgroupeshospitaliersdel’AP‐HPproposentunepriseenchargedespatientsencancérologie.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
EstParisien
Saint‐LouisLariboisière
LaPitié‐SalpêtrièreCharles‐Foix
ParisCentre
ParisNordVal‐de‐Seine
ParisSud
HenriMondor
ParisOuest
ParisSeine‐Saint‐Denis
ParisIDFOuest
Necker‐Enfantsmalades
Robert‐Debré
Nouveauxpatients
Séjoursenchirurgie
NombredePatientsprisencharge
*Voirglossaireenannexe
5
Innovationchirurgicaledanslecancerbroncho‐
pulmonaireàl’hôpitalAvicenne
LePrMartinodetsonéquipe(DrA.Seguin;DrD.
Radu)ontréaliséen2010lapremière
implantationaumonded’unebroncheartificielle,
afind’éviterl’ablationd’unpoumon.
Cesinnovationschirurgicaless’adressentàdes
maladesayantuncancerétenduoud’autres
pathologiesplusraresdesvoiesrespiratoireset
setrouvantenimpassethérapeutique.Uneétude
estencourspourconfirmerdespremiers
résultatsencourageantsàplusgrandeéchelle.
Plusieurscollaborationsnationaleset
internationalesontétéégalementinitiéesàce
sujetpouroffrirauxmaladesdessolutions
efficaces.Cestravauxviennentd’êtreprésentés
lorsd’unelectureinauguraleaucongrèsmondial
detracheo‐bronchologieàCleveland,USA.
Radiothérapieperopératoireducancerdusein
àl’hôpitalSaint‐Louis
L’hôpitalSaint‐Louisaétéretenuparl’INCa,avec
septautrescentresenFrance,pourévaluerles
modalitésdemiseenœuvred’unnouveau
traitementderadiothérapiejusteaprèsl'ablation
delatumeur,ciblésurcertainestumeurs.
Ilestréalisédirectementensalled’opération,et
consisteàirradierpartiellementleseinmaisde
manièremieuxcibléesurlazonedelatumeur.
Cetteradiothérapiedevraitpermettrederéduire
lerisquederécidives,sansmajorerlatoxicitépar
rapportauxradiothérapiesclassiquesetpermet
deremplacerles25séancesderadiothérapie
habituellementpratiquéesdanslessemaines
suivantlachirurgie.Lespremièrespatientesont
étéaccueilliesparl’équipeduPrHennequin
débutjuin2012.
*
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%