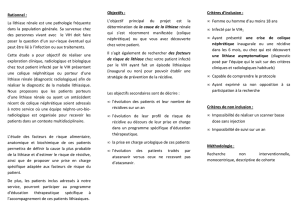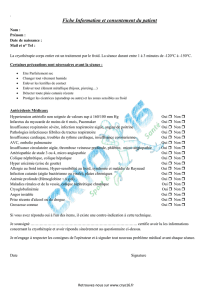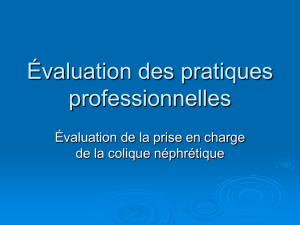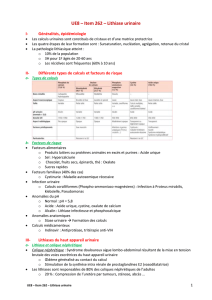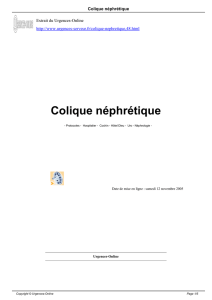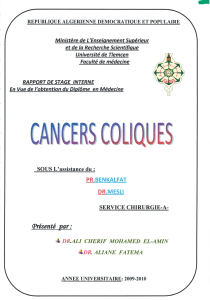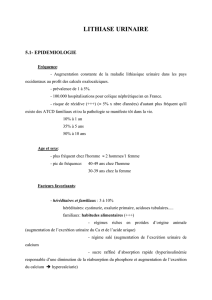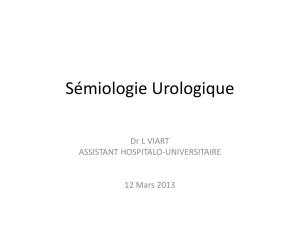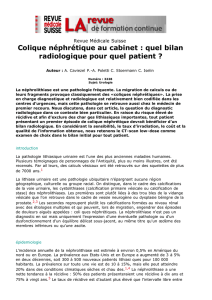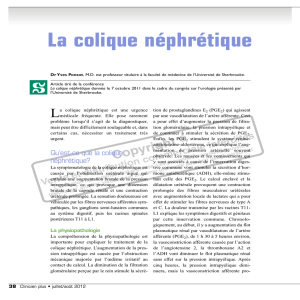Épidémiologie de la lithiase urinaire chez les militaires français au

Progrès
en
urologie
(2014)
24,
764—770
Disponible
en
ligne
sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
ARTICLE
ORIGINAL
Épidémiologie
de
la
lithiase
urinaire
chez
les
militaires
franc¸ais
au
cours
de
l’opération
Serval
Epidemiology
of
urinary
stones
in
the
French
military
during
the
operation
Serval
H.
Abdourahmana,∗,
F.-R.
Desfemmesa,b,
A.
De
Chaumonta,
B.
Molimarda,
M.
Dusauda,
A.
Houlgattea,
X.
Duranda
aService
de
chirurgie
urologique,
hôpital
d’instruction
des
armées
du
Val-de-Grâce,
74,
boulevard
du
Port-Royal,
75005
Paris,
France
b9eantenne
chirurgicale
aérotransportable,
France
Rec¸u
le
6
juin
2014
;
accepté
le
24
juillet
2014
Disponible
sur
Internet
le
22
aoˆ
ut
2014
MOTS
CLÉS
Lithiase
urinaire
;
Épidémiologie
;
Opération
extérieure
;
Traitement
Résumé
Objectifs.
—
La
crise
de
colique
néphrétique
est
une
pathologie
fréquemment
rencontrée
au
cours
des
opérations
extérieures
(Opex)
menées
récemment
par
l’armée
franc¸aise
et
peut
nécessiter
un
rapatriement
sanitaire
en
métropole.
Les
soldats
déployés
dans
les
zones
arides
sont
exposés
à
un
risque
accru
de
survenue
de
lithiases
urinaires.
Le
but
de
notre
étude
est
d’analyser
les
facteurs
de
risque,
la
fréquence
et
les
modalités
de
prise
en
charge
de
la
maladie
lithiasique
urinaire
symptomatique
chez
les
militaires
franc¸ais
rapatriés
pour
colique
néphrétique
au
cours
de
l’opération
Serval.
Méthodes.
—
Notre
étude
a
porté
sur
les
militaires
franc¸ais
rapatriés
du
Mali
pour
colique
néphrétique
entre
le
11
janvier
et
le
30
novembre
2013.
Pour
chaque
patient,
nous
avons
recensé
:
âge,
sexe,
date
de
déploiement,
date
de
la
crise,
antécédents
personnels
et
familiaux
de
lithiase
urinaire,
traitement
médical
initial,
diagnostic
et
traitement
au
retour
en
France.
∗Auteur
correspondant.
Adresse
e-mail
:
(H.
Abdourahman).
http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.07.017
1166-7087/©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.

Lithiase
urinaire
chez
les
militaires
franc¸ais
765
Résultats.
—
Sur
les
348
soldats
rapatriés
sanitaires
en
métropole
durant
cette
période
initiale
de
l’opération
Serval,
41
l’ont
été
en
raison
d’une
crise
de
colique
néphrétique
(11,7
%).
Vingt-
neuf
pour
cent
des
patients
avaient
un
antécédent
personnel
de
maladie
lithiasique
rénale
symptomatique.
Le
temps
moyen
passé
sur
le
territoire
au
moment
de
la
crise
était
de
60
jours
(10—120
jours).
Quatre-vingt-quinze
pour
cent
des
patients
étaient
asymptomatiques
à
leur
arrivée
en
France
et
39
%
des
patients
n’avaient
pas
de
calcul
retrouvé
à
la
TDM.
La
taille
moyenne
des
calculs
retrouvés
à
l’imagerie
était
de
2,71
mm
(1—8
mm).
Une
seule
patiente
(2
%)
a
nécessité
un
drainage
par
endoprothèse
urétérale
JJ.
Conclusion.
—
Les
militaires
franc¸ais
participant
à
l’opération
Serval
sont
exposés
à
de
multiples
facteurs
favorisants
la
lithiase
urinaire
comme
la
déshydratation
et
les
fortes
températures.
L’analyse
de
notre
série
révèle
néanmoins
que
l’antécédent
de
maladie
lithiasique
rénal
est
le
facteur
favorisant
principal
et
que
le
traitement
médical
a
été
efficace
dans
la
quasi-totalité
des
cas
de
colique
néphrétique.
L’impact
opérationnel
lié
à
cette
pathologie
fréquente
en
zone
sahélienne
mérite
une
sensibilisation
des
praticiens
de
terrain
au
dépistage
et
à
la
prise
en
charge
de
cette
pathologie
en
situation
précaire
et
une
réflexion
des
états-majors
sur
l’accès
sur
le
théâtre
d’opération
à
des
moyens
diagnostiques
et
thérapeutiques
adaptés
qui
pourraient
faciliter
le
retour
à
l’unité
de
combat.
Niveau
de
preuve.
—
4.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
KEYWORDS
Urinary
calculi;
Epidemiology;
Foreign
operation;
Treatment
Summary
Objectives.
—
The
renal
colic
crisis
is
a
pathology
frequently
encountered
in
foreign
operations
recently
conducted
by
the
French
army
and
often
requires
a
medical
repatriation
in
mainland
France.
Soldiers
deployed
in
arid
areas
are
at
increased
risk
of
developing
urolithiasis.
The
pur-
pose
of
our
study
is
to
analyze
the
risk
factors,
the
frequency
and
the
methods
of
management
of
symptomatic
urinary
stone
disease
for
French
military
returnees
for
renal
colic
during
Serval
operation.
Methods.
—
Our
study
focused
on
French
soldiers
repatriated
from
Mali
for
a
renal
colic
care
between
January
11th
and
November
30th,
2013.
For
each
patient,
we
recorded:
age,
sex,
deployment
date,
crisis
date,
personal
and
family
histories
of
urolithiasis,
initial
medical
treat-
ment,
diagnosis
and
treatment
to
return
to
France.
Results.
—
Three
hundred
and
forty-eight
soldiers
were
evacuated
during
Serval
operation,
among
which
41
were
due
to
the
occurrence
of
renal
colic
crisis
(11.7%).
Twenty-nine
percent
of
patients
had
a
personal
history
of
kidney
stone
disease
symptomatically.
The
average
residence
time
when
the
crisis
appears
is
60
days
(10—120
days).
Ninety-five
percent
of
patients
were
asymptomatic
at
their
arrival
in
France
and
39%
of
patients
had
no
stone
found
in
CT
scan.
The
average
size
of
the
stones
found
on
the
imaging
was
2.71
mm
(1—8
mm).
One
patient
required
drainage
by
JJ
ureteral
endoprothese
in
order
to
have
a
quick
ureteroscopy
for
recovery
of
its
capacity.
Conclusion.
—
The
French
military
sent
to
Serval
operation
are
exposed
to
multiple
contributing
factors
of
urolithiasis
as
the
dehydration
and
the
strong
temperature.
The
analysis
of
our
series
reveals
that
the
history
of
renal
stone
disease
is
the
main
factor
favoring
and
the
medical
treatment
is
effective
in
almost
all
renal
colic
cases.
The
operational
impact
associated
with
this
common
condition
in
the
Sahel
region
deserves
an
awareness
of
field
practitioners
to
the
screening
and
management
of
this
disease
in
a
precarious
situation
and
a
reflection
of
the
staffs
concerning
the
access
onto
the
operating
theater
to
appropriate
diagnostic
and
therapeutic
means
that
could
facilitate
the
return
to
the
combat
unit.
Level
of
evidence.
—
4.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
All
rights
reserved.
Introduction
Les
antécédents
personnels
et
familiaux,
la
déshydratation
et
la
chaleur
sont
des
facteurs
de
risque
reconnus
de
la
maladie
lithiasique
rénale
dans
la
population
générale.
La
population
militaire
déployée
en
opération
en
Afrique
est
donc
particulièrement
à
risque
de
développer
des
calculs
urinaires.
Ainsi,
la
crise
de
colique
néphrétique
est
une
pathologie
fréquemment
rencontrée
chez
les
militaires
en
opérations
extérieures
et
peut
nécessiter
un
rapatriement
sanitaire
en
métropole.
Le
but
de
notre
étude
est
d’analyser
les
facteurs
de
risque,
la
fréquence
et
les
modalités
de
prise

766
H.
Abdourahman
et
al.
en
charge
des
militaires
franc¸ais
évacués
en
France
en
raison
d’une
colique
néphrétique
au
cours
de
l’opération
Serval
au
Mali.
Patients
et
méthodes
Il
s’agit
d’une
étude
de
cohorte,
rétrospective,
monocen-
trique
de
41
patients
qui
ont
présenté
une
crise
de
colique
néphrétique
nécessitant
un
rapatriement
sanitaire
entre
le
11
janvier
2013,
date
de
déclenchement
de
l’opération
Ser-
val
et
le
30
novembre
2013.
Pour
chaque
patient,
nous
avons
recensé
:
âge,
sexe,
date
de
déploiement,
date
de
la
crise,
antécédents
personnels
et
familiaux
de
maladie
lithiasique
rénale,
traitement
médical
initial,
symptômes
lors
du
rapa-
triement
sanitaire,
prise
en
charge
médicale
et
chirurgicale
à
l’arrivée.
Tous
les
patients
avaient
bénéficié
d’une
visite
médicale
d’aptitude
avant
le
départ
en
opération
exté-
rieure,
mais
tous
n’avaient
pas
bénéficié
de
la
réalisation
d’une
bandelette
urinaire
à
la
recherche
d’une
hématurie
microscopique,
conformément
aux
textes
réglementaires
en
vigueur
[1].
Tous
les
patients
ont
bénéficié
d’un
bilan
cli-
nique,
biologique
et
scannographique
à
leur
arrivée
dans
le
service
d’urologie
de
l’hôpital
d’instruction
des
armées
du
Val-de-Grâce.
Résultats
Parmi
les
348
militaires
franc¸ais
rapatriés
en
France
pour
raison
sanitaire
au
cours
de
l’opération
Serval
durant
cette
période,
41
l’ont
été
en
raison
d’une
crise
de
colique
néphrétique
(11,7
%).
Nous
avions
39
hommes
pour
2
femmes
soit
un
sex-ratio
de
19,5.
L’âge
moyen
était
de
31,1
ans
(23—50
ans).
Vingt-neuf
pour
cent
des
patients
avaient
un
antécédent
personnel
de
maladie
lithiasique
rénale
symp-
tomatique
et
20
%
avaient
un
antécédent
familial
connu.
Lors
de
la
visite
médicale
d’aptitude
précédant
le
départ
en
opération
extérieure,
51
%
des
patients
n’avaient
pas
bénéficié
de
la
réalisation
d’une
bandelette
urinaire
à
la
recherche
d’hématurie
microscopique,
selon
les
recomman-
dations
de
la
direction
centrale
du
service
de
santé
des
armées
(Article
14
du
décret
:
la
visite
médicale
périodique
est
un
bilan
médical
qui
repose
sur
:
un
entretien
médical
individuel,
basé
notamment
sur
l’exploitation
d’un
ques-
tionnaire
médico-biographique
signé
par
l’intéressé
et
de
la
fiche
prérenseignée
par
son
commandement
;
l’analyse
de
tout
document
apporté
par
le
patient
;
l’étude
du
dossier
médical
;
l’examen
clinique
;
des
examens
complémentaires
systématiques,
dont
la
liste
est
fixée
par
instruction,
sous
timbre
du
service
de
santé
des
armées,
hormis
les
cas
pré-
vus
par
la
loi
ou
la
réglementation,
aucun
bilan
biologique
ou
paraclinique
ne
doit
être
prescrit
à
titre
systématique
de
fac¸on
non
discriminée)
[1]
contre
49
%
qui
avaient
bénéficié
de
la
réalisation
d’une
bandelette
urinaire
(46
%
bandelette
négative
et
3
%
présence
de
sang
dans
les
résultats),
parmi
lesquels
20
%
avaient
des
antécédents
personnels
ou
fami-
liaux
de
maladie
lithiasique
rénale.
Le
temps
moyen
passé
sur
le
territoire
au
moment
de
la
crise
était
de
60
jours
(10—120
jours).
Les
motifs
d’évacuation
étaient
soit
la
persistance
d’une
douleur
malgré
le
traitement
médical
symptomatique
Figure
1.
Localisation
des
calculs.
soit
une
dilatation
des
cavités
pyélocalicielles
majorée
à
l’échographie.
Les
radiographies
standard
d’abdomen
sans
préparation
n’étaient
pas
disponibles
et
à
notre
connaissance,
aucune
urographie
intraveineuse
(UIV)
n’a
été
réalisée
sur
le
théâtre
malien.
Ils
étaient
dans
la
très
grande
majorité
des
cas
asymp-
tomatiques
à
leur
arrivée
dans
le
service
d’urologie
de
l’hôpital
d’instruction
des
armées
du
Val-de-Grâce
(95
%
des
patients).
Plus
d’un
tiers
des
patients
(34
%)
avaient
sponta-
nément
évacué
un
calcul
sur
les
données
de
l’interrogatoire.
Le
scanner
abdomino-pelvien
sans
injection
réalisé
de
fac¸on
systématique
retrouvait
la
présence
de
calculs
urinaires
chez
25
patients
(61
%)
avec
persistance
d’une
dilatation
des
cavités
pyélocalicielles
dans
8
cas.
Les
calculs
étaient
locali-
sés
soit
dans
les
cavités
calicielles
(17/25
patients)
soit
dans
l’uretère
pelvien
(11/25
patients),
avec
possibilité
d’une
double
localisation
(Fig.
1).
La
taille
moyenne
des
calculs
était
de
2,71
mm
(1—8
mm).
Tous
les
patients
ont
été
traités
médicalement
lors
de
leur
hospitalisation
dans
le
service
d’urologie
de
l’hôpital
d’instruction
des
armées
du
Val-de-Grâce
avec
une
durée
moyenne
de
séjour
de
24
h
avant
de
rejoindre
leur
garnison
sauf
une
patiente
qui
a
nécessité
un
drainage
de
la
voie
excrétrice
urinaire
supérieure
par
endoprothèse
urétérale
JJ
(2
%).
Discussion
Il
s’agit
de
la
1re étude
colligeant
les
cas
de
colique
néphré-
tique
ayant
nécessité
une
évacuation
sanitaire
au
sein
d’un
contingent
militaire
franc¸ais
en
opération
extérieure,
en
l’occurrence
de
l’opération
Serval
au
Mali
dans
sa
phase
ini-
tiale.
Les
études
récentes
publiées
dans
la
littérature
sur
la
lithiase
urinaire
parmi
le
personnel
militaire
déployé
en
missions
extérieures
sont
le
fait
d’auteurs
américains
rap-
portant
leurs
expériences
des
conflits
de
ce
début
de
XXIe
siècle
:
Operation
Iraqi
Freedom
(OIF)
lors
de
la
seconde
guerre
du
Golfe
et
Operation
Enduring
Freedom
(OEF)
en
Afghanistan.
Les
principaux
facteurs
de
risque
rapportés
dans
la
lit-
térature
sont
la
déshydratation
et
les
fortes
températures
[2].
Nos
soldats
étaient
exposés
au
Mali
à
de
fortes
chaleurs
avec
une
moyenne
de
50 ◦C
à
l’ombre
à
partir
de
midi,
asso-
ciées
à
un
rationnement
en
eau
potable,
ce
qui
accentue
le
phénomène
de
déshydratation.
Nous
avons
ainsi
constaté
un

Lithiase
urinaire
chez
les
militaires
franc¸ais
767
Figure
2.
Chaîne
santé
opérationnelle
avec
les
différentes
unités
médicales
opérationnelles
(UMO)
:
rôle
1
:
PM
=
poste
médical
(intra-
théatre)
;
rôle
2
:
ACA
=
antenne
chirurgicale
aérotransportable
(intrathéatre)
correspond
au
FST
américain
(Forward
Surgical
Team)
;
rôle
3
:
HMC
=
hôpital
médico-chirurgical
(intrathéatre)
correspond
au
CSH
américain
(Combat
Support
Hospital)
ou
MTF
(Medical
Treatment
Facility)
;
rôle
4
:
HIA
=
hôpital
d’instruction
des
armées
(France).
délai
moyen
de
survenue
de
la
crise
assez
rapide
dans
notre
série
de
60
jours
versus
93
jours
dans
la
série
de
Evans
et
Costabile
au
sein
du
47th
Combat
Support
Hospital
lors
de
la
seconde
guerre
du
Golfe
[3].
Une
enquête
à
grande
échelle
menée
chez
les
vétérans
de
l’OIF
(>
10
000
questionnaires
envoyés
avec
un
taux
de
réponse
de
60
%)
a
rapporté
que
la
probabilité
de
dévelop-
per
un
épisode
symptomatique
de
lithiase
urinaire
pendant
leur
déploiement
était
30
fois
plus
élevée
chez
les
patients
ayant
des
antécédents
personnels
de
maladie
lithiasique
et
2,5
fois
plus
élevée
chez
les
patients
ayant
des
anté-
cédents
familiaux
de
maladie
lithiasique
[4].
En
revanche,
il
n’y
avait
aucune
différence
selon
la
saison
où
les
sol-
dats
étaient
déployés.
Dans
notre
série,
29
%
des
patients
avaient
des
antécédents
personnels
de
maladie
lithiasique
rénale.
Ce
résultat
et
les
données
de
la
littérature
justifient
selon
nous
de
modifier
nos
pratiques
avec
une
évaluation
ciblée
de
nos
soldats
avant
leur
projection
en
Opex
dans
des
pays
chauds.
La
question
de
pousser
les
explorations
diagnostiques
jusqu’au
scanner
pour
ces
patients
ayant
des
antécédents
personnels
de
maladie
lithiasique
rénale
est
légitime
et
ce
d’autant
que
d’autres
catégories
profession-
nelles
sont
déjà
soumises
à
de
telles
règles
pour
des
raisons
opérationnelles
(personnel
naviguant
soumis
aux
normes
d’aptitudes
médicales
de
l’aviation
civile).
L’aptitude
serait
alors
obtenue
si
et
seulement
si
le
patient
est
stone
free.
En
revanche,
d’autres
questions
ne
manqueraient
pas
de
se
poser
:
dans
le
cas
particulier
—–
fréquent
—–
d’un
diagnostic
d’imagerie
évocateur
de
plaques
de
Randal,
la
conduite
à
tenir
serait
sujet
à
débat
:
intervention
puis
aptitude
opéra-
tionnelle
ou
abstention
—
surveillance
?
La
colique
néphrétique
est
une
pathologie
fréquente
lors
des
opérations
extérieures
en
pays
chauds
(Moyen-Orient,
Afrique).
Dans
notre
étude,
les
crises
de
colique
néphrétique
ont
représenté
11,7
%
du
total
des
rapatriements
sanitaires
hors
théâtre
au
cours
des
11
premiers
mois
de
l’opération
Serval.
Les
Américains
ont
eux
rapporté
deux
expériences
intéressantes
au
sein
de
leurs
hôpitaux
déployés
sur
le
théâtre
lors
de
l’OIF
(rôle
3,
Fig.
2).
Baker
et
Costabile
[5]
ont
pris
en
charge
218
cas
de
lithiases
urinaires
symptomatiques
chez
182
patients
au
sein
du
47th
Combat
Support
Hospital
déployé
au
Koweït
de
mars
à
août
2003,
ce
qui
représentait
un
total
de
5
%
de
l’ensemble
des
admissions
pour
la
période.
Le
principal
moyen
d’imagerie
utilisé
était
le
scanner
à
68
%,
24
%
avaient
bénéficié
d’une
urographie
intraveineuse,
5
%
d’un
ASP
et
3
%
d’une
pyélographie
rétrograde.
Dans
cette
étude,
16
%
des
patients
avaient
été
hospitalisés
et
avaient
bien
répondu
au
traitement
médical
qui
consistait
en
l’administration
par
voie
intraveineuse
d’antalgiques
et
d’anti-inflammatoires,
30
%
avaient
été
suivis
en
ambulatoire
et
avaient
été
perdus
de
vue
par
la
suite,
et
54
%
avaient
bénéficié
d’une
évacua-
tion
sanitaire
aérienne
hors
du
théâtre
vers
un
rôle
4.
Seuls
3
patients
(1,6
%)
avaient
nécessité
la
pose
d’une
endopro-
thèse
urétérale
JJ,
réalisée
sur
le
théâtre
au
sein
du
rôle
3.
Rozanski
et
Edmondson
[6]
ont
eux
rapporté
84
patients
admis
pour
crise
de
colique
néphrétique
au
sein
du
21th
Combat
Support
Hospital
déployé
à
Mosul
de
mai
à
sep-
tembre
2003,
ce
qui
représentait
8
%
des
admissions.
Leur
moyen
d’imagerie
était
soit
le
couple
échographie
+
ASP
soit
l’urographie
intraveineuse
(UIV).
Dans
cette
série,
86
%
des
patients
étaient
repartis
dans
leur
unité
de
combat
après
un
traitement
médical
efficace
à
base
d’antalgiques,
d’anti-
inflammatoires,
d’antiémétique
et
d’une
réhydratation
par
voie
intraveineuse.
Douze
patients
(14
%)
avaient
une
colique
néphrétique
compliquée
définie
par
de
multiples
lithiases
ou
un
calcul
>
10
mm
ou
une
douleur
réfractaire
au
traitement
médical
ou
de
la
fièvre.
Parmi
ces
patients,
7
(8
%)
avaient
bénéficié
de
la
pose
d’une
endoprothèse
urété-
rale
JJ
au
rôle
3
puis
d’une
évacuation
sanitaire
dans
un
rôle
4
pour
la
suite
de
la
prise
en
charge
urologique
car
ils
pré-
sentaient
de
multiples
lithiases
ou
un
calcul
>
10
mm.
Cinq
patients
(6
%),
qui
présentaient
un
calcul
<
8
mm
avec
une
douleur
réfractaire
aux
antalgiques,
anti-inflammatoires
et
aux
morphiniques,
avaient
bénéficié
de
la
pose
d’une
endo-
prothèse
urétérale
JJ
au
sein
du
rôle
3
et
avaient
rejoint
par
la
suite
leur
unité
de
combat.
Par
ailleurs,
80
%
des
patients
pris
en
charge
pour
colique
néphrétique
entre
janvier
2004
et
décembre
2007
au
cours
de
ces
deux
guerres
(OEF
et
OIF)
ont
pu
retourner
au
sein
de
leur
unité
de
combat
après
un
traitement
médical
symptomatique
par
antalgiques
et
anti-inflammatoires
[7].
Pour
ce
qui
est
de
l’opération
Serval,
le
service
de
santé
des
armées
ne
dispose
malheureusement
pas
de
données
exhaustives
permettant
de
colliger
l’ensemble
des
coliques
néphrétiques
survenues
parmi
les
soldats
franc¸ais
déployés
au
Mali
durant
cette
période.
En
particulier,
il
n’existe
pas
de
registre
épidémiologique
centralisé
qui
aurait
permis
de
connaître
le
nombre
de
patients
traités
médicalement
et
soulagés
au
niveau
des
UMO
de
rôle
1
ou
de
rôle
2,
le
nombre
d’évacuations
sanitaires
intrathéatres
pour
colique
néphré-
tique
et
le
nombre
de
patients
qui
ont
pu
rejoindre
leur
unité
de
combat.

768
H.
Abdourahman
et
al.
Figure
3.
9eantenne
chirurgicale
aérotransportable
déployée
sous
tentes
à
Tessalit
au
Mali
de
février
à
avril
2013.
Parmi
les
patients
pris
en
charge
dans
le
service,
80
%
n’avaient
pas
d’obstacle
sur
la
voie
excrétrice
urinaire
supé-
rieure
et
39
%
n’avaient
pas
de
calcul
retrouvé
dans
les
voies
urinaires
au
scanner
abdomino-pelvien
sans
injection
réalisé
lors
de
leur
arrivée
en
France.
La
taille
moyenne
des
calculs
était
de
2,71
mm.
Contrairement
aux
études
de
l’armée
américaine
sus-
citées
réalisées
au
sein
de
véritables
hôpitaux
de
campagnes
(Combat
Support
Hospital
=
unité
médicale
opérationnelle
de
rôle
3)
avec
présence
de
chirurgiens
urologues
et
accès
pour
certains
rôle
3
au
scanner,
l’armée
franc¸aise
a
déployé
au
Mali
des
structures
chirurgicales
souples
et
mobiles
(antennes
chirurgicales
aérotransportables
[ACA]
déployées
sous
tente)
constituées
d’équipes
chirurgicales
restreintes
(12
personnes
minimum
dont
un
chirurgien
viscéraliste
et
un
chirurgien
orthopédiste)
(Fig.
3).
Ces
ACA
ont
fait
la
preuve
de
leur
efficacité
sur
les
dif-
férents
théâtres
d’opération
mais
ne
permettent
pas
de
multiplier
les
spécialités
chirurgicales
et
les
équipements
d’imagerie.
Leur
finalité
est
la
stabilisation
d’un
blessé
de
guerre
hémorragique
en
vue
d’une
évacuation
sanitaire
rapide.
Les
moyens
d’imagerie
accessibles
au
sein
d’une
ACA
sont
limités
à
des
appareils
mobiles
de
radiographie
et
d’échographie
(Fig.
4
et
5).
Le
produit
de
contraste
radiolo-
gique
n’est
pas
en
dotation
systématique
au
niveau
des
ACA
ce
qui
ne
permettait
pas
la
réalisation
d’UIV
au
Mali.
À
la
lumière
des
données
cliniques
et
paracliniques
de
nos
soldats
évacués
en
France
et
des
expériences
rappor-
tées
par
l’armée
américaine
lors
des
OIF
et
OEF,
on
peut
raisonnablement
penser
que
l’accès
à
une
imagerie
par
UIV
ou
par
scanner
sur
le
théâtre
aurait
permis
de
limiter
le
nombre
d’évacuation
sanitaire
hors
théâtre.
Doter
les
antennes
chirurgicales
aérotransportables
systématique-
ment
d’un
manipulateur
électroradiologiste
et
de
produit
de
contraste
radiologique,
et
former
les
médecins
et
chirurgiens
de
l’avant
à
poser
l’indication
et
à
interpréter
une
UIV
pourraient
être
une
voie
à
étudier
pour
le
SSA.
La
problématique
de
l’accès
à
la
tomodensitométrie
est
plus
complexe.
Le
SSA
a
mis
au
point
un
équipement
adapté
:
un
«
abri
modulaire
avec
scanographe
intégré
(AMS)
»
mais
destiné
uniquement
aux
unités
médicales
opérationnelles
de
rôle
3.
Projetable
par
voie
aérienne
ou
maritime,
le
conte-
neur
est
déployable
avec
deux
extensions
latérales
intégrées
pour
permettre
la
mise
en
œuvre
d’un
scanographe
Philips
Brilliance
64
barrettes,
des
moyens
d’injections
de
produit
de
contraste
et
d’une
station
d’interprétation
complète
(Fig.
6
et
7).
Le
premier
exemplaire
AMS
devrait
être
projeté
au
cours
de
l’été
2014
au
sein
du
centre
médico-chirurgical
Épervier
de
Ndjamena
en
remplacement
d’un
scanner
mono-
barette.
La
doctrine
de
déploiement
de
ce
module
d’imagerie
uniquement
au
niveau
d’une
unité
médicale
opérationnelle
de
niveau
3
(hôpital
médico-chirurgical
de
l’avant,
rare-
ment
déployé
par
l’armée
franc¸aise)
mérite
d’être
discutée.
Sa
mise
à
disposition
selon
les
théâtres
dès
le
niveau
2
(antenne
chirurgicale
aérotransportable
qui
est
alors
consi-
dérée
comme
un
rôle
2+)
surtout
en
l’absence
de
rôle
3
sur
Figure
4.
Appareil
de
radiographie
mobile
Stephanix
disponible
en
ACA.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%