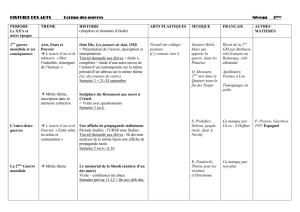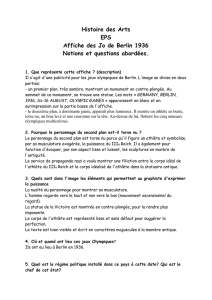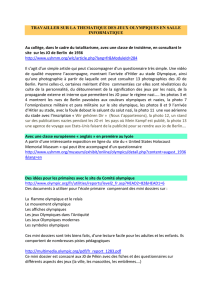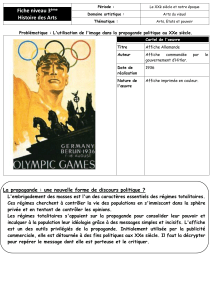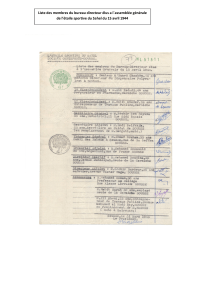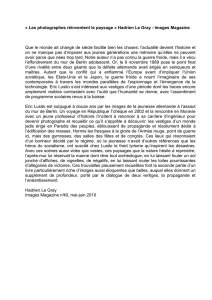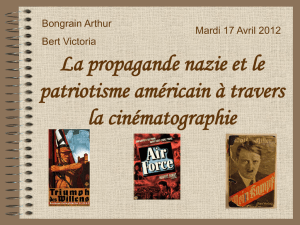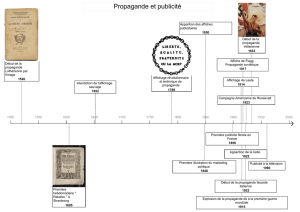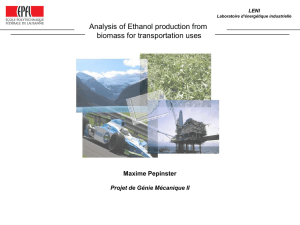Programme stage 14 et 15 nov 2016

Stage Plan de formation académique (Lyon)
Sport et politique au XX
e
siècle : toute une histoire
14 & 15 novembre 2016
En résonance avec l’exposition Le sport à l’épreuve du nazisme. Des J.O. de Berlin aux J.O. de Londres
(1936-1948), cette formation a pour objectif de proposer aux enseignants une mise en perspective
historique et culturelle du sujet. Il s’agit de permettre aux professeurs de construire des situations
d’apprentissage en prenant appui sur la recherche et de bénéficier des apports de l’historiographie
récente sur le sujet.
Lundi 14 novembre
8h45 -9h15 : accueil
9h15 : Présentation du stage
Par Isabelle Rivé, directrice du CHRD
9h30 – 11h15 : À propos des conditions d'émergence du sport comme enjeu des relations
internationales en France
Par Thierry Terret, recteur de l’académie de Rennes, historien et auteur de l’ouvrage Histoire du
Sport (PUF, 2013)
11h30 – 12h45 : Visite de l’exposition Le sport à l’épreuve du nazisme. Des J.O. de Berlin aux J.O. de
Londres (1936-1948)
Par Marie-Pierre Douillet-Roman et Audrey Corte, médiatrices au CHRD
12h45 – 14h : pause déjeuner
14h – 15h15 : Le sport sous Vichy
Il s'agit à travers cette présentation de comprendre la politique sportive mise en place par le gouvernement
de Vichy. Nous nous intéresserons dans un premier temps au discours idéologique, à la propagande
sportive et aux réalisations en termes de sport et d'EPS.
Dans un second temps, nous aborderons la réalité de cette politique à travers le comportement du
mouvement sportif, (collaboration/résistance) et la réalité au quotidien. Enfin, il s'agira d'effectuer un
bilan de cette politique sportive.
Par Christophe Pécout, enseignant-chercheur à l’Université Lille 2
15h30 – 16h45 : Les Jeux olympiques
À la fin de la seconde guerre mondiale, le sport et plus particulièrement les Jeux olympiques sont utilisés par
de nombreux pays, par certains sportifs ou par certaines organisations comme un moyen et un outil de

revendications ou de propagande. Cette vitrine internationale représente également la symbolique de la force
et de la puissance des nations concurrentes en temps de paix.
Par Éric Monnin, historien et sociologue du sport, Maitre de conférences à l’Université de
Franche-Comté et auteur de l’ouvrage De Chamonix à Sotchi. Un siècle d’olympisme (Éditions Désiris,
2013)
16h45 – 17h30 : Transpositions pédagogiques :
Les J.O. de Berlin
et
Résister par le sport
(EPI)
Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, enseignants en Histoire-Géographie et professeurs-
relais au CHRD, Daniel Legrand-Bascobert, professeur d’Éducation physique et sportive à la
CSI et Franck Flacheron, professeur d’Éducation physique et sportive au lycée polyvalent
Antoine de St Exupéry à Bellegarde sur Valserine
Mardi 15 novembre
8h30-9h : accueil
9h – 10h30 : Sports, corps régimes totalitaires et autoritaires.
La préoccupation d’un corps sain, vigoureux et rompu à l’exercice physique est un héritage du XIX
e
siècle.
Toutefois, ce sont les régimes totalitaires qui ont mis en place les premières vraies politiques sportives.
L’homme nouveau fasciste, nazi ou soviétique est donc aussi et d’abord un « homo sportivus ». Associant
pratique de masse et promotion de l’élitisme athlétique, ces politiques ont autant visé une révolution
anthropologique qu’une subversion de l’internationalisme sportif. La promotion du corps totalitaire a non
seulement inspiré les régimes autoritaires comme l’État français, elle a aussi suscité des réponses
démocratiques comme celle du Front populaire.
Par Paul Dietschy, historien et professeur à l’Université de Franche-Comté
10h45 – 12h : Sport et guerre froide culturelle: une approche états-unienne des boycotts
olympiques
Le sport durant la Guerre froide s’inscrit dans une lutte des représentations entre l’’Ouest et l’Est, marquée
par la rivalité entre le système professionnel, privé d’une part et le sport d’état de l’autre. Les États-Unis
vont s’engager dans une transformation de leurs institutions sportives dès la présidence Kennedy et ce, afin
de garantir leur victoire sportive dans la Guerre froide. En plus de questionner la place spécifique des Jeux
olympiques dans ce processus, nous nous pencherons sur les conséquences des mesures prises ainsi que sur
l’apolitisme théorique face aux agents de ce changement ? Entre 1976 et 1984 l’ébauche d’une « révolution
managériale » s’exprime indirectement au travers des boycotts olympiques et affiche les contours d’une
nouvelle donne perceptible tant dans le sport que dans la politique internationale.
Par Jérôme Gygax, docteur en relations internationales de l’Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID, Genève), historien et chercheur associé à la
fondation Pierre du Bois pour l’histoire du temps présent
12h – 12h30 : Transpositions pédagogiques :
Les stades, une architecture au service des
totalitarismes
Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, enseignants en Histoire-Géographie et professeurs-
relais au CHRD, Daniel Legrand-Bascobert, professeur d’Éducation physique et sportive à la
CSI et Franck Flacheron, professeur d’Éducation physique et sportive au lycée polyvalent
Antoine de St Exupéry à Bellegarde sur Valserine
12h30 – 14h : pause déjeuner

14h – 15h30 : Sport et propagande aux Jeux olympiques de Berlin à partir d’extraits du
film
Olympia
de Leni Riefenstahl (1938)
Les jeux olympiques de Berlin en 1936 furent une grande opération de propagande menée par le III
e
Reich.
Le film Olympia, réalisé par Leni Riefenstahl est devenu le symbole de ces Jeux. L’extraordinaire nouveauté
des images, la qualité des prises de vues, la perfection du montage ont fait de ce film le paradigme de tout
documentaire sportif et l’une des œuvres majeures du XX
e
siècle. Mais cela ne doit pas occulter son dessein
originel, la propagande. Celle-ci est d’autant plus insidieuse qu’elle est dissoute dans le sport. Cette
projection-conférence sera l’occasion d’analyser des extraits de ce film pour démonter ces images, du
prologue très signifiant qui ancre le film dans la tradition antique aux images très célèbres de Jesse Owens
qui participent finalement aussi de la propagande.
Par Jérôme Bimbenet, historien du cinéma, chercheur associé à l'Institut d’Histoire du temps
présent-CNRS et auteur de l’ouvrage Quand la cinéaste d'Hitler fascinait la France : Leni Riefenstahl
(Lavauzelle, 2006) et Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler, Tallandier 2015
15h45 – 16h30 : Transpositions pédagogiques :
Fabrice Romanet, correspondant académique du Mémorial de la Shoah
16h30 – 17h : Conclusion et bilan
Par Valérie Ladigue et Frédéric Fouletier, enseignants en Histoire-Géographie et professeurs-
relais au CHRD
1
/
3
100%