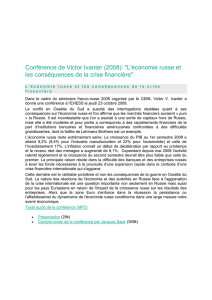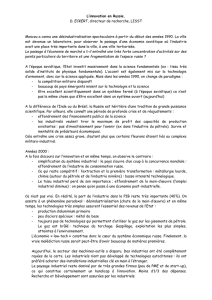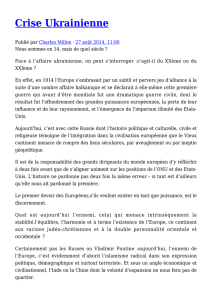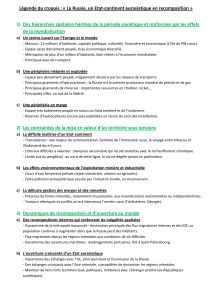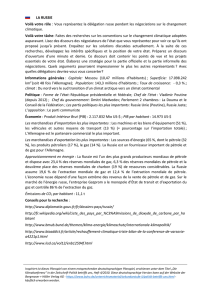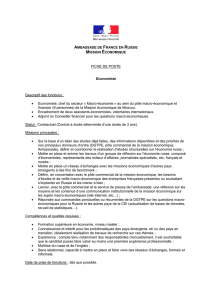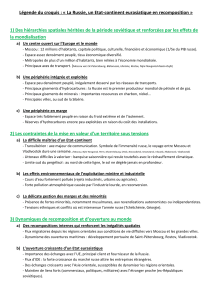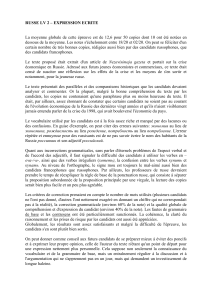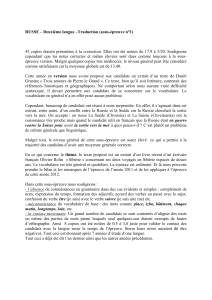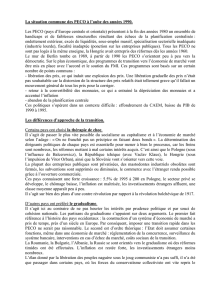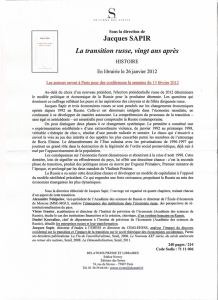20150929-Sur la Russie et sa potentielle place de superpuissance

Entretien Atlantico
Vincent Nahan
Sur la Russie et sa potentielle place de superpuissance aujourd'hui.
Ce Lundi 28 septembre, Barack Obama et Vladimir Poutine se rencontrent à
New-York, dans le cadre d'une réunion à l'ONU. C'est la première fois que les
deux homologues se retrouvent depuis 2 ans et ce sera la première visite de
Poutine à l'ONU en 10 ans. Tandis que les USA assouplissent leur position, ils
se rapprochent de celle prônée par le Kremlin. Faut-il y voir un retour de la
Russie, en tant que leader, sur la scène internationale ?
On ne voit pas bien en quoi les Etats-Unis « assouplissent leur position », ni en quoi
ils auraient été les tenants d’une ligne dure dans la question syrienne. Dès le départ
des événements en Syrie, en mars 2011, et malgré la répression menée par le
régime de Bachar Al-Assad contre les manifestants, Barack Obama s’est tenue à
une certaine distance. Depuis la mise en place de l’Administration Obama, il est
évident que les Etats-Unis ne veulent plus se laisser absorber par un nouveau conflit
dans le « Grand Moyen-Orient », selon l’appellation des années 2000. La priorité
affichée était le retrait en bon ordre d’Irak et d’Afghanistan, et le transfert des
compétences aux autorités locales. L’heure était au « pivot », ou « rebalancing »
vers l’Asie-Pacifique.
Aussi, les efforts de l’Administration Obama dans la question syrienne ont-ils été
principalement diplomatiques, avec pour idée directrice la préparation du « jour
d’après ». Il s’agissait de faire de la Syrie un « anti-Irak » : éviter la déstructuration de
l’Etat syrien et mettre en place un cadre régional destiné à faciliter une éventuelle
transition politique. Cette diplomatie avait un présupposé : la guerre en cours pouvait
être bornée et limitée au cadre géographique syrien. Si la suite des événements a
invalidé ce présupposé, la diplomatie américaine n’a pas fondamentalement changé
son approche. L’acceptation d’un plan de désarmement chimique de l’Etat syrien, en
septembre 2013, en témoigne. L’émergence de l’« Etat islamique » a bien conduit
Obama à mettre en place une coalition, pour mener des opérations aériennes et
appuyer des forces autochtones au sol, mais un engagement terrestre demeure
exclu.
Quant au leadership russe, on peine à en voir les contours. L’activisme diplomatique
russe de l’été dernier n’a rallié aucune puissance sunnite de la région, et les réunions
à Moscou entre d’une part les représentants de Damas, d’autre part ceux de
l’« opposition civile » n’ont rien donné de tangible. Parler de « leadership » russe
relève du discours autoréférentiel : on ne le constate pas sur le terrain. En définitive,
l’envoi d’un mini corps expéditionnaire dans le Nord-Ouest de la Syrie et le
renforcement de l’alliance avec le régime iranien sanctionnent l’échec des tentatives
diplomatiques. Le régime de Bachar Al-Assad, dont les forces s’épuisent, est le seul
garant des intérêts stratégiques russes sur les côtes syriennes. Il faut donc lui sauver
la mise. La rhétorique est grandiloquente mais les objectifs politico-stratégiques de
cet engagement militaire sont limités : la sanctuarisation de Tartous, de Lattaquié et
du « réduit alaouite ». Pour ce faire, l’axe Moscou-Damas-Téhéran, complété par le
Hezbollah, est renforcé. Ce front russo-chiite ne saurait constituer la base d’un

quelconque leadership russe dans un Moyen-Orient très majoritairement sunnite. Il
aura même des effets inverses.
La Russie de Vladimir Poutine est présente sur plusieurs dossiers
internationaux, de l'Iran à la Syrie. De quelle capacité de nuisance dispose-t-
elle aujourd'hui ? Peut-on décemment parler d'acteur incontournable ?
Le fait même de parler de « capacité de nuisance » est significatif : un acteur
hégémonique, à même de jouer le rôle de leader, doit être capable de rassembler les
volontés et les énergies. Pour ce faire, il ne peut jouer de son seul pouvoir de
nuisance. Dans la question du nucléaire iranien, on ne peut exclure que Vladimir
Poutine ait été tenté de jouer de son pouvoir de nuisance. L’embargo international
qui frappe l’Iran a jusqu’alors assuré à la Russie une rente de situation économique
et géopolitique, mais l’accord sur le nucléaire iranien (14 juillet 2015) modifie la
donne. Par ailleurs, le retour du pétrole iranien sur le marché accentuera la baisse
des cours, au grand dam de l’économie russe.
L’annonce à divers moments critiques de plusieurs accords bilatéraux (livraison des
S-300, contrat sur huit réacteurs nucléaires, accord commercial) visait peut-être à
gêner les négociations américano-iraniennes. Du point de vue russe, un Iran pro-
américain ne serait-il pas plus dangereux qu’un Iran nucléarisé ? Pourtant, Moscou a
avalisé l’accord final. La volonté d’aboutir de la Chine et la dépendance renforcée de
la Russie vis-à-vis de Pékin, ainsi que la crainte de l’« Etat islamique » et le besoin
de s’appuyer sur l’Iran pour préserver ses positions régionales, l’ont emporté. On
peut penser que Poutine soutiendra l’idée d’exporter le gaz iranien vers l’Asie du Sud
et de l’Est (projets de gazoduc vers le port iranien de Chabahar et le port pakistanais
de Gwadar ; corridor sino-pakistanais et « nouvelles routes de la Soie »), plutôt que
vers l’Europe où Gazprom cherche à maintenir ses positions commerciales
(la Commission européenne a engagé une procédure pour abus de position
dominante).
Le cas de la Syrie a déjà été abordé. Comme indiqué plus haut, la Russie entend
maintenir ses « actifs » géostratégiques au Proche-Orient et en Méditerranée
orientale (Tartous est le seul point d’appui de la flotte russe dans la région, et ce port
est à mi-chemin des détroits turcs et du canal de Suez). L’engagement militaire russe
auprès de Bachar Al-Assad, fût-il limité, n’est pas le simple exercice, au plan
régional, d’un pouvoir de nuisance. Moscou ne vise pas à contrarier une solution
diplomatique régionale (inexistante en l’état actuel des choses) ou à gêner une
transition politique en cours (nous n’en sommes pas là). La Russie veut, répétons-le,
conserver ses « actifs », et être partie prenante du processus géopolitique. Quant à
la Russie comme acteur clef dans un certain nombre de régions, et sur certaines
questions, il me semble que l’on enfonce des portes ouvertes. Qui a seulement nié la
chose ? Que visait donc la diplomatie Obama, avec le « reset » lancé dès le début
du premier mandat ? Il s’agissait déjà de dégager une plate-forme de coopération
russo-américaine, sur le nucléaire stratégique, la contre-prolifération et la crise
nucléaire iranienne. L’idée d’une Amérique obsédée par la relégation de la Russie
est fantasmatique : elle ne correspond pas à la réalité. En revanche, Obama a
certainement sous-estimé la volonté de revanche de Poutine et son révisionnisme
géopolitique.

S'agit-il uniquement d'une capacité de nuisance ? Dans quelle mesure la
Russie est-elle capable de débloquer des situations complexes et de faire
avancer les choses (particulièrement à la lumière de la position des USA à son
égard) ?
Je ne vois pas véritablement quelles « situations complexes » que la Russie pourrait
contribuer à dénouer. Dans l’affaire iranienne, le rôle de Moscou était secondaire et
son pouvoir était surtout celui gâcher la négociation (le « pouvoir de nuisance »
évoqué plus haut). Quand bien même Poutine eût voulu exercer un tel pouvoir, il lui
aurait fallu prendre en compte la position de la Chine, dont il cherche à se rapprocher
(sans grand succès in fine), et préserver sa quasi-alliance avec l’Iran. Téhéran est un
allié régional de la Russie, sur un certain nombre de questions géopolitiques à tout le
moins, mais certainement pas un subordonné. Moscou doit prendre en compte les
intérêts de cet allié. C’est d’ailleurs le cas dans l’engagement militaire en Syrie. La
zone géographique couverte par Moscou en Syrie correspond aux positions
géostratégiques russes (ports et littoraux de Syrie), aux intérêts vitaux du régime de
Bachar Al-Assad (le « réduit alaouite »), et elle couvre le Liban-Sud (voir les positions
du Hezbollah, dont les milices sont engagées en Syrie même).
Si l’on prend en compte d’autres « situations complexes », comme l’Ukraine
(Donbass, Crimée), et les conflits dits « gelés » dans l’espace post-soviétique (la
Transnistrie en Moldavie ; l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud en Géorgie), la Russie n’est
pas une puissance arbitrale, ou un tiers pacificateur. Elle est partie prenante de ces
conflits, et même en situation d’agresseur. Les « conflits gelés » ont été manipulés
par Moscou pour consolider ses positions sur place et installer dans les esprits l’idée
d’un démembrement inéluctable, en attendant de revenir en force ou de saisir des
opportunités. Si l’on se reporte au Donbass, le scénario qui s’installe est celui d’un
nouveau conflit gelé qui, du point de vue de Moscou, permettrait de consolider ses
acquis et de disposer d’un levier de pression sur Kiev. En attendant, la
« désescalade » dans le Donbass et le thème d’une grande alliance contre l’« Etat
islamique » sont utilisé pour faire accepter de manière implicite le rattachement manu
militaride la Crimée à la Russie. La ficelle est grosse.
Plus généralement, l’idée selon laquelle la Russie serait capable de dénouer des
« situations complexes » repose sur l’hypothèse selon laquelle elle y serait encline.
Or, depuis la saisie de la Crimée et la guerre au Donbass, il est évident que la
Russie est une puissance révisionniste, un « Etat perturbateur » pour citer l’amiral
Castex. Elle est prête à employer les armes pour modifier par la force les frontières,
et ce non pas sur un théâtre périphérique, mais au cœur de l’Europe. Et les
dirigeants politiques russes n’hésitent pas à dresser un parallèle entre l’« Europe de
Versailles », celle de l’entre-deux-guerres, et l’Europe post-Guerre froide. Cette
posture géopolitique explique que les différents Etats européens, membres de
l’Union européenne et de l’OTAN, aient fait bloc. La menace russe sur la paix en
Europe n’exclut pas certaines convergences tactiques sur d’autres théâtres, mais la
prudence est de rigueur, et toute relation de confiance est exclue.
Si Vladimir Poutine détient les clefs du conflit syrien, cela fait-il de la Russie
une superpuissance comparable aux Etats-Unis ? Militairement, la Russie peut-
elle rivaliser ?

Poutine ne détient pas les clefs de ce conflit. Comment peut-on croire cela ?
L’engagement militaire russe est très limité, et il a des objectifs réduits (voir plus
haut). Il faudrait déployer bien plus d’hommes pour peser de manière décisive dans
l’issue de cette guerre ; lors de la seconde guerre de Tchétchénie, la Russie a
engagé jusqu’à 100.000 hommes, et il a fallu ensuite déléguer le maintien de l’ordre
à Ramzan Kadyrov et ses sicaires, moyennant le versement de subsides. Au vrai, la
tutelle russe sur cet « étranger intérieur » (Tchétchénie et Caucase du Nord) est
lointaine. Faut-il aussi rappeler l’engagement soviétique en Afghanistan, après avoir
soutenu un coup d’Etat sur place, et les conséquences de cette guerre sur le devenir
de l’URSS ?
Si la Russie veut éviter pareille mésaventure, il lui faudra limiter son engagement
militaire, et ne pas se laisser « aspirer » par le théâtre des opérations. Du reste,
l’armée russe aurait beaucoup de difficultés à projeter le niveau de forces et de
puissance qui seraient requis par un engagement plus important, sans parler des
possibles conséquences sur l’opinion publique russe. Il semble que la Russie
cherche plutôt à sauver la « Syrie utile » et s’inscrive dans une logique de partition,
mais le renforcement du front russo-chiite en Syrie pourrait aussi galvaniser les
différents groupes armés en guerre contre Bachar Al-Assad et provoquer leur
regroupement. On peut douter qu’ils se satisfassent de cette partition et renoncent à
attaquer le « réduit alaouite ». Dans cette guerre, le « conflit gelé » et la simple
préservation par la Russie de ses acquis ne sont pas l’issue la plus probable. Le
conflit peut encore monter aux extrêmes.
La Russie, « superpuissance » comparable aux Etats-Unis ? Nous ne sommes pas
sur les mêmes ordres de grandeur. Sur le plan militaire, Moscou mène un réel effort
de réarmement et le budget militaire russe est le troisième au monde, mais très loin
derrière les Etats-Unis ou même la Chine. Son outil militaire lui permet de peser sur
les destinées des pays voisins, mais la projection de forces en Syrie constitue déjà
un défi militaire. Le niveau n’est comparable que dans le domaine des armes
nucléaires stratégiques, d’où l’importance accordée par la diplomatie et la doctrine
militaire russes à ce type d’armes : les négociations nucléaires permettent à Moscou
de se poser en alter ego de Washington (voir le traité dit « post-Start », ou « Start
III », signé en 2010). Pourtant, les armes nucléaires relèvent de la dissuasion et ne
peuvent être mises au service d’une stratégie d’action. Cela dit, Poutine s’est livré à
des gesticulations nucléaires lorsque l’armée russe a pris le contrôle de la Crimée.
Le fait est inquiétant.
La crise du pétrole et les sanctions économiques imposées par l'Occident à la
Russie fragilisent sensiblement son économie. L'appui de pays comme ceux
des BRICS est-il suffisant pour solidifier l'économie Russe et en faire une
puissance économique internationale plutôt que régionale ?
Le BRICS est un forum diplomatico-économique dont la « marque » est utilisée par la
Russie afin de se surélever sur la scène internationale. Ce n’est pas une alliance
politico-militaire, moins encore un bloc de puissance unifié. Ce groupe est très
hétérogène, y compris sur le plan économique. Si l’on prend l’économie russe, c’est
une sorte de capitalisme d’Etat, une « économie de commande », basée sur
l’exportation de produits bruts (pétrole et gaz principalement). La formidable hausse
des cours du pétrole dans les années 2000 n’a pas été utilisée pour franchir de

nouveaux seuils technico-économiques (le régime repose sur le partage de la rente
énergétique entre les clans qui gravitent autour du Kremlin). Aujourd’hui, ce modèle
de puissance est en panne, et la conjoncture économique révèle toutes les fragilités
internes de la Russie.
Exception faite de l’Inde, qui souffre par ailleurs d’un important retard, les autres
économies des BRICS traversent aussi une période difficile. La Chine elle-même est
entrée dans une période de difficultés qui ne sont pas simplement conjoncturelles, et
nombre d’économistes doutent de la vérité des statistiques délivrées par les autorités
de Pékin. Le néo-maoïsme affiché par l’actuel président chinois n’est pas favorable à
la mise en œuvre de réformes libérales, pourtant indispensables pour rénover le
modèle économique. Quant au Brésil, la situation politique et économique est
déplorable. Enfin, la présence de l’Afrique du Sud visait surtout à donner une allure
tricontinentale à ce bizarre attelage. En somme, l’illusion se dissipe.
Après les sanctions qui ont suivi l’annexion de la Crimée et le début de la guerre au
Donbass, Poutine a présenté la Chine comme la grande alternative géopolitique à
l’Occident. Effets d’annonce et mise en scène de contrats énergétiques sino-russes
étaient censés annoncer la recomposition des équilibres de puissance au niveau
mondial. In fine, il n’en est rien. Les « contrats du siècle » sont autrement plus
modestes qu’annoncés, voire incertains (voir la négociation en cours du gazoduc
« Force de Sibérie », inachevée en fait, et le projet de gazoduc « Altaï », qui laisse la
Chien indifférente). Les neuf dixièmes du pétrole et du gaz russes sont extraits de
Sibérie occidentale et destinés au marché européen, sans réelle possibilité de
bascule vers la Chine et l’Asie-Pacifique. Un an après la mise en œuvre des
sanctions, la Russie s’est bien gardée de couper le gaz à destination de l’Europe, sa
principale source de devises. Pourtant, nombreux étaient ceux qui, bravement,
expliquaient, qu’il fallait passer sous les fourches caudines de la Russie, ou grelotter
tout l’hiver. Quant au Turkish Stream, présenté par les nouveaux moscoutaires
comme un coup de maître, il est reporté aux calendes grecques.
Jean-Sylvestre Mongrenier
Chercheur associé à l’Institut Thomas More
1
/
5
100%