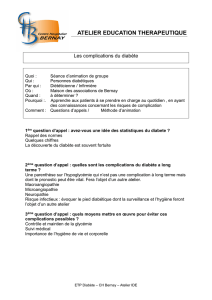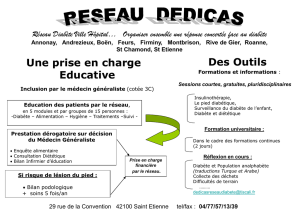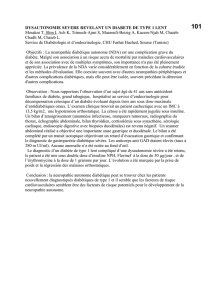groupe d`experts

RAPPORT
Le diabète est une maladie chronique causée par
une production inadéquate de l’insuline, une hormone
secrétée par le pancréas. Ceci entraîne une augmen-
tation du taux de sucre dans le sang et peut générer,
entre autres, des problèmes aux reins, au système
nerveux, des maladies cardio vas culaires, peut causer
la cécité et nécessiter l’amputation d’un membre. Il
existe deux types principaux de diabète : le diabète
de type 1, qui touche surtout les jeunes, et le diabète
de type 2, dont l’apparition des symptômes est plus
fréquente chez les plus de 40 ans. Il faut aussi souligner
le diabète gestationnel.
La progression de la maladie au Québec est telle qu’il
faut absolument améliorer les actions à tous les niveaux,
tant dans la prévention du diabète que dans les soins et
les traitements aux personnes diabétiques. Diabète Québec
a donc demandé à un groupe d’experts de réviser l’en-
semble de la situation du diabète au Québec et de pro-
poser des recommandations pouvant rendre la lutte au
diabète plus efficace et performante et pouvant offrir les
meilleurs services et traitements aux personnes qui en
souffrent.
Les objectifs visés sont de réduire la prévalence et l’inci-
dence du diabèteet d’en diminuer les impacts. Pour y arriver,
les experts prônent l’adoption et le financement adéquat
d’une stratégie pour lutter contre le diabète et de privilégier
un continuum d’intervention à tous les niveaux, de la pré-
vention aux services tertiaires.
DU DIABÈTE AU QUÉBEC
DU GROUPE D’EXPERTS
SUR LA SITUATION
2009
L’équipe interdisciplinaire de l’Unité de jour du diabète du CHUM Hôtel-Dieu :
Première rangée : Françoise Desrochers, infirmière;
Michel Courchesne, patient diabétique; Cynthia Turcotte, psychologue.
Deuxième rangée : Charles Tourigny, psychologue;
Michelle Messier, diététiste; Stéphanie Chanel-Lefort, secrétaire.
Troisième rangée : Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue.
Photo : Marcel La Haye

2
Malgré la situation au Québec, on s’étonne
de constater combien il est difficile de mo-
biliser l’ensemble des acteurs concernés par
la problématique du diabète. Nous pensons
que cela est dû notamment à l’absence
d’une réelle stratégie de lutte et de
contrôle du diabète et à l’éparpillement
des efforts à travers d’autres probléma-
tiques de santé.
À titre d’exemple, depuis 2008, l’Ontario
a choisi d’investir 741 millions $ sur quatre
ans pour le diabète. Ces investissements
sont ciblés : 40 % pour l’accroissement
des soins fournis par des équipes interdisciplinaires, 30 % pour
l’amélioration des services pour les maladies du rein (néphropa-
thie), 20 % pour la création d’un registre du diabète, etc. Si le
Québec choisissait cette avenue, il devrait alors investir environ
100 millions $ par an, pendant la même période. Nous pensons
que le ministère de la Santé, les Agences régionales et les CSSS
devraient s’en inspirer et investir pour le diabète en protégeant
ces montants, afin qu’il ne soit pas possible de les déplacer vers
d’autres problèmes de santé.
En Angleterre, là aussi les budgets pour le diabète sont protégés.
Par exemple, un programme national du suivi de la rétinopathie
est en place depuis trois ans. Les personnes diabétiques sont
donc appelées à un examen annuel de la rétine. Au Québec, un
rapport de l’AETMIS soumis au ministre de la Santé propose le
suivi systématique des patients diabétiques afin de réduire les
conséquences de la rétinopathie.
Le groupe d’experts est d’avis qu’il est urgent de doter le Qué-
bec d’une stratégie globale en diabète.
Au Québec, on estime à plus de 930 000 le nombre de personnes
prédiabétiques et diabétiques, soit environ 15 % de la population.
À l’heure actuelle, quelque 35 000 nouveaux cas sont diagnosti-
qués, par an.
• La prévalence du diabète (cas connus) est de 7% chez
les 20 ans et plus.
• Une personne sur huit va devenir diabétique.
Deux raisons principales expliquent ce phénomène : il y a d’abord
le vieillissement de la population, qui a un effet sur l’augmentation
de la prévalence de la maladie et il y a les changements dans les
habitudes de vie (alimentation trop abondante et non équilibrée
et sédentarité) qui entraînent une recrudescence de l’embonpoint
et de l’obésité.
On observe une apparition de plus en plus précoce du diabète
de type 2. Auparavant, la maladie apparaissait surtout dans la
soixantaine, maintenant, c’est dans la quarantaine. C’est pour
cette raison que depuis 2003, les lignes directrices canadiennes
recommandent aux personnes d’avoir un test de dépistage à par-
tir de 40 ans. Malgré cela, nous savons qu’entre 30 et 40 % des
diabétiques de type 2 ne sont pas diagnostiqués. C’est souvent
lors d’une première complication résultant du diabète que la
condition est diagnostiquée. Il n’est donc pas rare de trouver un
diabète suite à un premier accident vasculaire, cardiaque ou
autre. Ces personnes non diagnostiquées vivront en hyperglycé-
mie pendant plusieurs années avec toutes les conséquences que
cela entraîne.
Deux autres phénomènes relativement récents viennent assombrir
ce tableau. On remarque une forte augmentation du diabète de
grossesse dans les hôpitaux qui desservent des populations «à
risque de diabète» (origine amérindienne, afro-américaine, asia-
tique ou latino-américaine). Du tiers à la moitié des femmes qui
font ce type de diabète seront dans l’avenir diabétiques de type 2.
Malheureusement, on constate que le diabète de type 2 apparaît
maintenant même chez les enfants et les adolescents. Dans cer-
taines cliniques pédiatriques desservant des communautés à risque,
le nombre de jeunes atteints d’un diabète de type 2 est alarmant.
Les patients diabétiques utilisent plus de services médicaux et sont
plus susceptibles de développer des complications comme des
problèmes cardiovasculaires, rénaux, ophtalmologiques et neuro-
logiques si leur maladie n’est pas bien contrôlée. Une personne
diabétique ne présentant aucune complication coûte de 10 à15 fois
moins cher en traitements qu’une personne présentant des com-
plications. On estime que le diabète coûte plus de deux milliards $
par année au réseau de la santé québécois, sans compter les coûts
indirects estimés à un autre milliard.
Par ailleurs, la situation du diabète de type 1 est tout aussi préoc-
cupante, puisque l’on rapporte une croissance de l’incidence de
3% par année.
Compte tenu de la situation du diabète, nous pensons que le mo-
ment est venu de réaliser une étude épidémiologique en profon-
deur incluant la prévalence, l’incidence, les complications du
diabète et les hospitalisations, à l’instar de ce qui se fait en Ontario
et en Grande-Bretagne
UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DU DIABÈTE
La situation du diabèteau Québec : l’épidémie est en cours

3
1. Prévention primordiale / enfants,
adolescents et jeunes adultes
Axe principal : Travailler à la modification des modes de vie
en favorisant l’adoption de comportements plus sains en ac-
cord avec les programmes nationaux de Santé publique,
comme décrit dans le plan d’action gouvernemental 2006-
2012
Investir dans l’avenir
.
Les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité sont clai-
rement les causes premières de la montée du diabète de type
2 dans les sociétés occidentales. Une nourriture riche en sucres,
en matières grasses et en calories favorise l’obésité. Combiné à
la sédentarité, cela peut conduire à l’intolérance au glucose, qui
est fréquemment l’antichambre du diabète de type 2.
La promotion de comportements plus sains en particulier au-
près des jeunes et dans les milieux qu’ils fréquentent est la
base de l’action pour diminuer avec succès la prévalence du
diabète. Les parents et les milieux scolaires en sont les pre-
miers responsables, tout comme les jeunes eux-mêmes.
Malheureusement, la promotion de modes de vie et de com-
portements plus sains est une tâche ardue, dont les résultats
se feront sentir graduellement, sur une longue période de
temps. Trop de personnes y arrivent difficilement.
LE CONTINUUM D’ACTIONS ET DE SERVICES
Légende: (
Í
) = moins concerné ou nécessaire; (
È
) = plus concerné ou nécessaire.
Diminuer la prévalence et l’incidence du diabète
Prévention
primordiale
Prévention
primaire
Prévention
secondaire
Services tertiaires
Population cible
Enfants, adolescents
et jeunes adultes
Personnes à risque
Personnes
diagnostiquées
Diabétiques avec
complications
Objectifs
Baisse de l’obésité
Baisse de l’incidence
du diabète
Baisse de l’apparition
des complications
et de la morbidité
Baisse de la
mortalité et
morbidité
Accès identification
Dépistage du diabète
+ prédiabète
Dépistage /
Traitement des
complications
Stratification
Risques
Accès intervention
Mode de vie
Mode de vie (È)
Traitements (Í)
Mode de vie (È)
Traitements (È)
Soins spécialisés
Traitements
Mode de vie
Intervenants
Parents
Écoles
Société
Omnipraticiens (È)
Équipe
interdisciplinaire
Omnipraticiens
Spécialistes (Í)
Équipe
interdisciplinaire (È)
Omnipraticiens
Spécialistes (È)
Équipe
interdisciplinaire (È)
L’équipe interdisciplinaire du Centre de jour
de diabétologie de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont :
de gauche à droite : Manon Sarrazin, infirmière clinicienne;
Monique Bernard, infirmière clinicienne; Céline Durocher, diététiste;
Dr Daniel Caron, endocrinologue; Isabelle Tremblay, pharmacienne ;
Stéphane Tardif, infirmier clinicien; Pascale Therrien, pharmacienne;
Myrlande Derose, agente administrative
Photo : Service des techniques audio-visuelles de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

4
Recommandations
■
Investir massivement dans des interventions de promo-
tion de la santé de manière à entraîner graduellement
l’adoption d’habitudes de vie plus saines au sein de la
population.
■
Financer adéquatement les interventions directes pour
réduire l’obésité des jeunes (mesure de poids) et en
réduire la prévalence.
■
Appliquer les conclusions du Congrès international de
l’obésité (automne 2008).
■
Promouvoir des approches de santé publique (promo-
tion de la santé – saines habitudes de vie) en s’arrimant
aux programmes actuels de santé publique (Investir dans
l’avenir).
■
Impliquer davantage les intervenants en pédiatrie.
2. Prévention primaire / clientèles à risque
Axe principal: Réduire l’incidence du diabète par le dépis-
tage précoce du prédiabète et du diabète, en ciblant les
populations à risque.
Trop souvent, le diagnostic de la maladie se fait tardivement
alors que des complications sont déjà apparues. Un patient
est diabétique depuis sept années, en moyenne, avant d’en
connaître le diagnostic. Selon les plus récentes lignes direc-
trices de dépistage et de traitement, toute personne de
40 ans et plus devrait faire analyser sa glycémie à tous les
trois ans. Les personnes à risque devraient s’y soumettre plus
tôt et plus fréquemment. La prévention et le dépistage du
diabète de type 2 doivent faire partie des priorités des pro-
fessionnels de la santé et des décideurs publics.
Pour raccourcir réellement le temps durant lequel la per-
sonne diabétique ignore son état, nous devrions aussi cibler
les personnes en phase de prédiabète (glycémie à jeun anor-
malement élevée, entre 5,6 et 6,9 mmol/L, ou intolérance au
glucose, glycémie située entre 7,8 et 11,1 mmol/L après 75 g
de surcharge glucidique, ou les deux en même temps) ou qui
présentent un syndrome métabolique ou un risque cardio-
métabolique (une constellation d’anomalies du métabolisme
dont l’obésité abdominale, des anomalies des lipides, l’hy-
pertension, la résistance à l’insuline et autres).
Évidemment, convaincre la personne qui présente un risque
de diabète qu’elle doit changer ses habitudes de vie et ap-
puyer cette personne dans ses efforts pour se prendre en
mains demeurent le point central d’action pour diminuer l’in-
cidence du diabète.
Si les intervenants de la première ligne mé-
dicale (omnipraticiens, cliniques, centres de
santé et de services sociaux, etc.) sont les
principaux acteurs de la prévention primaire,
encore faut-il que l’accès aux services soit
possible. Or, cela n’est pas toujours le cas. Par
exemple, selon certaines informations, entre
30 % et 40 % de la population québécoise n’a
pas de médecin de famille. Il est courant qu’un
patient doive attendre plus de six mois avant
d’obtenir un rendez-vous avec un médecin
omnipraticien, ce délai pouvant atteindre neuf
mois dans le cas d’un médecin spécialiste, voire
même 12 mois et plus dans la grande région de
Montréal. Le délai d’attente pour consulter cer-
taines ressources professionnelles, comme une
diététiste, est également long et tout aussi inac-
ceptable. Au moins 15 % des personnes diagnos-
tiquées diabétiques n’ont pas de médecin.
Priorités d’action
■
Créer un guichet unique par territoire de CSSS (incluant
les cliniques réseau, les GMF, les GMS ainsi que les autres
intervenants de 1
re
ligne : ex. infirmières, pharmaciens,
optométristes, diététistes, kinésiologues, etc.)de manière à:
• assurer l’accès à un médecin de famille et aux
ressources interdisciplinaires;
• instaurer un filet de sauvetage pour les prédiabé-
tiques et les diabétiques qui n’ont pas de médecin
de famille (orphelins).
■
Offrir un plus grand accès à l’information sur le diabète
afin de miser sur la motivation et la responsabilisation de
la personne diabétique (ex. les centres d’enseignement).
Autres recommandations
■
Accroître l’enseignement médical continu (dépistage,
prévention et enseignement).
■
Créer des programmes structurés d’intervention visant
les modification des modes de vie avec évaluation des
indicateurs pertinents (tour de taille, A1c, incidence de
diabète et poids, etc.) et soutenir et bonifier les pro-
grammes existants offerts dans les CSSS, dans les GMF
et les cliniques médicales, supportés par des équipes
interdisciplinaires, etc.
■
Faciliter l’accès aux tests de dépistage chez les personnes
à risque afin d’améliorer le contrôle et la surveillance
du diabète.

5
Diminuer les conséquences
du diabète
3.Prévention secondaire /
personnes diabétiques
Axe principal: Diminuer les risques de com-
plications liées au diabète, notamment par
le dépistage précoce (identification,
contrôle et intervention visant à modifier
les modes de vie (comportements).
Des cibles précises de traitement, établies
par des experts en fonction des nouvelles
données cliniques disponibles, ont été
publiées en 2008 par l’Association cana-
dienne du diabète. Mais il ne suffit pas
de s’approcher des cibles désirées, en-
core faut-il les atteindre et même, idéalement, les dé-
passer pour obtenir des bénéfices réels sur la santé et le
bien-être à court et à long terme. Chaque patient devrait
connaître et comprendre ses cibles de traitement. Il est de la
responsabilité des différents professionnels de la santé im-
pliqués dans le traitement du diabète de les communiquer
aux patients le plus clairement possible. Il faut ajuster le trai-
tement lorsque les cibles ne sont pas atteintes. Malheureu-
sement, la grande majorité des patients diabétiques
québécois n’atteignent pas les cibles de traitement.
Une étude récente faite auprès des médecins de famille,
l’étude DICE (Diabetes In Canada Evaluation), a montré que
le diabète était de moins en moins contrôlé suivant la durée
de la maladie. Alors que 70% des personnes diagnostiquées
depuis moins de cinq ans arrivent à atteindre un bon contrôle
glycémique, ce pourcentage tombe à 40 % après 10 ans. La
fréquence des complications micro et macrovasculaires aura
triplé pendant la même période.
Par ailleurs, en prévention secondaire, le dépistage précoce
demeure essentiel. Dès lors, il est fondamental d’accorder
une grande importance à l’intervention interdisciplinaire cen-
trée sur la modification des habitudes de vie de la personne
et le suivi rigoureux de la progression de la maladie.
L’enseignement aux patients
En fait, les patients connaissent peu leur maladie et bon nom-
bre d’entre eux négligent les recommandations de leurs mé-
decins. Le diabète est asymptomatique, évolue sour noi sement
et, souvent, les personnes atteintes tendent à relâcher leurs
efforts. Les centres d’enseignement pour patients diabétiques
disposent de ressources très limitées et ne peuvent pas répondre
à la demande, particulièrement dans les grands centres urbains
et en régions éloignées. L’enseignement aux personnes prédia-
bétiques et diabétiques, surtout pour le diabète de type 2, est
pourtant la clef de la responsabilisation individuelle (autono-
misation ou empowerment) à l’égard de sa maladie. Seulement
une personne sur dix en bénéficie,la plupart du temps à la suite
de complications, non pas en prévention.
Là encore, l’accès aux ressources médicales et interdiscipli-
naires reste difficile et devrait être amélioré si l’on veut ob-
tenir des résultats significatifs.
L’accès aux médicaments
Le choix des médicaments est encore fort limité pour le dia-
bète, contrairement à plusieurs autres maladies. Les médica-
ments pour le diabète sont souvent contraints à des critères
très stricts ou sont carrément refusés. En fait, il semble per-
sister une certaine incompréhension à l’égard de la nature et
de la qualité des traitements dont ont besoin les personnes
diabétiques, alors qu’elles auront à vivre plusieurs années
avec la maladie. Les nouveaux médicaments répondent à des
besoins spécifiques et ils apportent une approche novatrice
à des situations que ne peuvent pas toujours contrôler les
médicaments classiques.
L’accès inadéquat à tous les traitements médicamenteux
constitue un frein important à l’atteinte des objectifs de trai-
tement. Contrairement aux patients atteints d’hypertension
ou d’autres maladies cardiovasculaires, les patients diabé-
tiques n’ont pas accès aussi facilement aux deuxièmes et troi-
sièmes lignes de traitement. Des restrictions d’utilisation sont
appliquées à presque 100 % des nouveaux traitements dispo-
nibles. Selon les guides de traitement de l’Association cana-
dienne du diabète, les nouveaux traitements, comme les
sulfonylurées de 2
e
génération, les thiazolidinediones et les
incrétines soumis aux restrictions d’utilisation, devraient êtres
utilisés plus tôt dans le traitement des patients.
Cette situation est particulièrement discriminatoire quand on
sait que la majorité des patients atteints d’autres maladies
chroniques ont pleinement accès à leurs traitements recom-
mandés. Le fait qu’aucun médicament pour le diabète ne soit
apparu sur le marché durant les premières années du Régime
d’assurance médicament, alors que l’acceptation des nou-
veaux médicaments était plus généralisée, explique sans
doute cette situation. En effet, au lieu de comparer les nou-
veaux médicaments à des médicaments apparus dans les an-
nées 1990, le prix de ces derniers est strictement comparé
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%