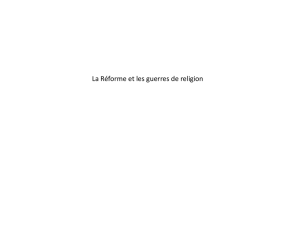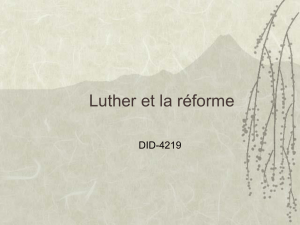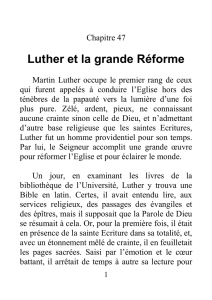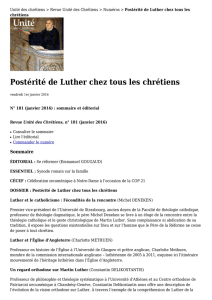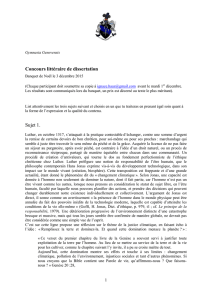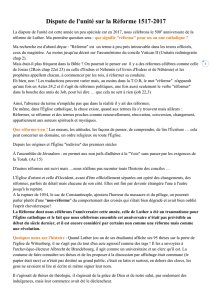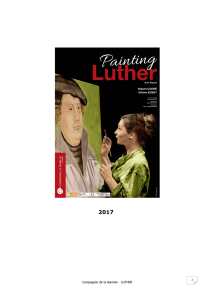Klaus Unterburger, Unter dem Gegensatz

Francia-Recensio 2016/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)
Klaus Unterburger, Unter dem Gegensatz verborgen. Tradition und Innovation
in der Auseinandersetzung des jungen Martin Luther mit seinen theologischen
Gegnern, Münster (Aschendorff) 2015, 155 S. (Katholisches Leben und
Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 74), ISBN 978-3-402-11092-8,
EUR 24,80.
rezensiert von/compte rendu rédigé par
Marc Lienhard, Strasbourg
L’auteur est attentif aux liens établis à travers les siècles entre les identités catholique et protestante
et le regard porté sur Luther. Il plaide pour une approche historique et non confessionnelle. D’après
lui, il ne faut ni enfermer Luther dans les limites confessionnelles du protestantisme ni dans la
perception négative qu’en a eue très longtemps le catholicisme.
Pour fonder sa démarche, l’auteur procède en cinq étapes. Dans une première partie de l’ouvrage, il
présente ce qu’il appelle une image catholique problématique de Luther. Il évoque la démonisation de
Luther, qui va de Cochläus au XVIe siècle jusqu’à des approches contemporaines comme celle de
Denifle. Mais, sous l’influence des Lumières et d’une méthode plus historique qu’apologétique,
d’autres approches sont apparues qui aboutissent à l’œuvre de Joseph Lortz (1887–1975). Ce dernier
a mis en évidence la démarche proprement religieuse de Luther, sa réaction légitime vis-à-vis d’une
Église romaine défaillante à la fin du XVe siècle, et son combat contre une théologie occamiste que
Joseph Lortz ne considère pas comme catholique. Mais le subjectivisme de Luther aurait pesé sur sa
démarche et l’aurait empêché de percevoir l’objectivité et l’autorité de l’institution ecclésiale. Selon
l’auteur, des concepts tels que »subjectivisme, magistère objectif, nominalisme destructeur« seraient
marqués par la théologie d’après 1918, elle-même influencée par l’ultramontanisme du XIXe siècle.
Lortz a inspiré des historiens catholiques de renom, mais d’autres approches, plus récentes, sont
allées plus loin. Ainsi, dans une thèse monumentale qui comparait la doctrine de la justification chez
Thomas d’Aquin et chez Luther, Otto Hermann Pesch (1931–2014) a mis en évidence une approche
sapientiale et une approche existentielle qui, à ses yeux, n’étaient pas inconciliables. Selon Pesch, les
affirmations théologiques de Luther ont été ressenties comme nouvelles par ses contemporains, mais,
dans une perspective d’aujourd’hui, elles pourraient tout à fait être intégrées dans une approche
catholique. Peter Manns, un autre spécialiste catholique, est allé dans le même sens en estimant que
Luther pouvait être »un père dans la foi« pour les catholiques, en tenant compte de son enracinement
dans le monachisme médiéval et dans l’augustinisme. Pour les deux spécialistes, la rupture avec
l’Église romaine ne serait pas due à la théologie de Luther, mais à l’environnement ecclésial de
l’époque.
Dans une seconde partie, consacrée à l’ecclésiologie et à la christologie du »jeune« (»frühe« en
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

allemand!) Luther, l’auteur relativise les approches de Karl Holl et de Joseph Lortz. Le premier pensait
trouver dans les premiers textes de Luther toute sa théologie réformatrice, le second estimait que les
positions de Luther exprimées dans ces textes étaient encore catholiques. D’après Lortz, on trouve
bien des thèmes centraux dans ces textes qui ont marqué aussi sa théologie ultérieure, tels que la
justification par le Christ seul, la théologie de la croix et la conception du joyeux échange. Il relève
aussi le combat contre Aristote, l’influence d’Augustin sur Luther, en particulier dans la conception de
l’Église. Il souligne que Luther reconnaît le ministère et la hiérarchie ecclésiastiques, mais qu’il affirme
déjà le sacerdoce universel des chrétiens. Il relève les critiques de Luther vis-à-vis de l’Église de son
temps. Ce dernier regrette que l’Église n’appelle pas à une véritable pénitence. L’Église romaine a,
certes, conservé la vraie foi, mais elle erre au niveau des pratiques. Elle ne combat pas assez
l’autojustification et ne prêche pas assez l’humilité et la confiance dans le Christ crucifié.
La troisième partie de l’ouvrage traite du rapport de Luther à Augustin. Y avait-il une école proprement
augustinienne, marquée en particulier par Grégoire de Rimini? Comme l’auteur le rappelle, il n’y a pas
unanimité à ce sujet. Il souligne à la fois la présence des écrits d’Augustin dans l’ordre qui se
réclamait de lui, les nombreuses références à Augustin dans les premiers textes Luther, en particulier
à ses écrits antipélagiens, et la lecture sélective opérée par Luther, puis aussi les différences avec ce
Père de l’Église. Mais Augustin est pour lui un allié précieux pour combattre la théologie scolastique.
L’auteur souligne par ailleurs l’aide que Staupitz a apportée à Luther.
Une quatrième partie traite du ministère doctoral dans l’Église, de l’obéissance exigée par le droit
canon et de l’ecclésiologie. Depuis le XIIIe siècle, on distinguait le ministère doctoral et celui des
prélats (prédicateurs, évêques, etc.). Que faire s’il y avait conflit entre les deux instances? Selon des
théologiens du XIIIe siècle évoqués par l’auteur, l’autorité ecclésiale ne pouvait pas obliger un
théologien à enseigner ce qui était contraire à ce qu’il considérait comme la vérité. Mais les docteurs
devaient se taire plutôt que de désobéir, à moins qu’il s’agisse des mystères du salut.
On retrouve le problème chez Luther. Ce dernier se réfère notamment à la dispute entre les apôtres
Pierre et Paul pour affirmer que Pierre s’était trompé en faisant de la circoncision une condition pour
être membre de l’Église. Paul le théologien le critiquait. De même les théologiens des autres temps
doivent critiquer les prélats s’ils se trompent. C’est ce que fait Luther à partir de 1517. Il estime que la
théorie au sujet des indulgences relève d’une opinion d’école et non pas de la doctrine de l’Église.
Condamné par Rome, il est amené à proclamer que la primauté de la papauté est issue de l’histoire et
n’est pas d’institution divine. Luther critique les décrétales, c’est-à-dire le droit canon, qui ont favorisé
le népotisme et la romanisation de l’Église. Il s’en prend à la confusion entre le droit divin et le droit
humain et se réfère une fois de plus à Augustin pour affirmer que c’est l’Écriture seule qui est l’autorité
dernière. Selon Luther, qui se réfère aux Pères de l’Église, le pouvoir des clefs, évoqué par
Matthieu 16, 18 s. et 18, 17 s., consiste dans l’annonce de l’Évangile qui libère du péché, pouvoir qui
est donné à tous les croyants et pas seulement à Pierre. Le pouvoir des clefs ne doit pas être compris
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

comme pouvoir juridictionnel.
En évoquant le conflit entre Luther et Rome, l’auteur estime que Luther était confronté à un papalisme
extrême qui relativisait l’autorité des conciles. Considérant qu’il avait été excommunié à tort, il estime
se trouver en situation de détresse, situation prévue par certains théologiens médiévaux, qui
envisageaient la possibilité de déposer un pape hérétique ou qui était incapable d’exercer son
ministère. Luther est amené à souligner que le pape, mais aussi le concile, peuvent se tromper.
La cinquième partie de l’ouvrage traite des liens entre l’identité réformatrice et la conception
(Erkenntnis) réformatrice. Il y est question des efforts de Karl Holl et de son école pour montrer qu’on
trouvait déjà dans les premiers cours de Luther une démarche et des affirmations proprement
réformatrices. La mise en cause de cette approche par Lortz a trouvé l’accord de théologiens
protestants tels que Bizer, qui estiment que la percée réformatrice de Luther s’est opérée seulement
en 1518 avec la découverte de la Parole comme moyen de salut et l’opposition de Luther à la
papauté. Mais comment faut-il interpréter le témoignage tardif de Luther de 1545, dans lequel il
évoque sa découverte libératrice de la justice de Dieu selon l’Évangile, comprise comme pardon et
non comme jugement? L’auteur estime que cette conception est déjà plus ou moins attestée par les
premiers textes de Luther. Il critique ensuite l’approche de Bizer qui pense trouver dans ces textes
une humilité inconciliable avec la justification par la foi. Enfin, il souligne que la christologie
proprement réformatrice, exprimée par la conception du joyeux échange entre l’âme et le Christ et une
sotériologie paulinienne, se trouvent déjà dans ces textes.
En conclusion, l’auteur affirme, en opposition à Lortz, que Luther n’était pas un subjectiviste au sens
moderne du terme. L’augustinisme et le droit d’exception en situation de détresse se trouvaient déjà
dans la tradition. Il souligne aussi la pluralité des traditions théologiques à la fin du Moyen Âge et met
en garde contre des approches trop exclusivistes, de type confessionnel, pour comprendre et définir la
démarche de Luther.
On pourra poser des questions et formuler quelques réserves, en soulignant peut-être davantage la
différence entre Luther et Augustin, ou en apportant des compléments, pour relever par exemple
combien l’époque de Luther était partagée entre une valorisation d’Augustin ou de Jérôme. Il n’en
demeure pas moins que cet ouvrage, bien informé des diverses recherches, et à bien des égards
stimulant, constitue un apport précieux à la fois pour une approche historique renouvelée du
phénomène Luther et pour le débat œcuménique.
Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
1
/
3
100%