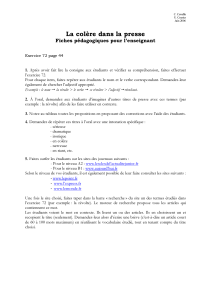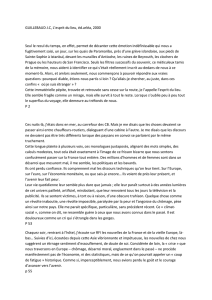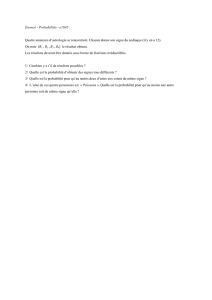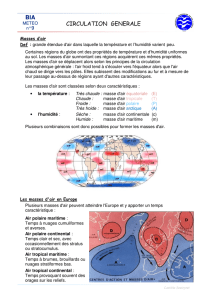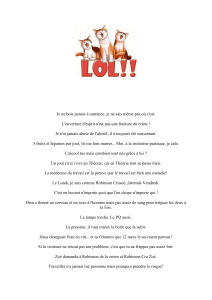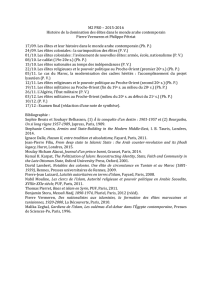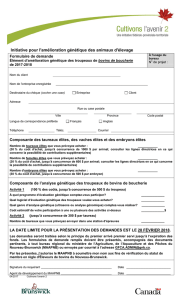Economie politique des performances économiques durant la

Economie politique des performances économiques durant
la Guerre Froide dans les pays en voie de développement∗
Albert Tcheta-Bampa†
Novembre 2012
Abstract
Dans cet article, nous soutenons que les incitations politiques générées par la diversification
économique, les soutiens des puissances mondiales et leur pouvoir d’influence et la capacité des
masses à contester le pouvoir sont les déterminants clés du développement. Nous développons,
tout d’abord, un modèle endogène de choix politique où l’investissement public, la diversification de
l’économie, l’amélioration du potentiel de performance économique globale du pays dotent la société
civile d’un pouvoir qui échappe au contrôle des élites politiques et peut provoquer soit la disparition
de leur régime soit une modification de leur stratégie de survie. Dans le cadre de ce modèle endogène
de changement institutionnel, l’effet de la guerre froide est, ensuite, introduit. Il permet de montrer
que les équilibres nationaux dans les pays en voie de développement ne sont pas indépendants du
soutien des puissances mondiales et de leur capacité à inciter les masses à contester et/ou à soutenir
le pouvoir en place. Sous ces conditions les pays possédant d’importantes ressources naturelles ont
le choix entre diversifier leur économie ou maintenir la dépendance à la ressource.
Codes JEL. D7; H54; O; P3; Q3
Mots Clés: Ressources naturelles; Malédiction des ressources ; Perdants politiques ; Développe-
ment économique; Diversification; Economie politique; Stabilité politique; Guerre froide
∗Nous sommes reconnaissant à tous les participants du séminaire Economie Publique, Institutions et Organ-
isations, en particulier à François Facchini et Mehrdad Vahabi, pour leurs suggestions détaillées. Nous tenons
également à remercier Thierry Verdier et Omar Sene et Zorobabel Bicaba, pour leurs commentaires très utiles.
Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Institution à laquelle
il appartient.
†Centre d’Economie de la Sorbonne- Université Paris1
1

1 Introduction
Alors que la part de régimes non démocratiques (faiblement institutionnalisés) est largement
supérieure à celle des régimes démocratiques (fortement institutionnalisés), les recherches dans
le domaine de la théorie du choix public sont davantage concentrées sur l’analyse des régimes
démocratiques. Plus particulièrement, les théoriciens ont consacré peu d’efforts à l’analyse,
d’une part, du comportement de prédation de l’élite gouvernante des Etats klepto-patrimoniaux
d’Afrique, d’autre part, des moyens qu’ont les populations africaines pour exprimer et influencer
la politique économique dans leurs pays. Toutefois il est évident que, du fait de leur faible niveau
d’institutionnalisation et de leurs disfonctionnements importants, les Etats non démocratiques
sont des candidats privilégiés pour une analyse en termes d’économie politique. La progres-
sion rapide de la littérature portant sur ce sujet depuis la décennie 1990 en témoigne d’ailleurs
largement.
L’analyse dans le domaine de l’économie politique offre maintenant une série de modèles
théoriques et d’applications économétriques qui permettent de mieux comprendre la rationalité
des agents impliqués, inscrits dans un cadre institutionnel déficient. Le rôle de la prédation,
de la corruption, de la répression, dans des pays non démocratiques, trop souvent analysé par
les spécialistes du développement et mis en avant dans la presse comme le facteur principal
déterminant l’échec du développement, notamment en Afrique, a été traité en détail dans nombre
d’études, et en particulier dans celles de Robinson (1997). L’accent est maintenant mis sur les
déterminants endogènes des politiques gouvernementales des pays non démocratiques et de la
longévité de ces régimes politiques.
Dans l’approche de choix publics, Olson (1965, 1982) et Tullock (1974, 1980) constituent la
référence de base de cette littérature. Leurs travaux étendent les hypothèses microéconomiques
standards à d’autres domaines des sciences sociales tels que la politique. Ils intègrent " des con-
flits réels en matière d’analyse économique et fournissent un cadre théorique pour une nouvelle
économie politique " (Vahabi, 2009 p. 4).1Au cours des deux dernières décennies, un grand nom-
bre d’études de la Nouvelle économie politique (NEP) a produit une vaste littérature portant sur
les conflits politiques et d’appropriation sous le nom de "modèles d’instabilité socio-politiques"
1Vahabi, Mehrdad, 2009 "A Critical Review of Strategic Conflict Theory and Socio-political Instability Models"
Revue d’ Economie Politique, Vol. 119, No. 6, 2009.
2

(Drazen, 2000).2Ce programme de recherche considère les conflits réels dans une dimension
clairement politique . Dans son modèle Grossman (1991 et 1995) étudie les problèmes auxquels
doit faire face un gouvernement qui choisit le montant des dépenses militaires qu’il va effectuer
de façon à réduire la probabilité d’être renversé par une insurrection .3Une autre perspective
est ouverte par Azam (1995 et 2001), Robinson (1997 et 2001), Acemoglu et Robinson (2001 et
2005) Bourguignon et Verdier (1997) qui remarquent que le pouvoir en place n’est pas obligé de
recourir seulement aux armes pour demeurer en place, mais qu’il peut aussi utiliser une politique
de redistribution en faveur de son opposant afin de réduire son incitation à prendre les armes.
Varoudakis (1995) suggère que la nature du régime politique non démocratique est susceptible
d’influencer les performances économiques, indépendamment de son instabilité. Les dictatures
prédatrices (contrairement aux dictatures bienveillantes) ont un impact négatif sur la croissance.
Acemoglu, Robinson et Verdier (2004) offrent une analyse complémentaire, qui traite le problème
de cette démarche, dont l’on dit qu’elle cherche à " diviser pour mieux régner ", mise en IJuvre
par les kleptocrates alors qu’ils poursuivaient en parallèle leurs politiques opposées au développe-
ment. Dans la perspective des fondements politiques de la malédiction des ressources naturelles,
Robinson, Torvik et Verdier (2006) soutiennent que l’impact global des expansions de ressources
sur l’économie dépend de façon critique des institutions car celles-ci déterminent les mesures dans
lesquelles les incitations politiques se traduisent dans les résultats des politiques. Dans la lignée
de Robinson (1997 et 2001), Dunning (2005) présente un modèle qui montre que dans les Etats
tributaires des ressources naturelles, les élites peuvent faire face à un important arbitrage entre
les avantages économiques de la diversification et la possible concurrence politique future que
la diversification est susceptible d’engendrer. Cependant, l’autre montre que les caractéristiques
distinctives des marchés mondiaux des ressources et les économies politiques nationales peuvent
rendre la diversification plus ou moins attrayante pour les élites politiques.
2Il existe maintenant une littérature abondante sur les modèles d’économie politique de conflit, des ouvrages
entiers lui ont été consacrés, de nombreuses revues de littérature ont déjà été publiées. Dans sa revue " critique
de la littérature sur la théorie du conflit stratégique et les modèles d’instabilité sociopolitique ", Vahabi Ibid.,
distingue trois types de modélisation de l’instabilité sociopolitique : le modèle d’anticipations rationnelles de la
violence politique, les modèles de prédation, et les modèles de propriété commune. Notre étude est une variante
des modèles de prédations ont de nombreux points communs et les similitudes avec les modèles conflit stratégiques,
notamment en ce qui concerne l’utilisation de la théorie des jeux et l’extension du théorème de Coase (1960) pour
pouvoir coercitif.
3Voir aussi les modèles de Kuran (1989), Skaperdas (1992), Hirshieifer (1995) et Grossman et Kim (1995),
Neary (1997) et Fearon (1995, 2004).
3

Le modèle théorique présenté ici, s’inscrit dans cet héritage et souligne le rôle de la capacité
de rébellion contre les élites qui contrôlent le pouvoir, de la diversification ou du développement
préalable du secteur privé hors ressources naturelles ainsi que la fonction de la collusion des
puissances mondiales (Etats-Unis et l’Union des Républiques Socialistes et Soviétiques) avec les
régimes politiques d’Afrique dans le contexte de la Guerre Froide. Le modèle met en scène un
politicien déjà en poste souhaitant conserver le pouvoir à la place un autre qui pourrait rem-
placer le régime sortant. Nous analysons deux groupes de circonstances. Dans le premier, les
élites acceptent de partager la richesse et d’étendre le droit de propriété en diversifiant l’économie
au lieu de maintenir les inégalités et la dictature. Dans le deuxième groupe de circonstances, les
élites n’acceptent pas de partager la richesse de la société et veulent faire perdurer la dictature.
La diversification et l’inégalité sont des facteurs déterminants. En effet, plus une société est iné-
galitaire, plus l’établissement de la démocratie a des chances de garantir le partage des richesses
par voie de redistribution, ce qui accroît le coût de la démocratisation (Acemoglu et Robinson
2005). Le type de propriétés que possèdent les élites et les bénéfices qu’elles escomptent jouent
eux aussi un rôle important. Si, en démocratie, les masses peuvent facilement procéder à des
expropriations (de terres, par exemple), prendre une partie des richesses détenues par les élites,
le passage à la démocratie peut s’avérer plus coûteux pour les élites. Les difficultés auxquelles
fait face la démocratie pour s’implanter en Afrique depuis l’époque des indépendances et de la
Guerre Froide, tiennent en grande partie à l’ampleur des inégalités et à la forte vulnérabilité des
biens.
En effet, dans les pays tributaires des ressources naturelles, la diversification des activités
économiques peut faciliter la démocratie. Cependant, comme le démontrent les études de Robin-
son (1997 et 2001) et Dunning (2005), la diversification peut être économiquement rentable, ainsi
que politiquement coûteuse. Le partage du gâteau (pouvoir, richesses) entre les élites au pou-
voir et les masses d’exclus permet la promotion de la diversification car, si les élites au pouvoir
pensent qu’elles pourraient profiter des bénéfices du financement des biens publics, elles inve-
stiront dans la diversification de l’économie. En revanche, si les élites ont le sentiment d’être
perdantes, le fait qu’elles soient réfractaires au risque et n’aient pas la possibilité de connaître
toutes les implications d’un investissement présent, quel qu’il soit, rend la promotion de la diver-
sification économique encore plus difficile. Nous montrerons en particulier pourquoi les élites de
4

certains pays refusent la diversification économique. Plus concrètement, alors que les politiciens
au pouvoir pourraient souhaiter promouvoir la diversification de l’économie, réduisant ainsi la
volatilité budgétaire et améliorant potentiellement la performance économique globale, la diver-
sification peut créer les bases des sociétés civiles qui échappe au contrôle des élites politiques.
Ces bases indépendantes du pouvoir sont ensuite en mesure de faciliter des oppositions futures
à la puissance politique des régimes au pouvoir, en particulier durant les périodes de ralentisse-
ment économique et de crises budgétaires qui caractérisent généralement les pays dépendant des
ressources naturelles.
Nous établissons trois principaux résultats. Premièrement, dans les pays d’Afrique, les élites
au pouvoir ont tendance à promouvoir la diversification économique par rapport au soutien des
puissances mondiales et à la facilité ainsi qu’à l’efficacité avec lesquelles les masses sont suscepti-
bles de contester les élites au pouvoir. Si les incitations ou la capacité des masses à contester le
pouvoir sont faibles les politiciens au pouvoir pourraient donc profiter des bénéfices du finance-
ment des biens publics. Les politiciens sortants pressentent qu’ils sont gagnants, ils escomptent
donc qu’à l’avenir la probabilité qu’ils soient au pouvoir est pertinente du point de vue social :
il s’agit du prototype d’un Etat développemental. Deuxièmement, et de façon surprenante, nous
prouverons que les politiciens au pouvoir peuvent investir dans le capital public, ce même si le
soutien de la puissance mondiale est minimal et que les incitations et la capacité des masses à
contester le pouvoir sont fortes. Involontairement, les expansions d’investissements en capital
public, en augmentant la productivité globale des facteurs, la performance économique, incitent
la puissance mondiale à soutenir le régime en place, conduisent le politicien sortant à allouer da-
vantage de ressources afin de demeurer au pouvoir. Dans ce cas, le sortant valorise davantage les
gains futurs d’investissements publics et son sentier de politique préférée se rapproche de celui qui
est socialement efficace : il s’agit là du prototype d’un Etat en transition vers un Etat développe-
mental. Enfin, l’expropriation et la prédation permanentes des élites au pouvoir aggravent la
mauvaise répartition dans le reste de l’économie et dégradent la performance économique glob-
ale. Une telle situation découle du fait que la prévarication des ressources conduit les politiciens
à augmenter l’étendue du patronage afin de rester au pouvoir, toutefois, cette stratégie s’avère
inefficace. Elle baisse les bénéfices de la production du secteur privé, et entraîne sur le long terme
l’effondrement de l’Etat tout en contribuant à inciter encore davantage les masses à remettre en
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%