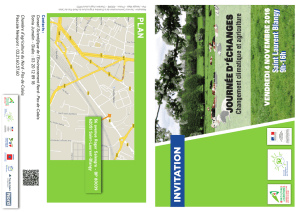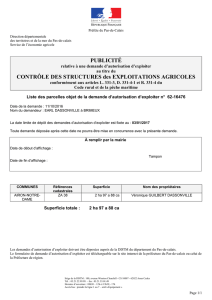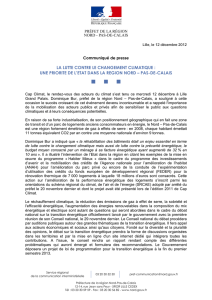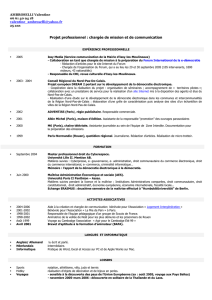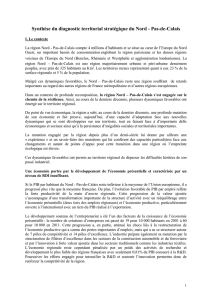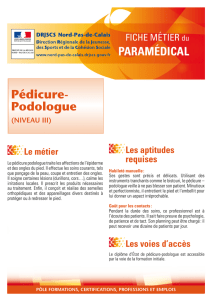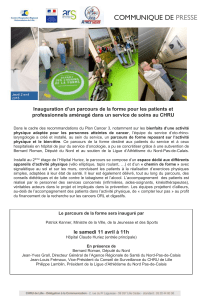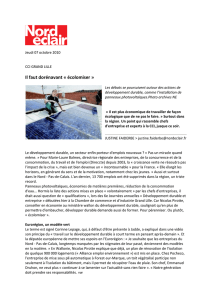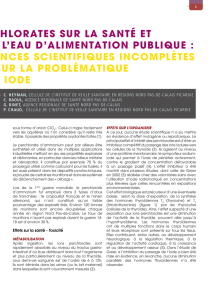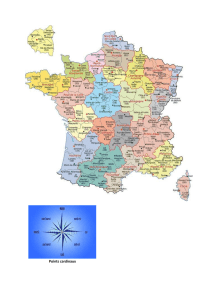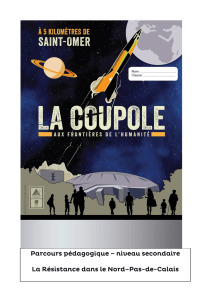Diagnostic régional - Les services de l`État dans le Pas-de

Union européenne
Diagnostic régional
PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee ooopppééérrraaatttiiiooonnnnnneeelll
CCCooommmpppééétttiiitttiiivvviiitttééé eeettt eeemmmpppllloooiii
NNNooorrrddd ––– PPPaaasss---dddeee---CCCaaalllaaaiiisss

Région Nord - Pas-de-Calais
2
SOMMAIRE
1. Une vision globale du Nord-Pas-de-Calais............................................................................................ 3
1.1. Une sélection d’indicateurs significatifs.......................................................................................3
1.2. Le potentiel du Nord-Pas-de-Calais ..............................................................................................8
2. Les approfondissements dans les champs d’action du FEDER.......................................................... 9
2.1. Les multiples facettes de l’environnement ...................................................................................9
2.2. Les fondamentaux du développement en Nord-Pas-de-Calais .................................................12
2.3. Economie de la connaissance et innovation ..............................................................................13
2.4. Réseaux et territoires en Nord-Pas-de-Calais.............................................................................20
3. Les défis du Nord - Pas-de-Calais....................................................................................................... 22

Région Nord - Pas-de-Calais
3
PREMIÈRE PARTIE : DIAGNOSTIC RÉGIONAL
1. Une vision globale du Nord-Pas-de-Calais
1.1. Une sélection d’indicateurs significatifs
Fort de plus de 4 millions d’habitants (6,7 % de la population française) sur 12.414 km²
(2,3 % du territoire national), le Nord-Pas-de-Calais est en 4
ème
position au niveau national. Sa
densité de 325 hab./km² est triple de la moyenne française et rapproche la région de ses voisines
européennes. Ces habitants vivent à 95 % dans des espaces à dominante urbaine contre 82 % au
niveau national. Une grande part est regroupée dans douze agglomérations allant de 60.000
(Cambrai) à 1.170.000 habitants (Lille), organisées en vastes systèmes amenant progressivement la
constitution d’une véritable région urbaine. Cette population est également jeune, la part des
moins de 20 ans étant de 28,2 % (25,2 % au niveau national) mais aussi en relative stagnation
(0,15% d’accroissement annuel 1999/2005). Le déficit migratoire est important (16.000
personnes par an entre les deux derniers recensements) avec des flux d’entrée et de sortie
étonnamment faibles faisant de cette population la moins mobile de France.
Mais c’est au travers des caractéristiques sociales que se manifestent les signes les plus inquiétants :
• un taux de chômage de 13 %, retrouvant un écart structurel important (3,9 points) à la
moyenne nationale (9,1 %) alors que cette différence s’était sensiblement réduite entre
2002 et 2004 ; ce taux peut atteindre entre 15 à 16 % dans certaines zones d’emploi
particulièrement touchées ;
• le taux d’emploi de 58,5 % est plus faible qu’au niveau national (62,5 %) surtout pour
les femmes (50,2 % contre 56,8 %) et les 55-64 ans (33,3 % contre 37,2 %);
• le revenu fiscal déclaré est de 13.400 euros par unité de consommation contre 15.500 au
niveau national (-13,5 %) et 52,5 % des ménages fiscaux sont imposables contre 60,2 %
pour la France ;
• la région compte 109 439 allocataires du RMI, soit plus de 10 % des bénéficiaires de
France métropolitaine et la part de la population concernée par la couverture maladie
universelle (CMU) complémentaire est de 10,6 % contre 6,9 % au niveau national ;
• une espérance de vie inférieure de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les
femmes, une surmortalité de 20 % toutes causes confondues, celle d’origine alcoolique
étant sur certains territoires multipliée par 3 , une offre sanitaire très inférieure à la
moyenne nationale ;
• une prépondérance des formations courtes et techniques y compris dans l’enseignement
supérieur et 15 % des personnes en situation d’illettrisme (contre 9 % au niveau national).
Une approche régionale de l’Indicateur de développement humain (combinant démographie,
niveau d’instruction et développement économique) conduit à estimer que le niveau régional de
2003 présentait par rapport à celui de la France un retard de 10 ans.
Le Nord-Pas-de-Calais a un profil d’occupation du sol très différent de la moyenne française, avec
13 % d’espaces artificialisés et 78 % d’espaces agricoles (respectivement 5 % et 60 % pour la
France) ce qui apparaît paradoxal dans une région où la population est urbaine à plus de 80 %. La
région abrite une grande variété de milieux naturels, essentiellement localisés à ses extrémités, dont
l’intérêt est reconnu au travers de 321 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique, le littoral en regroupant plus des deux tiers. En outre, les espaces boisés restent très
déficitaires (8 % du territoire contre 34 % en moyenne française). Le relief, peu marqué, et

Région Nord - Pas-de-Calais
4
l’urbanisation se traduisent par un risque d’inondation concernant une part importante de la
région.
Une profonde et brutale mutation a amené dans les cinquante dernières années la perte de 360.000
emplois industriels (mine, textile, sidérurgie). Ils ont été remplacés par le tertiaire (+120 %, en
partie grâce aux externalisations de l’industrie) et par quelques branches industrielles telles que
l’automobile (+29.000 emplois), les industries métallurgiques et l’agroalimentaire. Ainsi, le profil
économique régional se rapproche du standard national, l’industrie restant encore présente (19,5 %
contre 17,5 % ) tandis que la part des commerces et des services atteint désormais un niveau
équivalent (73 %).
Cette transformation, tant sociale qu’économique et en raison de son ampleur et de son urgence, n’a
pu être menée que grâce à une intervention nationale massive, engagée dès avant les années 1970,
que les fonds européens sont venus accompagner à partir du milieu des années 1980. La
permanence de certaines difficultés incitent toujours aujourd’hui, faute de projet réactif face à une
situation difficile, à privilégier l’appel à la solidarité nationale et à l’adoption de mesures de
compensation.
Cette mutation a laissé un nombre important de sites pollués ou à risques (515 sites pollués ou
potentiellement pollués recensés), la moitié des friches industrielles de France (plus de 10.000 ha
recensés en 1990 dont les deux tiers ont fait l’objet d’actions de requalification), une qualité des
eaux médiocre sur l’ensemble de la région, voire mauvaise dans les secteurs les plus denses, là où
se conjuguent les activités agricoles et industrielles ainsi que l’occupation urbaine. Cette situation,
combinée à l’absence de grand fleuve, fait peser sur la ressource en eau, issue à 95 % des nappes
souterraines, des menaces majeures tant qualitatives que quantitatives, et qui concernent également
la Belgique vers laquelle presque toutes les rivières convergent.
L’histoire économique ancienne ou récente, les nouveaux modes de vie ont façonné une forme
urbaine caractéristique, présentant selon les agglomérations un déficit d’organisation et une
faiblesse des centralités, une déqualification du bâti, une péri-urbanisation qui continue de s’élargir,
une fragmentation des espaces par de multiples coupures et un déficit flagrant en espaces de nature.
Ils rendent de plus la région fortement productrice de gaz à effets de serre, et la marque
industrielle se retrouve dans des risques technologiques importants (50 sites Seveso).
Avec un PIB de 81,5 milliards d’€, la région est au 4
ème
rang des régions françaises, mais ne
représente que 5,2 % du PIB national. Le PIB/emploi (56.500 euros) n’est que de 88 % du niveau
français et place la région au 15
ème
rang et le PIB/habitant (20.300 euros) ne représente que 78 %
de la moyenne nationale, la région étant alors au 21
ème
rang, ces situations relatives étant en
constante dégradation.
Si elle reste encore fragile, l’économie régionale présente de véritables points forts : 1/3 de la
production nationale en ferroviaire (1
er
rang), 1/3 de l’automobile (2
ème
rang), 50 % des emplois
nationaux de vente par correspondance, 20 % des emplois textiles (mais ce secteur connaît
d’importantes turbulences). Il s’agit toutefois de secteurs économiques à maturité présentant
comparativement une contribution à la valeur ajoutée plus modeste et des perspectives de
développement plus limitées. L’agroalimentaire est également un secteur majeur, avec pour
exemple le 1
er
pôle halieutique d’Europe traitant plus de 300.000 tonnes de poisson par an et la
présence de leaders mondiaux (conserves et surgelés, amidons,…), faisant du Nord-Pas-de-Calais la
première région exportatrice de produits des industries agroalimentaires. Enfin, de nouveaux
secteurs se sont confortés : biologie-santé, éco-entreprises, image et TIC,... Le constat peut être
fait dorénavant d’un tissu productif régional diversifié.
Ce renouveau de l’économie se traduit par six pôles de compétitivité labellisés, dont l’un d’entre
eux I-Trans consacré aux transports intelligents, à vocation mondiale.
Pour son développement, l’économie régionale peut s’appuyer sur un système de formation
supérieur reconnu qui accueille près de 155.000 étudiants (7 % du total national). Dans les

Région Nord - Pas-de-Calais
5
universités, la part des formations professionnalisées est plus importante, mais celle des 3
ième
cycles
plus faible qu’au niveau national. Par contre, les écoles de la région forment près de 8 % des
ingénieurs français.
Mais quelques facteurs pénalisent fortement le dynamisme économique local :
• un manque d’intensité de la recherche (2,3 % des effectifs nationaux et 1,8 % de la
dépense en 2003, 2 % des brevets déposés) résultant de la faiblesse de la recherche
publique malgré les récents progrès, de l’insuffisance notoire de la recherche privée, et de
la faible corrélation entre les domaines d’excellence de la recherche publique et les points
forts de l’économie régionale ;
• un esprit entreprenarial insuffisant avec 4,3 % des créations pures en 2005, même si la
situation récente marque une légère amélioration, en ayant constamment depuis 2003, une
augmentation supérieure à celle du niveau national, grâce au Programme régional de
création transmission d’entreprises, mis en œuvre dans l’actuel CPER ;
• un déficit en emplois stratégiques (fonctions tertiaires supérieures), Lille n’occupant que
la 13
ème
place nationale et Valenciennes, Dunkerque, Douai-Lens et Béthune les quatre
dernières positions des cinquante principales aires urbaines. En comparaison avec les
autres métropoles européennes, Lille apparaît en « grande ville » dont le potentiel
théorique européen est très faiblement valorisé et dont le rayonnement est modeste au
regard de son poids démographique.
L’accessibilité demeure un atout important, la région disposant de réseaux performants
d’infrastructures de transport qui assurent une connexion efficace sur l’Europe grâce notamment au
croisement des TGV nord-européens et du lien fixe transmanche. Les trois ports du littoral
régional offrant des vocations principalement complémentaires, renforcent le potentiel d’ouverture
de la région sur le monde.
On peut toutefois noter quelques insuffisances sur les liaisons aériennes, sur le réseau fluvial
ancien, mais en cours de modernisation et qui connaîtra une amélioration sensible grâce à la mise en
service du canal Seine-Escaut, et globalement sur les liaisons Est-Ouest. La prédominance du
mode routier pose toujours des problèmes récurrents notamment environnementaux. La fluidité
des réseaux ferré et routier, aujourd’hui correcte à l’exception des entrées dans la métropole, est
menacée par des conflits d’usage, des connexions intermodales insuffisantes et un effet frontière
persistant.
A l’intérieur de la région, les territoires qui la composent ne présentent pas tous les mêmes
caractéristiques. Certains sont frappés par l’accumulation de handicaps tel le Val de Sambre, le
Calaisis et dans une moindre mesure l’agglomération de Lens. Des différences significatives
apparaissent également au sein d’une même agglomération à l’exemple de certains quartiers de la
métropole, ou du Valenciennois. L’inégalité peut également se traduire par un déficit des services
tant marchands que publics, notamment dans le Sud du Nord. Enfin il faut rester attentif à la
situation de quelques secteurs à forte dominante agricole, Avesnois-Thiérache et Haut-Artois
notamment.
Grâce notamment aux nouveaux moyens de communication, TGV, tunnel sous la Manche, à un
effort considérable de valorisation de son patrimoine, au succès de Lille 2004, capitale européenne
de la culture, la notoriété de la région a fortement progressé, comme l’illustre le développement de
la fréquentation touristique. L’effort doit être poursuivi car le défaut d’attractivité de la région reste
patent. Des équipements exceptionnels tel que l’implantation du Louvre à Lens, qui doit être
valorisé à l’échelle nord-européenne, doivent en être les vecteurs.
La continuité territoriale avec la Belgique, premier partenaire économique de la région, la proximité
de la Grande-Bretagne, constituent des atouts insuffisamment exploités. Les relations
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%