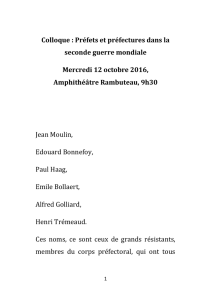sur ce lien

1
Dossier en hommage à Yves Bonnefoy
juillet 2016
La contribution de Michèle Finck
Yves Bonnefoy et la musique
Florence Trocmé : vous avez bien connu Yves Bonnefoy, beaucoup travaillé sur son œuvre,
beaucoup écrit à son sujet, beaucoup dialogué avec lui. Vous êtes vous-même une spécialiste
reconnue du rapport de plusieurs grands écrivains, d’hier et d’aujourd’hui, à la musique. Que
pouvez-vous dire du rapport d’Yves Bonnefoy à la musique ? Lequel est sans doute bien moins
connu et mis en avant que son rapport avec la peinture ou la sculpture.
Michèle Finck : Je voudrais dire d’abord que je réponds à vos questions d’une voix encore étranglée
par la douleur. Mais cela a peut-être du sens parce que nous voici tout de suite au plus près du
noyau central de l’œuvre. Je crois que la réception de l’œuvre d’Yves Bonnefoy est encombrée par
quelques clichés à dépasser : le premier c’est qu’il s’agit d’une œuvre difficile ; le second, c’est qu’il
est d’avantage un poète visuel tourné vers la peinture qu’un poète auditif tourné vers la musique
(Rilke, duquel il est proche à plus d’un titre, souffre du même cliché). Or il suffit de coller son
oreille tout contre un poème de Bonnefoy, d’écouter sa matière sonore, rythmique et silencieuse,
si profonde et inentendue jusque là, pour être aussitôt, sans difficulté préalable, en contact immédiat
avec le cœur battant de l’œuvre et pour comprendre que Bonnefoy est d’abord fondamentalement
un musicien de la langue à l’écoute de la musique. Mais cette adhésion à la musique et à la musique
verbale ne va pas cependant sans une condition sine qua non : pour que la musique d’un poème
ou d’une œuvre du répertoire classique touche Yves Bonnefoy, il faut que ce ne soit pas une
musique autarcique, éprise d’elle-même, close sur la beauté surouvragée de la forme (comme le
cristal mallarméen), mais une musique qui sorte de la chrysalide de la forme, une musique traversée
de tremblements, voire de fissures sonores et silencieuses, de syncopes rythmiques, par lesquelles
elle se remet sans cesse en question. Voilà pourquoi j’ai commencé par dire que cela a peut-être du
sens que je parle aujourd’hui de la musique pour Bonnefoy d’une voix étranglée, car ce qu’il aime
justement ce sont les voix dans lesquels le sens advient par les tressaillements, les tremblements
des cordes vocales : « Comme si au-delà de toute forme pure/Tremblât un autre chant et le seul
absolu », écrit-il dans le poème de Hier régnant désert dédié à Kathleen Ferrier, qui condense tout son
art poétique. Dès 1958 en effet, dans ce poème à la fois acte d’amour envers la musique et parole
autodéfinitionnelle, toute l’œuvre est déjà là et la suite, d’une cohérence et d’une unité inouïes, ne
sera que confirmation, approfondissement des intuitions présentes ici. Et s’il préfère la musique et
les voix qui « tremblent », et bien c’est parce que l’on entend aussitôt par les failles acoustiques, par
exemple par les alexandrins boiteux de onze syllabes du poème à Kathleen Ferrier, ce qu’est la
vérité de la vie, « aujourd’hui ici » : la finitude, le temps, la mort. Mais aussi, fait décisif, parce que
par les failles acoustiques, par les tremblements de la voix, la musique ne se complaît pas en elle-
même mais s’ouvre à l’autre, à la précarité de l’autre, vers lequel toute la poésie de Bonnefoy est
tendue. La musique en son pouvoir de compassion, qui communie avec les failles de l’autre par ses
propres failles, voilà ce qu’Yves Bonnefoy aime et recherche plus que tout.
FT : Il semblait dans un texte récent minimiser ses compétences en musique en se référant à un
petit piano jouet de son enfance. Qu’en fut-il réellement ? Écoutait-il de la musique ? Quelle place
avait-elle dans sa vie ?

2
MF : Ce qui est vrai, ce n’est qu’Yves Bonnefoy préfère la peinture à la musique, le visuel à l’auditif,
mais que la musique n’est tout simplement pas native dans son expérience de la vie. Il a tenu à dire
qu’il n’a pas eu dans l’enfance d’éducation musicale, en particulier pour souligner ce qui le sépare
de Jouve, qui est pour lui une référence majeure dès qu’il s’agit de musique. Mais quand on a dit
cela, il faut dire aussitôt autre chose d’essentiel. Il faut dire que si Yves Bonnefoy ne s’est pas tout
de suite ouvert à la musique classique, il a été immédiatement sensible à ce que je me suis risqué à
appeler « l’arrière-musique » (comme il parle d’ « arrière-pays ». Qu’est-ce que « l’arrière-musique » :
c’est l’attention extrême et instinctive d’Yves Bonnefoy, dès l’enfance, à la musique de la terre (au
Chant de la terre pourrait-on dire avec Mahler), c’est-à-dire en particulier à un cri d’oiseau dans un
ravin qui est la clé de voûte de l’œuvre, mais aussi à ce que j’ai tenté de nommer le pianissimo de la
« musique de paysage » (comme on parle de « peinture de paysage » : bruit d’eau, d’abeilles, de vent,
de pas, de voix, de respiration, du souffle de la terre »). Et cela l’a formé dans ses goûts profonds
et l’a prédisposé bien sûr à l’écoute plus tardive de la musique.
Il me semble qu’entrer dans l’œuvre d’Yves Bonnefoy par les sons et la musique, c’est entrer par
une porte fondamentale, peut-être la plus importante. Je me permets de dire, pour parler de ma
propre expérience qui peut valoir pour d’autres, que c’est cette porte que j’ai choisie. Quand j’ai
découvert l’œuvre d’Yves Bonnefoy à vingt ans, au début des années 1980, par le poème à Kathleen
Ferrier et que j’ai presque tout de suite après rencontré l’homme, j’ai été frappée par le fait qu’il
avait déjà théorisé, avec une force et une rigueur extrêmes, les grands pans de son œuvre, en
particulier son rapport au visible et aux arts visuels. J’ai mesuré aussitôt combien il était difficile de
se frayer un passage entre l’œuvre et le discours sur l’œuvre, sans répéter peu ou prou le discours
de l’œuvre elle-même (danger de la critique consacrée à Yves Bonnefoy). Mais j’ai perçu
immédiatement qu’il restait au moins une entrée en quelque sorte presque totalement vierge :
l’entrée par la musique et la voix. C’est pourquoi j’ai fondé mon premier livre, Yves Bonnefoy, le simple
et le sens, sur une triade herméneutique : le simple, le sens et le son. Et ce qui m’a semblé crucial,
c’est que le son (parce qu’il échappe au concept) peut faire don, pour Yves Bonnefoy, non certes
pas du « simple » et du « sens » désirés, qui toujours se dérobent, mais de la « sente étroite » (Basho)
tendue vers le « simple » et le « sens ». Et entrant dan l’œuvre par la porte du son, j’ai découvert à
quel point Yves Bonnefoy est sensible à la musique parce qu’elle lui parle plus que tout autre que
de ce qu’il cherche, l’unité perdue et à retrouver, « l’Un » plotinien sous la gangue du concept, sont
au centre de sa quête. Et en parlant aussi tout de suite avec lui, j’ai pris conscience de la place
centrale de la musique dans son œuvre et dans sa vie (même si, à la fin, il me disait souvent qu’il
était très gêné par des troubles liés à une forme atténuée de surdité et à des acouphènes qui
bruissaient dans ses oreilles et l’empêchaient d’écouter, comme il l’aurait voulu, par exemple un
œuvre de Messiaen qui l’intéressait.
Quelle musique écoutait-il ? On peut décrire son parcours musical ainsi : de Mahler à Mozart et à
nouveau Mahler. Pourquoi ces deux compositeurs ? Disons brièvement : Mahler, parce qu’il lui a
semblé que ce compositeur, dans « l’adieu » du Chant de la terre, menait ce même combat de la forme
et du non-formel, de la « forme » et de la « faille », qu’il menait lui-même en poésie. C’est pourquoi
il était bouleversé dans cette œuvre par le « ewig, ewig » terminal chanté par Kathleen Ferrier : ce
« balbutiant ewig de la fin », comme disait Adorno. Mozart, parce qu’il lui a semblé que ce
compositeur posait comme nul autre la question de l’éros (Don Giovanni), et du dépassement
possible de l’éros par l’agapè (la fin de Cosi), qu’il tente dans sa propre œuvre poétique. Mais à vrai
dire, il est revenu à Mahler et à Kathleen Ferrier à la fin, en écrivant à nouveau deux poèmes inspirés
par « l’adieu » du Chant de la terre : cet « adieu de cristal et de brume » a été essentiel pour lui jusqu’au
bout.
Mais il s’intéressait aussi à la musique contemporaine. J’ai parlé avec lui de Ligeti. Il m’interrogeait
sur Scelsi, sur Boulez (à qui il a dédié un texte : « Mallarmé et le musicien »). Je crois d’ailleurs qu’il
serait intéressant et neuf de réfléchir à une comparaison entre Bonnefoy et Boulez. Certes tout
semble d’abord les séparer (et cette séparation elle-même est intéressante), en particulier la pensée
de la « structure » primordiale pour Boulez et contestée radicalement pour Bonnefoy (la critique de

3
la « structure » rejoint sa critique de la « forme ». Mais par ailleurs on pourrait trouver beaucoup de
points communs (plus de tonalité pour Boulez, plus d’hémistiches, de rimes et de primats de
l’alexandrin pour Bonnefoy) ; sans sécurité (l’écoute n’est plus balisée par aucun garde-fou, l’oreille
ne sait plus d’avance où elle va, finis les trois mouvements, le schéma aba, finies les formes
poétiques fixes) ; enfin sans préjugé. Pour Boulez et Bonnefoy le maître mot est le mot dialogue :
dialogue avec la poésie et les arts (Boulez), dialogue avec la musique et les arts (Bonnefoy). Et enfin
une dernière pierre d’angle commune : l’obstination, au cœur de leurs deux pensées de la musique
et de la poésie. Mais certes, la « fureur » qui rapproche Boulez de Char, le sépare aussi de Bonnefoy
dont l’œuvre est totalement étrangère à la forme oraculaire.
FT : Il y a eu donc le magnifique et bien connu poème dédié à la voix de Kathleen Ferrier. Je sais
aussi qu’il aimait infiniment Monteverdi. Yves Bonnefoy avait-il un goût particulier pour la voix
humaine ? Vous avez parlé dans votre essai Epiphanies musicales en poésie moderne, de Rilke à Bonnefoy,
de la question de la voix rauque, de la raucité ? Pourriez-vous en dire plus ?
MF : J’ai pu faire l’hypothèse (à laquelle il a été très attentif) que toute son œuvre peut être articulée
autour du point charnière qu’est le poème à Kathleen Ferrier. Avant ce poème, une tentation du
nombre, de la fuite hors du temps (dans Douve) mais aussi une fascination pour Eliot et sa pensée
de « la terre vaine » (dans la section « menaces du témoin » dans Hier régnant désert). Avec et après le
poème à Kathleen Ferrier : une lutte contre le bonheur maléfique du nombre, une pensée du temps
et de la finitude, mais aussi une tension vers la transgression positive qui laisse Eliot loin derrière
lui et qui place au centre de sa propre œuvre le « ewig, ewig » de Mahler chanté par Kathleen Ferrier,
contre la tentation du « never more » du « Corbeau » de Poe.
Cela nous amène à votre question essentielle qui touche très juste : celle de son attention extrême
à la voix humaine. Plus encore que la musique, ce qui lui importe en effet c’est la voix, avec son
timbre unique pour chaque être, mais aussi encore une fois avec ses « imperfections »
(« l’imperfection est la cime »), ses tremblements qui laissent l’émotion submerger la forme, comme
on l’entend dans la voix de Kathleen Ferrier, qui peut s’écouter comme un paradigme permettant
de comprendre toute l’œuvre de Bonnefoy. Si je ne devais retenir qu’un seul mot pour définir
l’œuvre de Bonnefoy, je ne retiendrais pas immédiatement le mot « présence », comme cela a été
beaucoup fait, mais le mot « voix » justement, en ce que la « voix » est fondamentalement pour lui
ce qui fait don de la « présence » d’un être ou d’un poème. La poésie de Bonnefoy, on ne le dira
jamais assez, est avant tout une poésie vocale. Tous ses poèmes, depuis Douve jusqu’au Désordre,
sont des poèmes-voix. C’est le moment peut-être de dire ici que sa pensée de la musique ne peut
se dissocier de la pensée du théâtre. Nous avions d’ailleurs un projet d’entretien qui n’a pu se faire
en raison de sa maladie, mais dont il avait déjà fixé au mois de mai le titre : « Poésie, théâtre,
musique ». Pourquoi ce lien décisif pour lui entre poésie, théâtre et musique, et bien justement
parce que ce qui les réunit, c’est la primauté de la voix. Ce qu’il entend par théâtre, ce qu’il a
recherché par exemple chez Shakespeare, ce qu’il a tenté de restituer dans ses traductions de cet
auteur, c’est un théâtre non de texte mais de voix. À cet égard on peut dire que pour lui au théâtre,
en musique, comme en poésie, il faut aller au-delà de l’œuvre, de la mise en scène, fermer les yeux
pour voir vraiment par la voix. C’est le sens de la formule que j’ai placée en sous-titre de mon livre
Giacometti et les poètes : si tu veux voir, écoute. Vers quoi se tourne cette écoute ? Et bien vers la voix qui
s’ouvre au plus profond de chaque être et de chaque œuvre et qui est la preuve de sa légitimité et
de son authenticité. Qu’est-ce que finalement la poésie, sinon ce que j’aimerais appeler : la preuve
par la voix ?
Et pour répondre tout à fait à votre question, il faut aussi que j’évoque la voix d’Yves Bonnefoy
lui-même, qui est ce qui frappe aussitôt quand on le rencontre et d’avantage encore quand il lit son
œuvre si intensément vocale. Une voix dont on se demande comment elle peut tout à coup surgir
de son corps, une voix heurtée, profonde, sourde, rocailleuse, rugueuse, elle-même tremblante et

4
comme traversée de failles, une voix scandée dans laquelle on entend l’iambe fondamental libéré
par le primat du rythme sur la signification des mots. Une voix qui, par la façon dont elle se défait
de la forme grâce au rythme, au silence, aux intervalles entre les mots, et au travail des e muets, est
aussitôt « présence ».
J’ai en effet consacré une étude à la poétique de la « voix rauque » dans l’œuvre d’Yves Bonnefoy.
« Rauque » était sa propre voix, je viens d’essayer de la dire. Mais « rauque » est aussi la « voix » de
son œuvre. Pourquoi ? Et bien parce que la « raucité » est en quelque sorte le haut-fourneau
transmutatoire par lequel Yves Bonnefoy descend de plus en plus profondément au centre de la
voix pour l’ouvrir d’un coup à l’au-delà de la forme, au temps, à la matière, à l’autre. En quelque
sorte, je dirais volontiers qu’Yves Bonnefoy a ajouté une corde à la lyre d’Orphée : la corde de la
« raucité », une corde plus basse, une corde plus grave, laissant remonter le tréfonds de l’être, de sa
précarité, de sa finitude. Certes sur ce point, l’œuvre « rauque » d’Yves Bonnefoy rejoint le travail
sur la « raucité » de plusieurs de ses contemporains, de Dupin à Des Forêts.
FT : Vous faites, dans ce même livre, une hypothèse importante à propos d’Yves Bonnefoy et de
« l’épiphanie musicale », articulant deux termes si proches dans leur graphie, si lointains dans leur
sens, apparemment, réparation et séparation. Pourriez-vous nous dire ce qu’il en est, après avoir
éclairé, si vous voulez bien, ce concept d’épiphanie musicale. Je rappelle aussi que le sous-titre de votre
essai est Le musicien panseur.
MF : Oui, « séparation » et « réparation » me semblent les deux pôles autour desquels s’articulent
tout le travail poétique d’Yves Bonnefoy. La prise de conscience de la « séparation » (ontologique
et historique à la fois) est à l’origine et tout l’effort de la poésie de Bonnefoy dès le début consiste
à essayer de « réparer » cette « séparation » dont le langage lui-même est une des causes majeures.
Et comment tente-t-il cette « réparation » ? Avant tout, c’est mon hypothèse, par la musique et la
musique verbale (son, rythme, silence, intervalles, souffle). Et la « réparation » est inachevable,
toujours à recommencer, parce que la « séparation » ne cesse de la remettre en cause. On peut
écouter, dans l’œuvre d’Yves Bonnefoy, se heurter l’une l’autre la conscience aiguë de la
« séparation » (avec le monde, avec l’autre, avec soi-même, avec l’être) et l’effort immense de
« réparation » obstinée. Et ce que j’appelle « épiphanie musicale », c’est justement le moment où la
« séparation » semble un instant (mais un instant seulement) dépassée et qui advient, chez Yves
Bonnefoy, tout particulièrement dans les moments musicaux de l’œuvre qui « réparent » ce que le
langage conceptuel avait « séparé ». À cet égard « épiphanie musicale » et l’écoute de la voix de
Kathleen Ferrier, car celle-ci est la révélation de cette transcendance dans l’immanence par laquelle
se définit « l’épiphanie » pour Bonnefoy, l’avènement du sens par le son dans cette œuvre. Ce que
j’appelle « le musicien panseur », c’est la capacité rayonnante qu’a le musicien non pas de guérir les
plaies (et je voudrais remettre en cause le concept réducteur de « musicien guérisseur » qu’on
emploie souvent) mais de les « panser » : c’est-à-dire de se pencher sur elles, d’inventer pour elles
toutes sortes de « pansements » de l’âme, mais sans les guérir, en laissant les blessures apaisées mais
toujours ouvertes, parce qu’elles sont notre vérité profonde, le signe distinctif de notre condition
humaine et peut-être même de sa beauté.
FT : pourriez-vous pour conclure évoquer quelques souvenirs personnels avec Yves Bonnefoy ?
Conversations, écoutes… ?
MF : Oui, je pourrais terminer par quelque chose qu’Yves Bonnefoy n’a jamais écrit, à ma
connaissance, mais dont nous parlions ensemble. Je lui avais demandé, il y a longtemps déjà, quel
était son instrument de musique préféré, et il m’avait répondu : le violoncelle. Sans doute
comprend-on sans difficulté ce choix, à la lumière de ce que j’ai essayé de dire précédemment.

5
Instrument à voix basse et grave, le violoncelle n’est-il pas une forme d’équivalent instrumental de
la tessiture de contralto qu’aime tant Yves Bonnefoy chez Kathleen Ferrier et qui hante toute son
œuvre, par exemple « Sur les ailes de la musique » ? Instrument plus humble que le violon (trop
facilement identifiable à une virtuosité et à une mise en relief de soi dont se défie beaucoup Yves
Bonnefoy), le violoncelle n’a-t-il pas quelque chose de la modestie de ce choix du hautbois, à la fin
des Grands moments d’un chanteur de Des Forêts qu’Yves Bonnefoy porte très haut dans La vérité de
parole ? Récemment nous avons évoqué ensemble le concerto pour violoncelle de Dutilleux, Tout
un monde lointain. « Nous en reparlerons » m’avait-il dit…
Mais le temps ne nous a pas été donné pour cet échange, à jamais inachevé. Pour moi et nous tous
désormais, un « absolu » s’est « perdu », comme autrefois, pour Yves Bonnefoy auditeur de
« l’adieu » du Chant de la terre par Kathleen Ferrier. Yves Bonnefoy n’a-t-il pas lui-même invité à une
lecture de la deuxième strophe de son poème selon le vecteur vertical de la rime en mettant en
résonance ces deux vocables « absolu » et « perdu », dépositaires du sens ? Et la « voix mêlée de
couleur grise » n’est-ce pas aussi pour nous désormais la sienne propre, telle que nous la gardons
au plus profond de notre être, jusqu’à rebaptiser peut-être le poème : « À la voix d’Yves
Bonnefoy » ?
Toute douceur toute ironie se rassemblaient
Pour un adieu de cristal et de brume.
Les coups profonds du fer faisaient presque silence.
La lumière du glaive s'était voilée.
Je célèbre la voix mêlée de couleur grise
Qui hésite aux lointains du chant qui s'est perdu
Comme si au delà de toute forme pure
Tremblât un autre chant et le seul absolu.
O lumière et néant de la lumière, ô larmes
Souriantes plus haut que l'angoisse ou l'espoir,
O cygne. lieu réel dans l'irréelle eau sombre,
O source, quand ce fut profondément le soir !
Il semble que tu connaisses les deux rives
L'extrême joie et l'extrême douleur.
Là-bas, parmi ces roseaux gris dans la lumière
Il semble que tu puises de l'éternel.
Michèle Finck
1
/
5
100%






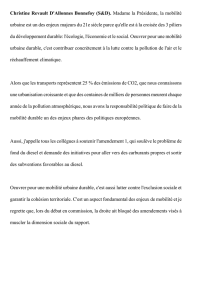

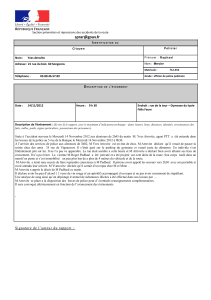
![Agence Comptable[2]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000190145_1-d06ae78a9b3b8b79ebdfbed7139af760-300x300.png)