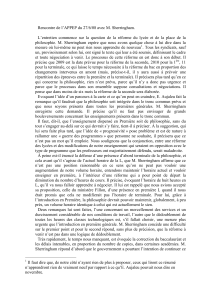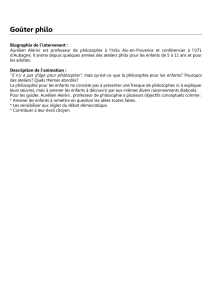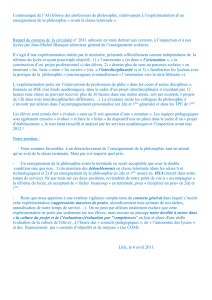maturite, terminale, « progressivite ».

L’Enseignement Philosophique
Éditorial de mai - juin 2010
MATURITE, TERMINALE, « PROGRESSIVITE ».
Convenons qu’il n’y a pas d’âge naturel de la philosophie. L’enfance n’en est donc pas
l’âge naturel. La critique faite en son temps par le Greph d’une présence terminale justifiée
par un âge naturel, vaut autant à l’égard d’une représentation convenue de l’enfance qui la
voudrait innocente, âge d’une disponibilité particulière, d’une curiosité désintéressée, d’un
questionnement naïf, témoignage d’un appétit métaphysique. On ne peut dénoncer pour la
Terminale l’illusion d’un âge naturel et la recréer ailleurs, à l’âge de la Sixième ou de l’école
primaire. Qu’on nous permette donc de rappeler, comme il prévoyait que cela ne manquerait
pas d’être fait, les propos de J. Derrida sur le risque de toute naturalisation : « Le Greph doit
sur ce point redoubler de vigilance, sa stratégie risquant de l’exposer à ce risque de
mystification naturaliste : en revendiquant un abaissement de l’âge et une extension de
l’enseignement philosophique, on peut laisser entendre (sans le vouloir mais l’adversaire
s’emploiera à le faire entendre) : une fois qu’on aura effacé les préjugés et les idéologies, on
mettra à nu un enfant toujours déjà prêt à philosopher »
1
. L’avertissement n’a pas été assez
entendu. La « mystification naturaliste » sévit encore.
L’enfant veut savoir ? Soit. Qu’il reçoive à l’école la culture générale qui satisfera cet
appétit. Disons-le en passant, relativement à certaines « pratiques » ou « expérimentations »,
qu’on exerce tôt au raisonnement, que des discussions puissent développer des qualités,
pourquoi pas. Qu’on exerce dès l’école primaire à des distinctions de sens à partir de l’usage
des mots : c’est peut-être mieux apprendre sa langue. Cela n’a rien de proprement
philosophique. Un enseignement vivant des sciences, de l’histoire, des lettres, des langues,
suppose tout autant, et même mieux, ce développement d’un « esprit critique » auquel on
prétend ainsi exercer, belle formule mais devenue passe-partout. Que des professeurs de
français en collège préparent avec des professeurs de philosophie, comme cela s’est déjà fait,
à une lecture accessible à cet âge, entendons à ce niveau scolaire, de l’allégorie de la caverne,
ne nous pose aucun problème. Mais c’est autre chose, un autre métier même, que ce que nous
exigeons actuellement de notre enseignement et de ses professeurs. Quels que soient, peut-
être, certains désaccords que nous aurions pu avoir, il faut reconnaître en cela la rigueur de
Sarah Kofman qui, en 1977, parlait de la nécessité d’une « adaptation » pour tout ce qui
s’adresserait au « plus jeune âge ». Elle concluait : « on n’enseignerait, dans cette nouvelle
perspective, ni la même chose, ni sous la même forme. Ni peut-être sous le même nom. »
2
.
Souvent aujourd’hui, ce qui se prétend philosophie, une manière de dire son utilité, portent,
de fait, à l’ecjsisation de son enseignement, sa réduction à une formation du citoyen, voire à
une possible utilisation politique, parée des meilleures intentions, ce que justement le Greph
dénonçait tout particulièrement en critiquant tout âge naturalisé de la philosophie.
1
Greph, Qui a peur de la philosophie, Champs-Flammarion, 1977, Paris, L’Age de Hegel, pp. 77-78.
2
Op. cit., Philosophie terminée – philosophie interminable. Toutes les citations de S. Kofman sont empruntées à
cet article.

A tout prendre, naturalisation pour naturalisation, l’emporterait sans mal, aujourd’hui
encore, que l’adolescence finissante convient mieux à la philosophie : ce qui défendrait la
philosophie au lycée. Sarah Kofman résumait parfaitement cette représentation d’une
psychologie jugée naturelle à cet âge
3
: « l’âge de la Terminale est celui de l’adolescence qui
prend plaisir à tout bouleverser, à tout « remettre en question » ; l’adolescence n’est-elle pas
l’âge critique, sceptique, l’âge « métaphysique » par définition ? ». Mais, selon elle, que
l’adolescent soit ainsi posé comme naturellement mûr pour la philosophie n’était qu’une
construction destinée à légitimer un enseignement cherchant à en finir avec ce « mal radical »
du doute. Terminal, l’enseignement de la philosophie mis en place par Victor Cousin l’était
pour en terminer avec la philosophie. Il s’agissait, selon S. Kofman, de philosopher une fois
dans sa vie, une fois pour toutes, et d’entrer alors dans le monde armé des meilleures
certitudes : « la crise devait être passagère ». L’argument de la maturité, servait une politique
que servait un enseignement de la philosophie dont nous avons une autre fois montré la
nature
4
.
Nous n’en sommes plus là, ni d’une vision si uniforme, voire angélique, de l’adolescence,
ni d’une conception de l’enseignement de la philosophie. Déjà en 1977 le Greph en convenait
partiellement. R. Brunet affirmait que « la substitution des notions à des questions ou des
problèmes est un progrès »
5
. L’actuel programme n’implique aucunement des professeurs
instrumentalisés, formant par l’enseignement d’une philosophie les futurs cadres d’une
république bourgeoise ou servant une conception de la citoyenneté. L’on peut alors s’étonner
que certains, qui se disent quelquefois héritiers du Greph, nous proposent aujourd’hui comme
un progrès le retour de questions et de problèmes définis comme tels par le programme. Ce
sont sans doute les mêmes qui ont défendu, il y a quelques années, contre une très grande
majorité des professeurs, un programme, de notions doublées de questions, qui se présentait
lui-même comme destiné à combattre les effets d’un individualisme jugé propre à la
démocratisation de nos sociétés.
L’enseignement que nous défendons aujourd’hui avec un programme de notions, dont les
raisons et les fins sont énoncées par le programme de 2003, prend le risque salutaire de
maintenir l’homme dans cet état d’éternelle jeunesse dont Platon fait se moquer Calliclès dans
le Gorgias. S’adressant à un public qui pourrait ne plus avoir aucun contact avec la
philosophie, il invite à une inquiétude dont la fin des études secondaires pourrait signifier la
fin. Partant de notions, qui ne sont pas qu’opinions vulgaires, il invite par une instruction
philosophique, rencontre des idées et des textes des philosophes, à une manière de vivre qui
ne sépare pas vivre et philosopher. En ce sens il se justifie et justifie sa présence terminale. Le
cours de philosophie de la classe terminale fait fond sur des connaissances qu’il situe dans
leur dimension humaine. Il ramène à l’incertitude dans laquelle elles sont d’elles-mêmes, à
une nécessaire humilité. Il termine, mais ne clôt pas, n’est aucunement cette philosophie qui
inviterait à en finir avec la philosophie par l’assimilation définitive « des grandes vérités
naturelles » dont « Dieu a voulu qu’elles fussent accessibles à [la] raison »
6
. Il dit au contraire
un désir infini. Il est « la source de cet incessant réveil par lequel, au cours de l’histoire, la
conscience aperçoit que ce que lui offre l’objet, et ce que les sciences lui enseignent de
l’objet, ne saurait satisfaire tout à fait son exigence »
7
. Il s’agit de sortir du lycée sachant ce
que l’on sait et dans quelle mesure on le sait. Le doute, en notre actuel enseignement, n’y est
donc aucunement, comme le dénonçait S. Kofman du projet cousinien, « qu’un moyen pour
fonder les sciences ». Il en dit au contraire les limites. Il est appel à une liberté de jugement
3
On sait bien que ces notions d’enfance ou d’adolescence sont relatives.
4
Voir l’éditorial « Péché originel » (septembre-octobre 2009).
5
Op. cit., Margarita philosophica, p. 146.
6
Nous citons ici V. Cousin, cité par J. Derrida - supra note 1.
7
F. Alquié, La Nostalgie de l’Être, PUF, Paris, 1950, p. 13.

qui ne saurait se retrancher derrière les vérités des sciences ou s’oublier, abdiquer, dans
l’attribution d’une valeur à ce qui n’est qu’état de fait. Il s’agit, en quelque sorte, de ne pas
finir sa scolarité avec cette suffisance de ceux qui « font les entendus »
8
, suffisance d’un
rapport technicien au monde, d’opinions qui se veulent définitives. D’être savant, si peu que
ce soit, n’épargne pas d’être philosophe, si peu que ce soit.
De fait la classe terminale est un moment charnière dans la vie de nos élèves. Sa situation
favorise un état d’esprit qui lui est propre. La philosophie, au tournant manifeste d’une vie, y
a pleinement sa place. Que cette classe soit terminale rend possible une distance à soi, un
recul et une projection dans l’avenir. Peu à peu, ce n’est plus tout à fait le même élève qui
était en Première et qui est maintenant en Terminale. Sans doute y faut-il affronter aussi
l’utilitarisme d’une année à examen. Sans doute aussi y rencontre-t-on la résistance de celui
qui tente de s’installer dans une identité pour s’y fondre et non pour prendre ses distances,
mais cela n’est pas plus propre à cette dernière année qu’à d’autres. Cette résistance même
intéresse un cours de philosophie. Autrement dit, répétons-le, rien ne justifie qu’on diminue la
présence terminale de notre enseignement au nom de son progrès quand bien même elle ne
saurait être conçue comme exclusive de ce qui pourrait y préparer.
Le cours de la classe terminale est celui d’une progression, constant approfondissement
orchestré par ce lien organique entre les notions qu’il doit tisser. L’étude d’œuvres y
contribue. Cela nous le comprenons. Mais qu’on nous parle de diviser l’horaire attribué
actuellement à la philosophie sur plusieurs années au nom d’une pédagogie qui se pare du
terme de « progressivité » et il faut avouer notre incompréhension. Qu’on gagne à se préparer
à la classe terminale, nous l’entendons, pourvu que l’on veuille bien nous accorder des heures
pour cela. Encore faudrait-il ne pas nous enfermer dans une filière littéraire vouée à devenir
une exception si l’on ne fait rien pour lui rendre un caractère plus généraliste et que l’on ne
s’empare pas de cette préparation pour recommencer une guerre des programmes. Lequel
d’entre nous n’a jamais souhaité avoir pu exercer davantage ses élèves à la dissertation,
pouvoir partir d’un peu moins loin quant aux notions ou avoir pu instruire une culture
générale défaillante. C’est ce qui a fait utiliser par beaucoup d’entre nous la possibilité
d’obtenir des heures en Première par le biais d’un projet d’établissement. Ceux qui disent leur
plaisir d’avoir ainsi travaillé en Première le disent d’avoir trouvé mieux disposés, de tout
point de vue, les élèves qu’ils avaient ensuite en Terminale. Mais quelle est cette progressivité
qui supposerait l’étalement du même horaire et la dilution des effets positifs de la
concentration en Terminale d’un horaire suffisant ? C’est en fait la volonté d’en finir avec un
programme de notions qui revient à travers cette revendication. Remarquons encore, quant à
ce concept de « progressivité », l’honnêteté de la réflexion du Greph
9
pour en dire le vide.
J. Derrida disait qu’il n’était constitué que d’un « argument stratégique provisoire », celui
que, puisque les autres disciplines commencent en Sixième, il doit en être de même pour la
philosophie… Rien donc d’une innovation didactique ou pédagogique, mais seulement un
argument capable d’être entendu par le pouvoir politique, une stratégie de communication.
Derrida craignait même que résulte de cette banalisation le cadeau empoisonné, hégélien,
d’« une progressivité calculée, téléologiquement organisée, réglée sur une grande rationalité
systématique… »
10
. Roland Brunet, pilier du Greph, parle dans le même recueil du « concept
encore indéterminé et d’ailleurs provisoire de « progressivité »
11
. Et rien n’a avancé depuis,
8
Pascal, Pensées, Br. 327.
9
Indéniablement partisan, en son temps, d’une division de l’horaire de la Terminale A en deux fois quatre heures
(encore faudrait-il situer cette position relativement à la réforme dite « Haby »), et plus largement, pour certains,
d’une présence « banalisée » de la philosophie, entendons identique à celle des autres disciplines.
10
article cité, p. 102.
11
Op. cit., Margarita philosophica, p. 111.

sinon par récupération du mot pour l’habiter, par exemple, de tranches découpées d’une
histoire de la philosophie, ou d’une histoire des idées, ou encore d’un « apprendre à
problématiser » avant d’élaborer des problèmes, ou de l’acquisition d’« outils » pour
« penser » avant de commencer à « penser », etc.
Apprendre à apprendre en somme, avant
d’apprendre, air connu, malheureusement.
Simon PERRIER
Président de l’APPEP
Septembre 2010
1
/
4
100%