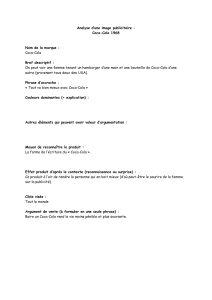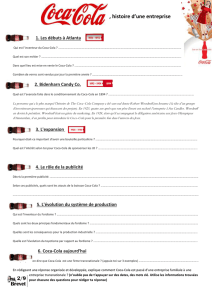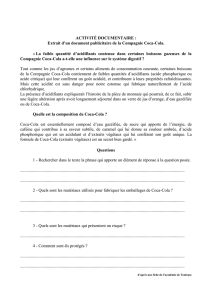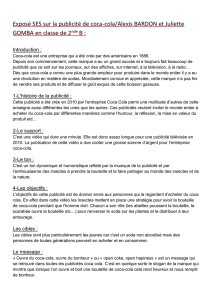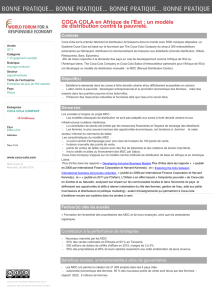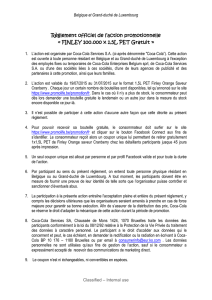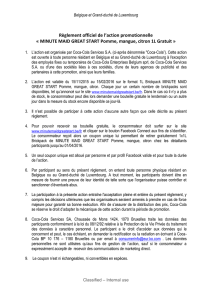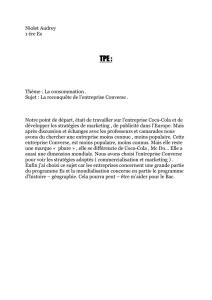Coca-Pepsi. Le conflit d`un siècle entre deux world

36
CHAPITRE II
10 juin 1998. Le Stade de France est plein à craquer pour
le match d’ouverture de la Coupe du monde, qui oppose le
Brésil à l’Écosse. Tandis qu’autour de l’enceinte du stade,
des milliers de supporters recherchent désespérément un
billet pour entrer, les éminences du jour prennent place
à la tribune officielle : Jacques Chirac, président de la
République française, Joao Havelange, président de la
Fédération internationale de football, Michel Platini, prési-
dent du Comité d’organisation de la Coupe du monde. Sur
la pelouse s’échauffe la star des stars du football mondial,
le Brésilien Ronaldo. Nul ne sait encore combien va être
calamiteux pour lui ce Mondial, qui va se terminer, ici
Les sentiers de la gloire

37
même, cinq semaines plus tard, par la plus humiliante des
défaites, trois à zéro en finale face à la France.
Pour l’heure, les télévisions du monde entier et leurs
deux milliards de téléspectateurs ont les yeux et les objectifs
braqués, alternativement, sur la pelouse de Saint-Denis, puis
sur la tribune officielle, où, après les falbalas de la cérémonie
d’ouverture, Jacques Chirac déclare enfin ouverte la seizième
Coupe du monde de football.
Hors du champ des caméras, à quelques encablures des
trois pré sidents, dans une loge de VIP, un homme en
costume sombre s’est tranquillement installé. Le visage
lisse et impavide, il est apparemment peu concerné par la
liesse des quatre-vingt mille spectateurs survoltés dont la
rumeur est amortie par les vitres fumées du salon. Il ne
mettra pas le nez dehors de tout le match, alors même que
sa loge, superbement placée, dispose d’une vaste terrasse,
où ont pris place quelques invités privilégiés. Il quittera
le stade un quart d’heure avant le coup de sifflet final,
après avoir passé l’essen tiel de son temps en réunion ou
en conversation téléphonique, sirotant de temps à autre un
Coca-Cola.
Cet homme que le football laisse froid est pourtant le vrai
maî tre du jeu. Douglas Ivester, président de The Coca-Cola
Company, l’un des top sponsors de la Coupe du monde,

38
détient ce qui est aujourd’hui, dans le football comme
ailleurs, le principal instrument de pouvoir : l’argent.
On ne sait pas combien Coca-Cola a investi dans ce
Mondial 98. Mais il suffisait de se promener aux alentours
des douze stades français pour toucher du doigt son
omniprésence et son omnipotence. Les équipes d’Atlanta,
selon leur vieille tradition, avaient “repeint la ville en
rouge”. Buvettes, stands de jeux et de produits dérivés,
vendeurs ambulants, affiches, banderoles, pin’s et badges,
casquettes et tee-shirts : le “périmètre marketing” alloué
autour des stades par les organisateurs du Mondial aux
grands sponsors de l’épreuve a été transformé, par les
équipes de Coca-Cola, en red zone (littéralement “zone
rouge”), selon le jargon maison pour désigner la mainmise
de la marque sur un espace commercial.
Ce 10 juin, le général Ivester n’est pas venu à Paris pour
voir un match, mais pour vérifier que ses divisions sont en
place pour la grande manœuvre. Et préparer les prochaines
campagnes, en 2000 à Sydney, pour les JO du millénaire
(Coca est partenaire du mouvement olympique depuis
1928), puis en 2002 lors de la prochaine Coupe du monde
au Japon et en Corée.
La veille, le PDG a payé de sa personne en allant inaugu-
rer deux ateliers dédiés aux nouvelles technologies, financés
par la Fon da tion Coca-Cola, dans un lycée technique de

39
la banlieue rouge, en compagnie du maire communiste de
Saint-Denis, Patrick Braouezec. D’autres interlocuteurs plus
prestigieux n’ont pas eu droit à tant d’égards. Juan-Antonio
Samaranch, le puissant patron du Comité international
olympique (CIO), a dû faire antichambre au Plaza Athénée,
où Ivester avait pris ses quartiers, avant d’obtenir une
audience minutée, entre deux interviews accordées au
journal Le Monde et à une télévision coréenne. Le PDG
sait très exactement à quelle place mettre, ou remettre,
chacun.
S’il n’est pas à la tribune officielle du Stade de France,
le 10 juin, c’est moins par modestie que pour une question
d’efficacité. Ivester a fait sienne la devise du patron
historique de Coca-Cola, Bob Woodruff, qui régna à Atlanta
de 1923 à 1955 : “Il n’y a pas de limite à ce qu’un homme
peut faire ni où il peut aller, s’il lui importe peu qu’on
le lui attribue.” Doug Ivester ne tire ni plaisir ni vanité à
être “le roi du monde”. Les ricanements ou les accusations
qui déferlent sur la world company qu’incarne jusqu’à
la caricature Coca-Cola glissent sur lui. Il a l’arrogance
placide de l’Américain du baby-boom, sûr de son bon droit
comme de sa puissance.
Le financier géorgien aime les idées simples. Chaque être
humain boit en moyenne douze fois par jour, que ce soit
une boisson alcoolisée ou non, de l’eau en bouteille ou

40
du robinet. Cela représente donc un “marché” quotidien de
quarante-huit milliards de boissons. Doug Ivester affirme
sans rire : “Coca-Cola ne vend qu’un milliard de bois sons par
jour ; cela fait 2 % de part de marché.” C.Q.F.D.
Cette philosophie d’artisan, jamais satisfait de l’acquis,
toujours sou cieux du travail bien fait, perpétuellement inquiet
du lendemain, imprègne tous les rouages de la Coca-Cola
Company depuis qu’un pharmacien d’Atlanta, en 1885,
inventa une certaine boisson au cola…
John Styth Pemberton, docteur en pharmacie, a cinquante-
qua tre ans et déjà une longue vie de recherches lorsqu’il
propose à ses clients du Jacob’s Drugstore d’Atlanta, un
beau jour d’août 1885, un sirop de sa création. Ce “stimulant
idéal du système nerveux et du tonus” est une décoction
de feuilles de coca et de noix de cola pilées dans… du
vin français. En mai 1886, sous la pression des ligues
antialcooliques, le pharmacien remplace le vin par de la
caféine et du jus de citron, et sert son sirop coupé d’eau
gazeuse bien fraîche. C’est moins coûteux que le bordeaux
et plus tonique dans ce Sud agricole où la chaleur étouffante
a vite fait de se transformer en torpeur.
Du grand chaudron où il touille son étrange mixture,
à coups de rame selon la légende, l’honorable docteur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%