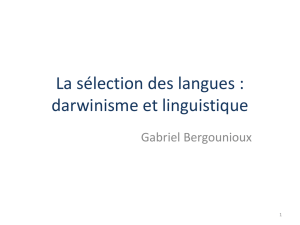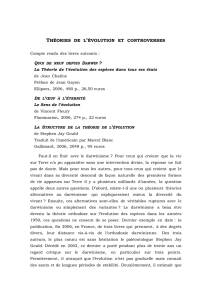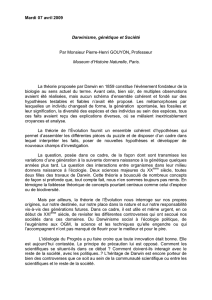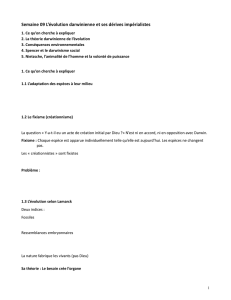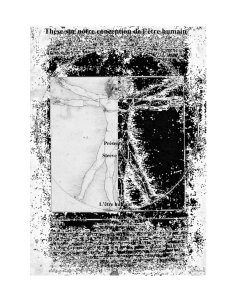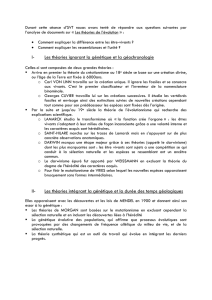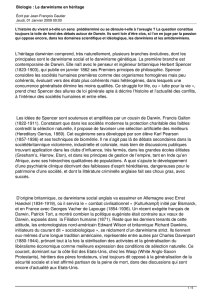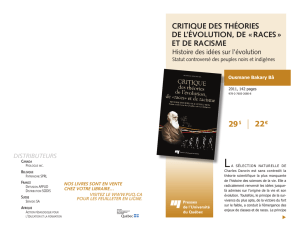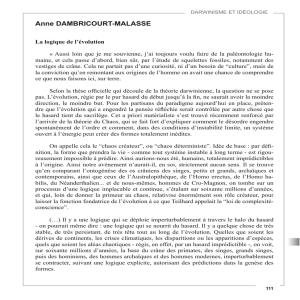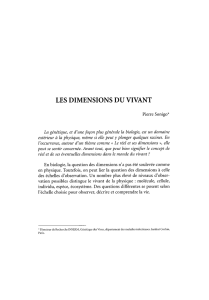Les juges de la Cour suprême des Etats

1
Les juges de la Cour suprême des Etats-Unis et le darwinisme
Darwinisme social contre darwinisme réformiste1
I. Le clivage entre darwinisme social et darwinisme réformiste, clé de
compréhension de l’évolution de la jurisprudence de la Cour suprême
A. Le darwinisme social, matrice du laisser-faire constitutionnel
B. Le darwinisme réformiste, fondement intellectuel du New Deal et de
la notion de constitution vivante
II. Le clivage entre darwinisme social et darwinisme réformiste, clé de
compréhension de la philosophie judiciaire des juges de la Cour suprême
A. Le passage du darwinisme social au darwinisme réformiste en tant que
changement du paradigme de la décision judiciaire
B. La scission du darwinisme, source des divergences entre les juges
Holmes et Brandeis
1
Presses de l'Institut Fédératif de Recherche en Droit de l'Université Toulouse
Capitole.

2
Απόστολος Βλαχογιάννης
Δ. Ν. Πανεπιστημίου Paris II Panthéon-Assas
Introduction
« Après Darwin, presque tout intellectuel était un évolutionniste… »2 : Cette phrase
résume parfaitement l’ambiance intellectuelle Outre-Atlantique à la fin du
XIXe et à l’aube du XXe siècle.
Par darwinisme ou évolutionnisme, il faut entendre la théorie scientifique de
la sélection naturelle relative à l’évolution des espèces qui a été développée
par Charles Darwin et qui repose, pour l’essentiel, sur trois éléments : rareté,
variation et hérédité3. En sciences sociales et humaines, le droit y inclus,
comme le sera expliqué par la suite, le darwinisme social constitue le penchant
conservateur du darwinisme, alors que le darwinisme réformiste le penchant
progressiste.
Il est vrai qu’il existait des théories évolutionnistes du droit longtemps avant
la naissance de la théorie darwinienne en 1858 - en 1859 parut l’ouvrage
monumental L’origine des espèces – et, du moins, avant sa consolidation dans
les décennies qui ont suivi4. Pour n’en citer que quelques unes, il suffirait de
se référer à la théorie de Sir Henry Sumner Maine ou à celle de Friedrich Carl
von Savigny. Pourtant, la spécificité de la théorie darwinienne consistait en sa
simplicité qui la rendait aisément transposable dans d’autres domaines de la
connaissance humaine. Et cela fut notamment le cas aux Etats-Unis où la
théorie darwinienne connut un succès immense, dès la fin du XIXe et jusqu’au
2 « After Darwin, almost every intellectual was an evolutionist… » [HOVENKAMP Herbert,
«Evolutionary Models in Jurisprudence », 64 Texas Law Review (1985), p. 647].
3 Ibid., p. 651.
4 Ibid, p. 645.

3
début du XXe siècle, imprégnant toutes les autres disciplines, qui se
trouvaient, malgré tout, dans un état embryonnaire à l’époque.
De cette brève description historique l’on peut s’apercevoir que la théorie
darwinienne, à savoir une théorie biologique, a pu se transposer, sans
difficulté considérable, dans les sciences humaines et sociales et notamment
dans le droit. La question qui aurait pu se poser d’emblée serait de savoir s’il
s’agit d’une « transplantation » réussite, voire véritable, qui ne déforme pas, en
d’autres mots, la théorie scientifique originale. Pourtant, cela ne sera pas notre
point central de préoccupation. En effet, la théorie de Darwin a été choisie par
des sociologues et surtout des juristes américains parce que, exactement, elle
était une théorie scientifique en germe qui se prêtait, en conséquence, à des
interprétations diverses ; l’on pourrait même prétendre qu’elle était vérifiable,
au moment de son adoption, plutôt dans le domaine des sciences humaines
que dans celui des sciences dures. La question principale qui sera donc
effectivement posée est par quels moyens et quelles chaînes intellectuelles une
théorie biologique a pu s’adapter si aisément au droit, pour influer à un tel
point sur la jurisprudence constitutionnelle des Etats-Unis et la philosophie
judiciaire de certains des membres de la Cour suprême les plus éminents.
Pour répondre à cette question, il faudra, dans un premier temps, situer le
débat entre darwinistes sociaux et darwinistes réformistes dans le contexte
américain et voir ainsi pour quelle raison la jurisprudence de la Cour suprême
y a trouvé un fort appui. Dans un second temps, il s’agira de percer la
philosophie judiciaire de deux grands juges du début du XXe siècle, à savoir
Oliver Wendell Holmes Jr. et Louis Dembitz Brandeis, afin de comprendre de
quelle façon l’empreinte darwinienne marque leurs philosophies judiciaires
respectives et contribue à expliquer leurs divergences. L’hypothèse que nous
tenterons de vérifier sera que le clivage entre darwinisme social et réformiste

4
constitue un point de référence, une sorte de langage commun dans laquelle baignent
et sont traduits toutes les controverses idéologiques majeures préoccupant la pensée
juridique et surtout constitutionnelle américaine de l’époque. Dans ce contexte, une
analyse centrée sur ce clivage serait non seulement la clé pour comprendre
l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême mais
aussi pour approfondir la philosophie judiciaire de deux juges qui ont réussi à
forger, par le truchement de leurs opinions, le droit constitutionnel américain.
I . Le clivage entre darwinisme social et darwinisme réformiste, clé de
compréhension de l’évolution de la jurisprudence de la Cour suprême
Tout d’abord, il convient d’examiner les idées des représentants les plus
éminents de deux courants du darwinisme qui inspirent la jurisprudence de
la Cour suprême. En premier, sera analysé le darwinisme social et la doctrine
correspondante du laisser-faire constitutionnel ; par la suite, sera évoquée la
révolution constitutionnelle du New Deal et la formation de la doctrine de la
constitution vivante en tant que triomphe intellectuel du darwinisme
réformiste.
A. Le darwinisme social, matrice du laisser-faire constitutionnel
La réception des idées darwiniennes par le canal du sociologue anglais
Herbert Spencer, qui s’est efforcé de transposer la théorie de l’évolution dans
le domaine des sciences sociales, a été considérable aux Etats-Unis, pendant
les trois dernières décennies du XIXe et au début du XXe siècle. Globalement,
le paradigme darwinien s’est vite répandu et s’est substitué au modèle
newtonien, pour ce qui concernait la conception de la nature et de la société.
Cela a eu pour effet que, à partir des trois décennies qui ont suivi la Guerre
civile, la théorie de Spencer a influencé largement, et quasiment surplombé,

5
tous les domaines de la pensée américaine, dont notamment la philosophie et
la sociologie5.
Ce succès était fondamentalement dû aux efforts des penseurs conservateurs,
qui les premiers se sont appropriés le darwinisme et y ont eu recours afin de
défendre l’idéologie du laisser-faire6. William Graham Sumner, un des
fondateurs de la science sociologique américaine, a été le darwiniste social le
plus vigoureux et influent aux Etats-Unis. C’est ce professeur de Yale qui a su
le mieux synthétiser trois grandes traditions occidentales, à savoir l’éthique
protestante du calvinisme, les doctrines économiques classiques de Ricardo et de
Malthus et finalement la sélection naturelle darwinienne, en une pensée
uniforme, qui reposait sur le pessimisme philosophique, le déterminisme
économique et le scientisme respectivement7. S’inspirant de la vision
spencérienne, Sumner a fondé sa critique de tout projet de réforme sociale sur
un déterminisme embrassant le rejet, d’une part, du volontarisme et, de
l’autre, de la foi en le progrès8.
En effet, le darwinisme spencérien a fourni deux points d’appui aux théories
conservatrices. D’une part, l’adoption des leitmotivs darwiniens, tels que
notamment la « lutte pour l’existence » et la « survie du plus apte », et leur
application au domaine économique, ont contribué à ériger l’idée d’une lutte
compétitive en loi naturelle et lui ont prêté un fondement scientifique. D’autre part,
l’idée d’un développement lent et non précipité servait à la théorie politique
conservatrice comme une justification de tout refus de réforme sociale9. De telle
manière, la théorie spencérienne offrait au conservatisme économique la légitimité
5 HOFSTADTER Richard, Social Darwinism in American Thought, Beacon Press, Boston, 1992
(1re edition: University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1945), p. 33.
6 Ibid., pp. 4-5.
7 Ibid., p. 51.
8 Ibid., pp. 60-1.
9 Ibid., pp. 6-7.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%