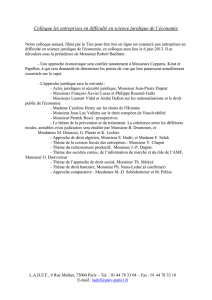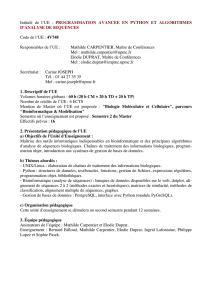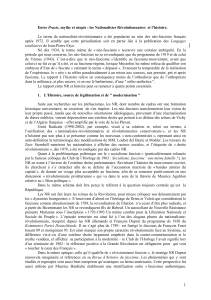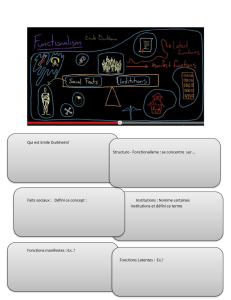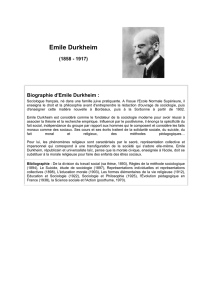Guillaume-Léonce Duprat (1872-1956), l`Institut International de

18
Dossier
Cécile Rol
Guillaume-Léonce Duprat (1872-1956),
l’Institut International de Sociologie et l’Allemagne
dans l’entre-deux-guerres
Guillaume-Léonce Duprat compte parmi les figures les plus inclassables de la so-
ciologie française, dont il fut, avant d’en disparaître de la mémoire, un prolifique
représentant.1 Il est au faîte de sa carrière lorsqu’il reprend les rênes du vieil Insti-
tut International de Sociologie (IIS) que René Worms avait fondé à Paris en 1893.
Dix ans durant, de 1927 à 1937, ce poste lui permet de renouer avec les sociolo-
gues allemands, tels Gottfried Salomon, Max Horkheimer et en particulier Leopold
von Wiese. Le fil rouge de ce laborieux rapprochement se voulait doublement pro-
grammatique. L’avènement de la forme „normale“ de la solidarité des peuples à
venir, celle d’un fédéralisme européen intégral, ne pouvait être pensé et réalisé
que sociologiquement. Aussi n’y avait-il pas de tâche plus urgente que de fédérer
la discipline elle-même. „No ‚school‘ will be permitted to prevail. There is no longer
any German, or English, or American, or French sociology“: si la sociologie sortait
du „chaos“ stérile des oppositions d’écoles et des traditions nationales, les Etats
européens abandonneraient leurs rivalités impérialistes et militaires (Duprat 1936a:
451; 1938: 48sq.). Aussi, la réorganisation de la sociologie était-elle plus qu’un
pré-requis. Elle valait comme fin en soi.
L’IIS de Duprat – ou plus exactement Fédération internationale des Sociétés et
Instituts de Sociologie – existera de 1933 à 1937, sans pourtant atteindre son but.
Le néo-organicisme durkheimien par lequel Duprat désirait asseoir rationnellement
un fédéralisme politique d’extraction proudhonienne reposait sur une double affir-
mation du référent français. Or à reprendre la typologie de Bock, si cette prémisse
permit à Duprat de substituer à un „regard hégémonique“ sur l’Allemagne une stra-
tégie de rapprochement plus „pragmatique“, la méfiance l’emportera sur
l’„empathie“.2 Outre la politisation des relations franco-allemandes, qui explique en
grande partie les limites du transnationalisme de l’IIS dans l’entre-deux-guerres, la
collaboration que Duprat voulut initier permet de différencier deux autres variables
de ce rendez-vous manqué. La première est un effet de génération dans un
contexte de quasi-identité entre l’Ecole sociologique française et celle de Durk-
heim. La seconde, plus complexe, se rattache au concept de „réseau de sociabi-
lité“. Moins étudiée que l’appartenance politique, institutionnelle ou confession-
nelle, l’adhésion à la franc-maçonnerie, qu’elle fût active ou idéale, semble mériter
une place dans l’analyse.

19
Dossier
Duprat, l’Allemagne et la sociologie avant-guerre
Duprat naît en 1872, peu après la défaite contre l’Allemagne, à Léogeats, une pe-
tite commune du Sud-Ouest de la France.3 A Bordeaux, il obtient en 1890 deux
baccalauréats, l’un ès lettres, l’autre ès sciences restreint. Cette orientation bicé-
phale se poursuit dans son cursus. Duprat étudie la philosophie et la sociologie,
notamment avec Alfred Espinas et Emile Durkheim, mais aussi la médecine. Ja-
mais il ne tranchera, cherchant au contraire à concilier les deux voies dans son
programme psycho-sociologique. Comme le neveu de Durkheim, Marcel Mauss,
Duprat décroche sa licence en 1893 haut la main. Il est le premier de sa promo-
tion. C’est un étudiant brillant, prometteur et conscient de l’être, un trait constant
de sa personnalité volontiers querelleuse. Le faux-pas ne tarde pourtant pas à ve-
nir car à la différence de Mauss, Duprat échoue à l’agrégation. De peu, certes.4
Mais assez pour se voir condamné à être 25 ans durant un ambitieux Jean-sans-
Terre qui jamais n’obtint le poste universitaire convoité.5 Cet échec à l’agrégation
de 1896 constitue le point de départ du positionnement de Duprat envers
l’Allemagne, tout comme de son plaidoyer pour un néo-organicisme durkheimien
fédérateur en sociologie. Ces deux postures connaîtront au fil des ans
d’importantes inflexions. A considérer l’idéal républicain qui les sous-tend cepen-
dant, la continuité l’emporte. Le fédéralisme qu’avant-guerre Duprat voulait voir
réalisé à l’échelle nationale, il voudra le stimuler dans l’entre-deux-guerres dans un
cadre transnational et franco-allemand.
Le contre-exemple allemand
L’image initiale que Duprat se fit de l’Allemagne est celle d’un contre-exemple, ce
qui ne l’empêcha ni de recenser ses collègues d’outre-Rhin, ni de publier tôt et
avec zèle dans diverses revues allemandes – bien qu’en français. Ce regard enga-
geait trois pans: la sociologie, qui permet „d’établir d’une façon quasi-scientifique la
valeur d’une conception démocratique de la vie sociale“; la philosophie sociale ou
morale, qui enjoint à réaliser la loi naturelle de la solidarité; enfin l’éducation politi-
que, moyen principal d’une mobilisation performative de la sociologie (Duprat
1900: 27). De fait, le jeune Duprat ne s’en tint pas à regretter qu’on se désintéres-
sât en Allemagne de ce qui se faisait en France.6 A ses yeux, les sociologues alle-
mands posaient mal le problème. Hormis peut-être Schaeffle, ni la Völkerpsycholo-
gie de Lazarus ou de Wundt, ni même la „volonté sociale“ d’un Tönnies ne le satis-
faisaient.7 Il fallait fixer la discipline autour des concepts issus du solidarisme et de
l’organicisme français dont Durkheim, qui „parmi les sociologues français [fut] un ini-
tiateur, un maître“, a permis l’éclosion: ceux de „contrainte sociale“, de „conscience
collective“ – ou de préférence, puisque c’était sa propre proposition, de „solidarité
psychique“ (ibid.: i). Néanmoins, l’avènement conjoint de la solidarité et de la
démocratie, „développement normal de la civilisation“ que la prévision sociologi-
que permet d’établir, est comme artificiellement freiné. C’est qu’il manque à la na-
tion, „forme sociale suprême en l’absence d’une organisation rationnelle de l’huma-

20
Dossier
nité entière“, une décentralisation, une organisation garanties par une force morale
rationnelle (ibid.: 227). A cet égard, Duprat approuve certes que l’Allemagne ait
dès 1881 rétabli ses corporations, l’un des meilleurs outils de décentralisation et
de représentation organique d’un pays qui soit. Mais son esprit reste aristocrati-
que, monarchique, maintenant le peuple allemand à l’état d’une servitude douce
tandis que „Nul pays n’est plus attaché que [la France] à la démocratie“ (ibid.: 2).
En Allemagne, la philosophie sociale, qu’elle soit idéaliste ou matérialiste, reste en
outre métaphysique. N’étant pas conceptualisée comme une „hypothèse ajoutée à
la science afin de concevoir ce qui peut-être et de proposer, comme devant être, le
meilleur des possibles, le plus conforme aux aspirations des peuples et aux exi-
gences de la Raison“, la philosophie sociale allemande échoue à offrir à la sociolo-
gie l’inscription pratico-politique rationnelle, aux nations la morale socio-démocrati-
que objective qui leur sont dues (ibid.: 113). Pour Duprat, le modèle à suivre ici
n’était pas Marx – dont l’esprit est „individualiste“, le socialisme „allemand“ et
l’internationalisme „du pangermanisme à peine déguisé“ – mais indéniablement
Proudhon.8 Toutefois, il faut plus que Proudhon, plus qu’une morale scientifique
pour réaliser la solidarité organique et démocratique dont la sociologie arrête la
nécessité. A la „démocratie intégrale“ correspond un „enseignement intégral“, uni-
versitaire comme élémentaire, scolaire comme para-scolaire. Or l’Allemagne et
son système éducatif délaissent le citoyen: rien n’est fait pour le rendre apte à
prendre part au gouvernement. Duprat déplorait d’ailleurs qu’on l’imite trop en
France sur ce point, et voyait dans l’agrégation ou le baccalauréat des institutions
sclérosées typiques du „péril que fait courir à l’éducation nationale une Université
où tant de bons esprits perdent leur temps à imiter les pédants allemands“ (Duprat
1902a: 190). Partant, la réforme de l’ensemble du système éducatif français deve-
nait sinon une croisade, du moins un étendard politique (Duprat 1912: 488-496).
Cet idéal éducatif d’une édification sociocratique de la démocratie que Duprat dé-
fendait „avec la chaleur de l’apostolat et la vive conscience du devoir civique“ (RIS
1900: 131), fut intimement lié à la franc-maçonnerie, à laquelle il s’initie en 1897,
peu après son échec à l’agrégation. Dans ce contexte, il se peut certes que ce soit
„en sociologue qu’il aborda la Franc-Maçonnerie, convaincu que ‚la méthode ma-
çonnique‘ était le parangon des modèles éducatifs qu’il cherchait à définir et qu’il
exprimait encore en 1920“.9 Mais c’est en franc-maçon proudhonien bien plus
qu’en sociologue qu’il abordait le modèle éducatif, social et politique allemand.
Le conflit en lui-même ne pousse pas Duprat à changer ses vues sur
l’Allemagne. Dans ses recensions, il cautionne l’idée que l’Allemagne a „trompé,
insulté, martyrisé“; que pour „en venir à ce point de folie homicide ou prédatrice“ il
faut que ce „peuple soit tout entier malade, perverti intellectuellement et morale-
ment, victime d’un égoïsme monstrueux et d’un mysticisme guerrier auprès duquel
pâlit celui des plus sinistres orientaux“ (RIS 1916: 655, 594). Cet „état d’esprit
collectif“ typiquement germanique, que Duprat souhaitait „analyser ultérieurement“,
devait beaucoup à la vieille ritournelle du „pédantisme inintelligent“ des universitai-
res d’outre-Rhin (ibid.: 94, 655). Toujours haineux envers la métaphysique alle-

21
Dossier
mande, l’Aufklärung et ses suites en prenaient pour leur grade: „Kant, essayant de
passer de la morale théorique à la morale pratique, a été amené en définitive à
faire l’apologie du pouvoir despotique de l’Etat; il a contribué […] à la diffusion des
idées étatistes, qui sont aujourd’hui le fondement de l’obéissance passive de pres-
que tous les Allemands à quiconque personnifie le pouvoir illimité, indiscutable,
indivisible, de l’Etat“ (Duprat 1924a: 231sq.). Sans même parler de Nietzsche,
tous, de Hegel à Herbart, avaient été les artisans de cet „esprit de discipline
qu’une éducation essentiellement militariste et mégalomane […] maintient au profit
d’une tendance à la domination universelle, d’un impérialisme pangermanique“
(ibid.: 189). La messe était dite. En revanche, Duprat était très inquiet des consé-
quences que ce conflit charriait dans son sillage. Outre les ruines, les morts et les
traumatismes, la „torpeur morale“ règne partout en Europe. La guerre a renforcé
cet „esprit nouveau, essentiellement individualiste“ issu de „l’industrialisme et de la
démagogie“ – un esprit qui, tel la gangrène, „travaille sans relâche“ à la dissolution
des agrégats sociaux (Duprat 1924a: 240, 206-210). Si cette crainte est ancienne
dans sa pensée, elle trahit pourtant une importante rupture. Au-delà de la phobie
de l’amputation, dont il se peut qu’elle ait été décuplée par l’expérience de la
guerre durant laquelle Duprat est actif comme médecin,10 l’esprit qu’il indexe va
au-delà du marxisme et des révolutions russes ou allemandes. Il va même au-delà
d’un capitalisme débridé que Duprat, la crise aidant, qualifiera volontiers de plouto-
cratique. Fait nouveau, c’est désormais la conception étroite du mot „nation“ qui
est en cause. Duprat se voit contraint de constater que le patriotisme français n’a
pas été un „amour éclairé“ mais aveugle, qu’il n’a pas été inspiré „par une connais-
sance de plus en plus précise des conditions [… et] des lois du devenir social“,
mais par le profit et la crédulité (Duprat 1900: 288). Voilà ce qu’actualisait la subite
occupation de la Ruhr en 1923: „après la guerre la plus effroyable“ qu’a connue
l’Europe, le nationalisme et l’ignorance entre les peuples – „a fortiori entre Alle-
mands et Français“ – débouche sur une une ingression dont, en dehors „des es-
prits simplistes, personne ne croit qu[’elle] puisse amener une solution“.11
L’alternative qu’il fallait chercher à bref délai confortait son credo: face à la „désin-
tégration sociale que la guerre mondiale n’a fait qu’accroître et accélérer“, tout ce
qui tend „à l’intégration progressive des forces dues à la différenciation, à la divi-
sion du travail social […] est un gain pour le progrès de l’humanité vers la solida-
rité organique, fin sociale par excellence“ (Duprat 1929: 562, 567sq.). Afin de lutter
contre le fractionnement de la „grande civilisation“ européenne, le sociologue de-
vait donc penser un transnationalisme dont les vertus intégratrices et contraignan-
tes soient saines. Partant, le rapprochement des peuples, en particulier entre la
France et l’Allemagne, n’était plus une rêverie littéraire, mais une impérieuse né-
cessité.

22
Dossier
Entre méthode et politique: Duprat et le néo-organicisme durkheimien
Après l’échec à l’agrégation, Duprat se rapproche de deux sociologues tenus
d’ordinaire pour opposants de Durkheim: Gabriel Tarde et René Worms. Ce non-
conformisme fut d’autant plus déroutant que Duprat a tôt argué n’être „pas un so-
ciologue“, s’affichant au mieux comme un „disciple souvent infidèle“ de Durkheim
(Duprat 1900: 1). Nul doute cependant que Duprat était alors „l’élève le plus zélé
de Durkheim“, ainsi que le glissera insidieusement von Wiese.12 Sa démarche, qui
visait bien une réconciliation entre les figures les plus en vue de la sociologie, ex-
primait d’une part le désaveu de toute une génération plus jeune pour qui leurs
polémiques constituaient un préjudice à tous égards. D’autre part, c’est en recou-
rant aux arguments critiques de Durkheim que Duprat pensait, en les utilisant au
sein même de pôles adverses, parvenir au but. Il le fit avec Tarde13 et surtout avec
Worms, de tout juste trois ans son aîné. L’intensive collaboration que Duprat lui
offre dès 1898 au point de s’imposer comme le „workhorse reviewer“ de la Revue
internationale de sociologie (RIS) n’avait pas seulement pour but de faire aussi
bien que L’Année sociologique de Durkheim.14 Il s’agissait encore de maîtriser
depuis l’intérieur les excès de l’organicisme dont Worms s’était fait le chantre. A
l’instar de Durkheim, dont les premiers écrits s’inscrivent d’ailleurs dans ce para-
digme,15 Duprat a clairement voulu réduire l’organicisme a minima en excluant
l’existence de „prétendues races“ – terme qu’il conjugue au subjonctif et entre guil-
lemets – puis en dénonçant l’abus de comparaisons bio-sociologiques (Duprat
1902b: 413; 1907: 10sq., 99). Mais bien que pris à corrections, l’organicisme res-
tait un point de départ analytique auquel ni Duprat ni Durkheim n’entendaient re-
noncer. Epistémologiquement d’abord, la perspective organiciste semblait éviter
l’écueil d’une conception ontologique de la société dans la mesure où elle fondait
scientifiquement le fait social fondamental d’une solidarité organique dont il était
possible d’induire des lois. L’organicisme permettait d’asseoir „l’existence par soi,
naturelle, de la vie sociale“ – ou, et ici Duprat reprenait les termes de Durkheim, de
la „contrainte“ (Duprat 1902b: 413). En revanche, c’était la solidarité, non l’idée
d’organisme, qui constituait la finalité du discours sociologique. Ce terme de „fina-
lité“ renvoie à un second ordre de raisons pour lesquelles l’organicisme restait un
moment nécessaire pour Durkheim comme Duprat: il justifiait un réformisme politi-
que qui se voulait positif.
De même que Durkheim indexait non la loi de la division du travail mais les
conditions externes anormales de „désintégration“ qui la „dénaturent“,16 préser-
vant sa finalité, de même Duprat avançait que si la société n’était pas un orga-
nisme biologique, elle n’en restait pas moins une organisation qui, si elle prenait
des traits pathologiques, exigeait une réorganisation par rétablissement de la soli-
darité organique. Hormis le puissant correctif de la morale civique, Durkheim
convoquait les groupes professionnels ou „corporations“ au chevet de „cette inor-
ganisation que l’on qualifie à tort de démocratie“.17 „Notre action politique consis-
tera à créer ces organes secondaires“ revendiquait-il, ces „organes normaux du
corps social“.18 Or tandis que Durkheim ne s’engagea in fine jamais dans cette
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%