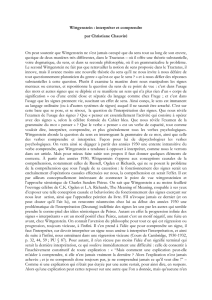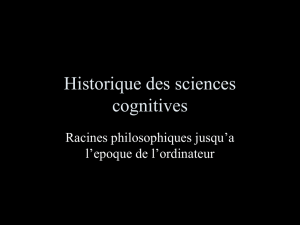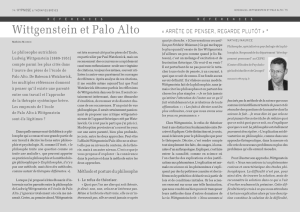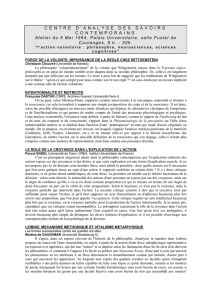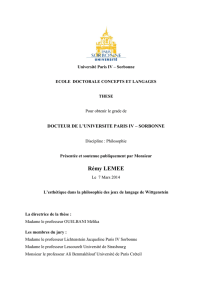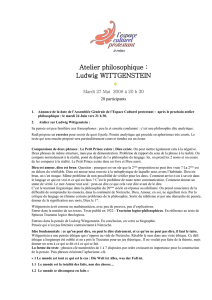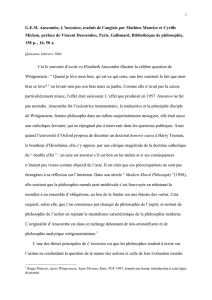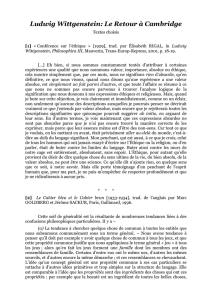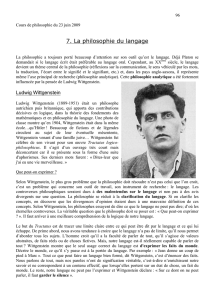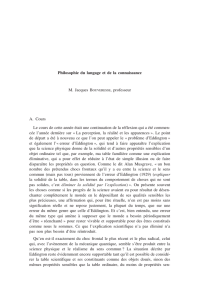Langage et esthétique : Wittgenstein ou l`ordre des

Evelyne Rogue
Langageetesthétique:Wittgensteinoul’ordredesraisons
1
Langageetesthétique:Wittgensteinoul’ordredesraisons
Nous faisons souvent un mauvais usage des termes, et notamment lorsque nous
employons les adjectifs “beau” ou “bon”. C'est du moins ce que tente de mettre en évidence
l'auteur des Leçons sur l'esthétique, lorsqu'il affirme ceci : « Si vous considérez la forme
linguistique des phrases dans lesquelles apparaît un mot tel que “beau”, son emploi est encore
plus susceptible d'être mal compris que dans d'autres cas1 » Pour rejeter le concept de Beau
en tant que tel, Wittgenstein utilise une méthode inspirée par Platon. Il s’appuie en effet sur
l’énumération non ordonnée d’objets divers auxquels on peut appliquer le même prédicat,
soit : visage, chaise, fleur, livre2. Effectivement, il n'est pas rare qu'un certain nombre de
termes soient utilisés dans de multiples usages, dont certains sont mal compris. C’est ce qui se
passe lorsque nous employons des termes comme “Bien”, “Bon” et “Beau”. En conséquence
de quoi, il semble tout à fait légitime de s’interroger sur l’usage que nous faisons de ces
termes, et plus particulièrement de celui de beau. Interrogation qui nous conduira
inéluctablement à la prise en considération des concepts de signification et de vérification, en
rapport aux jeux de langage, eux-mêmes indissociables des “ressemblances de familles”, pour
reprendre des termes wittgensteiniens. Notons dès à présent que l’usage des termes est
réglementé par un apprentissage du langage, qui débute nécessairement avec l’obéissance aux
règles pour aboutir à la prise en compte de la définition ostensive. Ostension qui ne nous
permet d’ailleurs pas toujours de faire toute la lumière sur un terme, comme nous aurons
l’occasion de le constater.
Tout d’abord, en ce qui concerne les adjectifs “beau” et “bon” ce phénomène
d'incompréhension semble exacerbé; cela notamment dans la mesure où : "Beau” (et “bon” -
R.) est un adjectif, de telle sorte que vous êtes enclin à dire : "Cela a une certaine qualité, celle
d'être beau”. Mais ne nous y trompons pas, par cette remarque Wittgenstein nous invite
seulement à comprendre que “beau” ou “bon” ne sont que des adjectifs et rien de plus. En
effet, d’une part ils se réduisent à des interjections dont la signification se borne à un au-delà
ou en-deçà de ce qu’ils représentent. D’autre part, si effectivement il est impossible de poser
de manière précise et exacte en quoi consiste le beau, c’est sans doute parce que la polysémie
inhérente à ce terme constitue un obstacle insurmontable. C’est donc à travers l’étude de ses
différents sens que nous pourrons en dégager la signification ultime; à moins qu’il ne faille
nous en tenir à cette recommandation formulée par Wittgenstein lui-même; laquelle ne nous
recommande rien de moins que ceci : « Ne demande par quel est le sens, demandez quel est
l’usage ». Il est vrai que lorsque nous ne nous interrogeons pas véritablement et
1 L. Wittgenstein, Leçons sur l'esthétique, I, 1, p.15
2D. Chateau, “Le statut du Beau dans l’esthétique analytique”, dans Le Beau Aujourd’hui, Centre Georges Pompidou, 1993, p. 40.

Evelyne Rogue
Langageetesthétique:Wittgensteinoul’ordredesraisons
2
essentiellement sur le sens des termes, nous nous apercevons alors que nous utilisons parfois
dans l’usage courant un mot à la place d’un autre. Ceci est vrai du vocable “beau” mais aussi
de celui du substantif “spirale”. Par exemple, en voyant ceci:
nous avons coutume de dire que nous voyons une spirale. Mais comme le fait très
judicieusement remarquer Tom Sherman, il se peut fort bien que nous nous trompions
lorsque nous disons “ceci est une spirale”. Et notre auteur d’ajouter : « Je crois que je n'utilise
pas le mot spirale correctement. Je devrais utiliser le mot hélice. Une spirale est la trajectoire
autour et le long d'un cône. Une hélice est la trajectoire autour et le long d'un cylindre. Il est
vrai que plusieurs personnes utilisent le mot spirale familièrement pour décrire de telles
lignes ».3 Ainsi, le sens d’un terme semble présenter pour nous une énigme insurmontable ;
cela dans la mesure où justement seule la définition du beau - dans le cas qui nous occupe
présentement - pourrait en constituer le sens. Or cette définition du Beau en soi est impossible
à formuler. Par exemple : « Si quelqu'un dit : “Les yeux de A ont une plus belle expression
que ceux de B”, je dirai alors qu'il n'entend certainement pas par “beau” ce caractère qui est
commun à tout ce que nous nommons beau ». Ce qui revient non seulement à dire, ou redire,
que nous ne possédons pas l'essence du beau, en tant que “caractère de ce qui est commun à
tout ce que nous nommons beau” ; mais aussi que nous employons ce terme en divers sens ;
lesquels renvoient à des circonstances bien différentes les unes des autres. Ce qui fait dire à A.
Danto4 que l’un des problèmes que pose l’ensemble des prédicats esthétiques traditionnels
étudiés par les philosophes - en particulier le prédicat “est beau” - réside dans le fait qu'il
semble s'appliquer indifféremment aux œuvres d'art et aux simples objets réels; sans choquer
notre sensibilité verbale : il existe de belles peintures tout comme il existe de beaux couchers
de soleil. Mais on friserait l’absurde si on parlait de fleurs puissantes, alors qu'il est tout à fait
habituel d'appliquer ce terme à des dessins. Qui saurait se servir du langage du monde de l'art
et bien entendu aussi du langage ordinaire que celui-ci transforme, serait complètement
déconcerté s'il entendait quelqu'un parler de fleurs réelles en les qualifiant de fluides,
puissantes ou désenchantées. Les vraies fleurs ne peuvent posséder de telles qualités; certes
on peut les dire solide ; d’ailleurs tout objet matériel ne l'est-il pas en quelque façon ?5 Ce qui
importe donc essentiellement à Wittgenstein, consiste dans le fait de montrer que lorsqu’il
s’agit d’employer le terme “beau”, il se joue des jeux de langage différents. D’ailleurs, il pose
dans les Remarques Mêlées qu’: « Au contraire le jeu qu'il joue avec ce terme est d'une
extension très limitée. Mais en quoi cela s'exprime-t-il? Aurais-je donc présente à l'esprit une
certaine définition étroite du mot “beau”? Certainement non. - Peut-être au contraire ne
voudrais-je même pas comparer la beauté de l'expression des yeux avec celle de la forme du
3T. Sherman, Ingenierie culturelle, p. 70-71
4A. Danto, La Transfiguration du Banal, SEUIL, Paris, 1989.
5Mais faire remarquer cette solidité serait allée contre les intuitions de ce que Grice appelle les “implications conversationnelles”. A. Danto,
La transfiguration du Banal, SEUIL, Paris, 1989.

Evelyne Rogue
Langageetesthétique:Wittgensteinoul’ordredesraisons
3
nez »6. Réflexion qui vise ici essentiellement à mettre en évidence que l'usage du terme “beau”
ne renvoie pas à ce qu'il y aurait de commun à tout ce que nous nommons “beau”. Autrement
dit, par-delà l'usage que nous faisons de ce terme, il ne se trouve aucune réalité clairement
déterminée. Nous accorderons sans doute aisément à l’auteur que la beauté des yeux n'a rien
de comparable avec celle du nez, mais il nous faudrait alors aussi accepter cette autre
constatation de notre auteur selon laquelle : « Si vous arriviez dans une tribu dont nous ne
connaîtriez pas du tout le langage et que vous vouliez savoir quels mots correspondent, à nos
“beau”, “bon, etc., où est-ce que vous iriez chercher? Vous chercheriez des sourires, des
gestes, de la nourriture, des jouets. (Réponse à une objection) A quelle distance de
l'esthétique (et de l'éthique - Tractatus) normale nous mène-t-il. Nous ne partons pas de
certain mots, mais de certaines circonstances ou activités.7 » Ce ne sont donc pas tant les
mots, qui ont de l'importance que les circonstances dans lesquelles ils sont énoncés. On
comprend alors aisément que Wittgenstein reproche sur ce point, d'une manière générale,
“aux philosophes de (sa) génération, y compris Moore”, de prêter trop d'attention à la forme
des mots, et pas assez à leur emploi”. A ce propos d’ailleurs, il est à noter que le slogan : “ne
demande pas quel est le sens, demandez quel est l'usage”, tel que J. Wisdom l'a formulé8, fut
très populaire parmi les représentants de la philosophie analytique; et cela bien que n’ait
jamais été élucidée la question de savoir en quoi pouvait consister sa méthode de vérification;
si ce n'est que Wittgenstein met l'accent sur le fait qu'il y a bien des usages de propositions
hormis celui de la pure assertion9.
De plus, en ce qui concerne justement le problème de la vérification, s’il nous faut
accepter comme le soutiennent Carnap et Schlick que le critère de signification est la
vérification; alors nous ne pourrons que constater le caractère autoréfutatoire de cette
affirmation, invérifiable comme telle. Avant même de rappeler la théorie de ces auteurs, nous
aimerions redire que le critère de vérification ne revêt un sens qu’à la condition d’être relié au
questionnement comme instauration de la différence problématologique10. Le prix à payer
semble donc résider dans la prise en compte au niveau problématologique comme au niveau
thématique. Considération, à l’origine d’une limitation insoutenable pour le positivisme; cette
limitation résidant elle-même dans sa propre modalisation de la différenciation
problématologique. Ce n’est donc, semble-t-il, qu’en dehors d’elle-même que cette dernière
peut prendre toute sa signification. Cependant il serait aussi possible d’accorder au critère de
signification un sens limité, échappant en cela à l’autodestruction, en lui reconnaissant par
exemple une certaine capacité de différenciation des réponses par rapport aux questions;
possibilité qui aurait par ailleurs l’effet de faire passer en avant-plan le fait de la
problématologie. Dès lors, sa critique s’effondre dans son ambition monopolistique à l’égard
6L. Wittgenstein, Remarques Mêlées, 1933, p. 38
7L. Wittgenstein, Leçons sur l'esthétique, p. 17
8Cf. Logic and Discovery, p.87.
9Et comme le faisait remarquer Moore, “[Wittgenstein] semblait soutenir résolument qu’il n’y a rien de commun dans nos usages du mot
“beau”, disant que nous l’utilisons “dans une centaine de jeux différents” - que par exemple, la beauté d’un visage est quelque chose de
différent de la beauté d’une chaise ou d’une fleur ou de la reliure d’un livre”.
10Il vise à faire respecter celle-ci par une démarcation irréfutable des questions et des réponses établies au stade de la réponse.

Evelyne Rogue
Langageetesthétique:Wittgensteinoul’ordredesraisons
4
du répondre; répondre qu’il ne peut assumer que non thématiquement, en le réduisant à ce
qu’il pose d’emblée comme devant être le réducteur du répondre : à savoir le logico-
expérimental. Répondre à une question en l’affirmant insoluble est bien répondre parce que
l’on tient un discours, mais aussi dans la mesure où on le rapporte différentiellement et
explicitement à une question; de même que dissoudre est bien résoudre, comme nous le dit le
positivisme, sans pouvoir le justifier puisque cela serait faire appel à la différence
problématoloqique.
Afin de clarifier la thèse précédemment soutenue, il semble nécessaire de nous référer
au plus explicite, pensons-nous, des auteurs positivistes : M. Schlick11. Ce dernier soutient en
effet ce que Wittgenstein ne posait que de manière aphoristique dans le Tractatus ; à savoir
qu’un : « examen consciencieux montre que les diverses manières d’expliquer ce que l’on
entend par question ne sont rien d’autre, en définitive, que les diverses façons par lesquelles
on en trouve la réponse ». Ce qui se comprend mieux dès lors que : « Toute explication ou
indication du sens d’une question consiste toujours à stipuler le moyen de la résoudre12 ».
Entendons par là que toute question que nous nous posons, et à laquelle nous savons
pertinemment que nous ne pourrons pas donner de réponse correcte relève en définitive d’un
non-sens. « Considérons par exemple, la question ‘Quelle est la nature du temps?’. Que veut-
elle dire? Que signifient les mots ‘nature de”? Le scientifique pourrait, peut-être, inventer une
explication, il pourrait suggérer les propositions qu’il considérerait comme les réponses
possibles à cette question; mais son explication ne serait en définitive qu’une description de la
méthode de découverte de la réponse vraie parmi cet ensemble de possibles. En d’autres
termes, en donnant un sens à sa question, le savant la rend par là même logiquement soluble,
même qu’il n’est pas capable de la rendre pour autant empiriquement soluble. Sans une
explication de cet ordre, les mots ‘Qu’est-ce que la nature du temps?’ ne représenteront pas de
question du tout ». Le sens se trouve donc intimement - voire substantiellement - lié à la
solution que nous donnons à une question, dès lors que nous avons décidé de la poser. Et
Schlick de poursuivre tout naturellement son raisonnement en direction du principe positiviste
en vertu duquel “le sens est la vérification”13. Principe qu’il nous est possible de comprendre
- sinon du moins d’accepter - dès lors que nous savons qu’une proposition ne possède un sens
que si nous pouvons l’utiliser adéquatement, en situation d’une part, et que si l’auditoire peut
confirmer cette adéquation d’usage d’autre part. Autrement dit, une question n’a de
signification que si elle remplit deux conditions nécessaires : tout d’abord elle demande
réellement quelque chose ; et ensuite il nous est possible de trouver ce qu’elle requiert, c’est-
à-dire vérifier si une proposition y répond ou non. Mais Schlick n’est pas le seul à avoir
argumenté dans ce sens. En effet Carnap lui aussi soutient ce principe de signification, entre
autre pour attaquer Heidegger. Mais quelle que soit la raison pour laquelle Carnap adopte ce
11Dans un article écrit en anglais en 1935, paru dans la revue The Philosopher, et qui porte le titre “Questions insolubles?” (unanswerable
questions).
12Ce principe s’est avéré fondamental pour la méthode scientifique. Einstein par exemple, admet lui-même que c’est ce qui l’a conduit à la
théorie de la Relativité (...) Bref, une question qui est insoluble en principe ne peut avoir de sens, ce n’est même pas une question : ce n’est
rien qu’une suite de mots sans signification qui s’achève par un point d’interrogation (...).
13“Meaning is verification” dans un texte qui porte d’ailleurs ce titre et qui parut un an plus tard (1936).

Evelyne Rogue
Langageetesthétique:Wittgensteinoul’ordredesraisons
5
principe, il n’a pour raison d’être que le souci d’éviter un langage qui ferait croire que l’on
dispose de réponses, alors qu’en fait nous ne possédons que de questions. Un tel langage,
comprenons un langage dans lequel nous ne serions en présence que de questions se révèlerait
n’être in fine qu’un pseudo-langage; puisqu’il nous est impossible d’avoir des questions sans
posséder en même temps la faculté d’y répondre - à supposer évidemment qu’il s’agisse
réellement de questions14.
Dès lors, le critère de signification ne peut plus se soutenir de lui-même, et il le pourra
d’autant moins que la proposition selon laquelle “la signification est la vérification” est elle-
même invérifiable, donc absurde. De plus, dans la mesure où l’absence de fonction
problématologique n’a pas permis aux auteurs de ce critère de voir à quoi ce dernier répondait,
il en résulte une autojustification inassumable. A cela, il faudrait ajouter que le critère est
erroné, puisqu’il est de nature propositionnaliste, justificationnelle. Ainsi en négligeant son
origine, laquelle réside dans le fait d’établir un rapport question-réponse, il refoule toutes les
autres modalités possibles d’un tel rapport. Ce qui est cohérent puisque ce rapport n’est pas
posé comme tel, mais se trouve représenté au travers d’une particularisation possible, loin
d’être exemplaire bien qu’elle puisse apparaître comme plus évidente. En outre, il y est
supposé qu’on possède la réponse; de telle sorte qu’il n’y a plus qu’à vérifier l’ajustement,
l’adéquation -; ce qui est justement bien trop se donner par rapport à la réalité de l’intellection
et du sens. Dès lors, le critère de signification laisse échapper le phénomène du sens pris dans
sa globalité, et cela essentiellement parce qu’il le partialise au sein même du modèle
propositionnel. En effet, il ne peut que vouloir se justifier par soi-même, sans le pouvoir, car
ce qui serait susceptible de l’exliquer va à l’encontre du paradigme justificatoire, et à ce titre
se trouverait rejeté. Partant, de ce fait, le positivisme se trouve contraint d’ériger la
justification comme seule signification possible, et comme allant de soi, via l’alternative de
l’expérience et de la logique selon le type de discours à adopter. Par le refoulement de la
raison d’être problématologique de la démarche, le positivisme s’est donc érigé en doctrine
réductrice logico-linguistique, faisant tout naturellement premier ce logico-linguistique, et
tuant par là-même toute racine problématologique, dans le seul but de pouvoir se poser, ou
s’autoposer, en conception autonome de la science et du langage, avec le questionnement
comme dérivé parmi d’autres15. Carnap fut alors obligé d’accepter l’idée qu’une question pût
être totalement externe par rapport à un cadre de désignation, de référence, de résolution, tout
en ayant du sens ; et nous en tenons pour preuve le fait qu’il affirme lui-même qu’ : « une
question externe est de nature problématique et requiert à ce titre un examen plus
approfondi ». Un paradoxe inévitable demeure alors : comment prouver que l’on répond à une
question en montrant qu’on ne peut pas y répondre ? Sans doute, faut-il voir dans ce fait une
conséquence du critère de signification, puisque rien ne se vérifie comme réponse pour les
questions dépourvues de sens. Faute de faire accéder alors la différence problématologique au
concept, il ne se présente plus devant nous qu’une formule pour le moins étrange. En
14La vérification est l’alignement du sens sur la science. En réalité, il s’agit encore d’un critère propositionnaliste, car on ramène une fois de
plus le problématique à l’assertorique lequel le définit.
15Le critère de la vérification n’a plus été qu’une guillotine logico-épistémique, une norme et un critère de jugement au sens le plus terroriste
du terme. Carnap survécut bien à la mort du mouvement qu’il contribua à articuler.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%