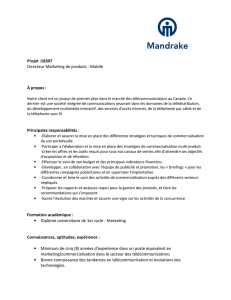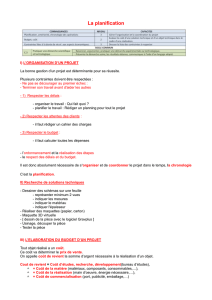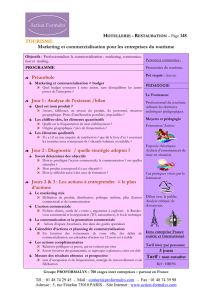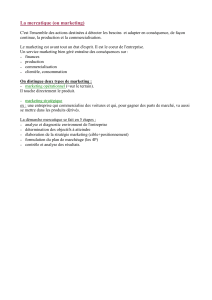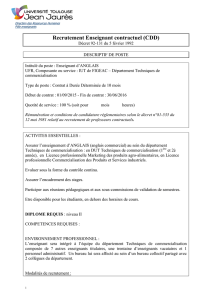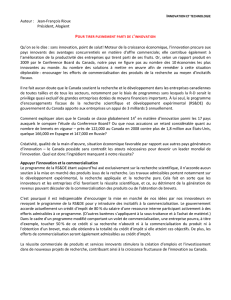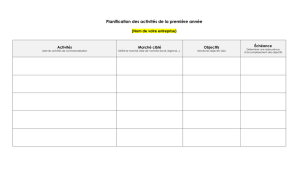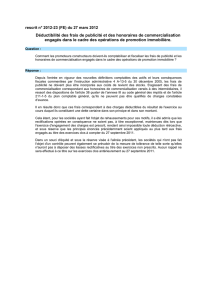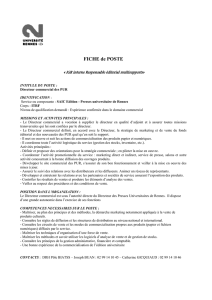L`avenir des offices de commercialisation agricole dans le contexte

« L’avenir des offices de commercialisation agricole
dans le contexte canadien et québécois »
Mémoire présenté par :
Sylvain Charlebois, DBA
Professeur agrégé en marketing à l’Université de Régina
Devant la :
Commission sur l’avenir de l’agriculture
et de l’agroalimentaire québécois
Audiences nationales (Québec)
28 août 2007

2
Introduction
1
Les travaux de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois,
en particulier en ce qui a trait à l’avenir des offices de commercialisation agricole (aussi
connus sous différents vocables comme les systèmes de quotas, la gestion de l’offre, les
arrangements de commercialisation ordonnée, notamment) permettent de soulever des
questions importantes pour les producteurs agricoles dont la subsistance dépend du commerce
agroalimentaire, non seulement avec les États-Unis ou d’autres pays, mais également pour les
échanges intérieurs (Labrecque et Charlebois, 2006; Moens, 2006).
Le Québec vend à l’extérieur de ses frontières plus de 60 % de sa production intérieure brute
de biens et services, dont les deux tiers à l’international. Toute perturbation commerciale peut
nuire à son bien-être économique. L’industrie agroalimentaire canadienne est présentement
sujette à des pressions internationales sans précédent qui ont provoqué de l’incertitude et des
appels au changement dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Ce
mémoire se concentre particulièrement sur le système canadien d’offices de
commercialisation agricole et sur le fait que ce modèle agricole subit de lourdes pressions
pour qu’on lui retire son mandat protectionniste, qu’il cesse de restreindre la production et
qu’il devienne plus ouvert à la concurrence locale et internationale, particulièrement pour des
denrées comme les produits laitiers, les œufs et la volaille.
Avant la réunion de Genève sur le commerce mondial en 2004, les membres de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) ont accepté de lancer un processus de réduction des
subventions agricoles. La rencontre, tenue en août, a isolé le Canada des autres pays membres
à cause de son soutien aux offices de commercialisation agricole, au point où le président de
la Commission canadienne du blé aurait affirmé : « C’était un contre 146. Nous n’avions
absolument aucun allié à la table de négociation, alors il ne fait pas de doute que l’OMC ne
sera une amie ni de la gestion de l’offre ni de la Commission canadienne du blé ».
Pendant les négociations commerciales multilatérales du cycle de Doha en 2005 et 2006, le
Canada a encore dû défendre les quotas de lait dont profitent les producteurs laitiers depuis
40 ans, suite à des plaintes d’autres pays, notamment les États-Unis et la Nouvelle-Zélande
(Corcoran, 2005b; Vieira, 2005, Petkantchin, 2006). L’OMC a averti le Canada qu’il ne
respectait pas ses engagements envers une libéralisation commerciale (Gervais et Larue,
2005; Hart, 2005a; Petkantchin, 2006).
Il est ironique de constater que le Canada ait accepté de limiter ses restrictions à l’importation
de produits laitiers et de la volaille pendant le cycle de l’Uruguay du GATT, en vertu des
dispositions de l’Accord sur l’agriculture entrées en vigueur en janvier 1995, au même
moment que la mise en place de l’OMC. Cependant, les restrictions commerciales sont
passées de quotas non tarifaires à l’importation (c’est-à-dire des limites quantitatives) à des
quotas tarifaires pour les importations de produits agricoles sous l’égide de la gestion de
l’offre (Veeman, 1997). Ces tarifs élevés s’appliquent au-delà d’une quantité plutôt faible de
biens importés et ils seront progressivement réduits avec le temps.
Les tarifs à l’importation se situent présentement à des niveaux de l’ordre de 299 % pour le
beurre, 246 % pour le fromage, 238 % pour le poulet et 168 % pour les œufs, des taux presque
1
Note : le présent mémoire est une version remaniée d’un article paru récemment dans le British Food Journal
(Robert D. Tamilia et Sylvain Charlebois, « The importance of marketing boards in Canada: a twenty-first
century perspective », British Food Journal, Vol. 109, No. 2, 2007, pp. 119-144).

3
obscènes pour des denrées aussi communes (Hart, 2005a). L’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) a estimé que les prix canadiens du lait ont été de
deux à trois fois plus élevés que les prix mondiaux depuis 1986 (Petkantchin, 2005). Il faut
noter que les comparaisons de prix de l’OCDE ne sont pas au détail, mais à la sortie de la
ferme, ce qu’on appelle les prix industriels du lait (Lippert, 2001). De plus, dans les dix
dernières années, les prix du lait au Canada ont augmenté de près de 50 % et d’un peu plus de
10 % dans les deux dernières années de la période, alors que la consommation de lait par
habitant a diminué de près de 15 % entre 1986 et 2003 (Corcoran, 2005b; Petkantchin, 2005).
Après près de huit décennies d’existence des offices de commercialisation au Canada et de
longs débats provoqués par des économistes agricoles préconisant des réformes depuis
longtemps nécessaires, le Canada doit maintenant faire face à des pressions mondiales
sérieuses qui demandent la modification de son système de gestion de l’offre.
Objectif de ce mémoire
Depuis les années 1930, l’industrie agricole canadienne a répondu assez bien aux
changements politiques, économiques et technologiques. En particulier, les offices de
commercialisation agricole ont fonctionné plus ou moins comme prévu, du moins du côté de
l’offre (c’est-à-dire du point de vue des fermiers ou producteurs) ainsi que d’après les
objectifs du gouvernement. Malgré la diversité des produits impliqués (blé, poulet, lait, etc.)
et la compétence partagée du Parlement fédéral et des provinces en agriculture, cette industrie
n’est pas bien connue des consommateurs. L’agriculture évoque souvent une image bucolique
et même romantique de la ferme familiale où les fermiers, « pris d’un amour profond pour la
Terre et pour l’archarnement salutaire du travail agricole, luttent pour gagner leur pitance
grâce à leur dévouement héroïque » (Corcoran, 2005a). Pourtant, seulement 18 500
producteurs laitiers possèdent l’autorisation légale de produire du lait au Canada. Même si
nous incluons leur famille immédiate, cela ne représente que 0,26 % de la population
canadienne (Stanbury, 2002; Hart, 2005a, p. FP15). De plus, il devient de plus en plus
difficile d’accepter leur statu quo étant donné « le nombre décroissant de producteurs laitiers
et de volaille qui constituent moins de 1 % de l’économie canadienne qui continuent à résister
aux pressions tant locales qu’internationales » (Hart, 2005b, p. FP23).
Ce mémoire se concentre sur l’importance des offices de commercialisation dans le marché
mondial actuel en constante évolution et de la nécessité de les réformer en fonction de
l’économie de marché. Premièrement, nous traitons des différentes façons de définir les
offices de commercialisation agricole. Ensuite, nous présentons une courte histoire de leur
mise en place ainsi que leurs objectifs et leur importance pour l’économie canadienne. La
nature politique et juridique de ces organismes est aussi traitée puisqu’ils posent des questions
de droit civil et constitutionnel qui sont relativement peu connues et rarement discutées. Nous
présentons une analyse expliquant comment ont été déréglementées certaines agences de
gestion de l’offre dans certains pays, notamment les offices de commercialisation du lait en
Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. La façon dont la libéralisation des
marchés a été amenée dans ces pays est très pertinente pour le contexte agricole canadien
actuel. Finalement, nous effectuons quelques recommandations pour rendre le secteur agricole
plus adapté à l’économie d’aujourd’hui afin que le Québec et le Canada puissent faire face à
la concurrence locale et mondiale.

4
Qu’est-ce qu’un office de commercialisation agricole?
Les offices de commercialisation agricole ne sont pas uniques au Canada, mais existent aussi
en Europe et ailleurs. Cependant, on n’en trouve aucun aux États-Unis (Green, 1982).
Plusieurs définitions ont été proposées pour décrire la nature et la fonction d’un office de
commercialisation. En vertu de l’argument des industries naissantes, ils sont aussi plus
présents dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Les offices de
commercialisation canadiens peuvent être de nature fédérale, provinciale, interprovinciale ou
peuvent même être des sociétés d’État comme la Commission canadienne du blé. On les
classifie souvent selon leurs fonctions de commercialisation (c’est-à-dire les services
commerciaux qui doivent être rendus pour amener les produits de la ferme aux marchés),
dépendamment de leur implication dans le processus. Bien qu’il existe plusieurs types
d’offices de commercialisation (par exemple les régies, les organismes de stabilisation des
prix et les commissions détenant un monopole des exportations), les organismes de gestion de
l’offre sont le centre d’attention principal de ce mémoire. Nous étudions aussi brièvement la
nature des organismes de promotion ci-après.
Les organismes de promotion peuvent mener des études de marché, promouvoir les ventes et
même prélever des droits de la part des producteurs pour effectuer ces tâches. Cependant, les
organismes de promotion ne sont pas impliqués dans les opérations de commercialisation en
tant que telles (par exemple acheter et vendre des produits ou autres tâches transactionnelles).
Ils agissent davantage comme la branche publicitaire et promotionnelle d’une denrée agricole
et sont donc impliqués dans la stimulation de la demande générique (même si l’organisme
peut promouvoir la demande d’une marque particulière s’il en possède). De tels organismes
ne sont pas ceux qui donnent une mauvaise réputation aux offices de commercialisation, du
moins au Canada.
Les organismes de gestion de l’offre sont les plus problématiques d’un point de vue de
politiques publiques, puisqu’ils contrôlent l’approvisionnement en accordant des quotas de
production individuels à des producteurs. De tels organismes de gestion de l’offre ressemblent
à un cartel et fonctionnent comme un monopole autoréglementé (Loyns, 1980). Ils contrôlent
la production de chaque producteur, mais aussi l’accès à l’industrie et fixent les prix payés par
les acheteurs. Il n’est pas surprenant qu’ils aient été la principale question traitée dans la
littérature agricole canadienne. Plusieurs pays développés (comme le Canada, l’Australie et le
Royaume-Uni) et la plupart des pays en voie de développement ont présentement ou ont eu
par le passé de tels organismes.
Nous préférons employer la définition des offices de commercialisation donnée par Forbes
(1982) puisqu’elle est plus adéquate pour les organismes de gestion de l’offre : « une
organisation obligatoire de commercialisation horizontale de produits agricoles primaires ou
transformés agissant en vertu d’une autorité déléguée par le gouvernement » (p. 2). Son aspect
obligatoire signifie que toutes les fermes produisant une certaine denrée dans une région
spécifique (une province par exemple) doivent respecter les règles imposées par l’office et
accepter son plan de commercialisation. Le statut de membre est non seulement obligatoire,
mais on empêche aussi les autres de le devenir à moins que certaines conditions d’accès au
marché soient remplies, comme la capacité d’acheter un quota déjà existant. L’aspect
horizontal signifie que l’office possède le contrôle direct et indirect de toute l’offre agrégée de
la denrée grâce à son contrôle de la production de toutes les fermes participant au processus
de commercialisation. En d’autres mots, l’office fixe des limites à la production. L’aspect
délégation signifie que le gouvernement a confié des pouvoirs juridiques aux offices en ce qui

5
concerne le prix, la production et d’autres domaines économiques ou non influençant les
opérations de l’office. En pratique, l’office fonctionne comme un agent de facto pour les
différents ordres de gouvernement. C’est pourquoi Lippert (2001) préfère les appeler des
« cartels supervisés par le gouvernement ».
Les États-Unis n’ont pas d’offices de commercialisation agricole, mais ont des programmes
volontaires de soutien de prix, des accords de commercialisation et des ordres de
commercialisation qui sont aussi présents dans plusieurs autres pays, même ceux qui
possèdent des offices de commercialisation pour des denrées qui ne sont pas sous l’autorité de
la gestion de l’offre (par exemple le Canada). Selon Hoos (1979), les États-Unis ont déjà
réfléchi à la possibilité de mettre en place des offices de commercialisation. Toutefois, les
pouvoirs monopolistiques dont ils auraient profité, notamment sous forme de quotas, seraient
allés à l’encontre de l’idéologie de libéralisation des marchés adoptée par la Federal Trade
Commission, le ministère de la Justice et plusieurs autres intervenants, même au niveau des
États. Leur création aux États-Unis aurait certainement été contestée devant les tribunaux et
ils auraient sans doute été jugés illégaux.
La structure organisationnelle des offices de commercialisation
Il existe essentiellement autant de structures organisationnelles qu’il existe d’offices de
commercialisation. Chaque office est organisé de manière à refléter les sources de conditions
d’approvisionnement particulières à la denrée en cause. La plupart des offices de
commercialisation canadiens ont un dirigeant (directeur) élu par les producteurs membres
eux-mêmes (Lippert, 2001). Les deux ordres de gouvernement nomment d’autres personnes
pour diriger l’office. Des consommateurs peuvent aussi être membres mais comme Forbes
(1982) l’expliqua, ils sont trop souvent des représentants symboliques, non familiers avec la
commercialisation agricole, plus susceptibles d’être des femmes ou des épouses dont le mari
est un puissant fermier. En d’autres mots, la composition des offices de commercialisation est
lourdement axée en faveur des intérêts des producteurs.
Tous les offices de commercialisation établissent des plans afin de coordonner et de contrôler
les activités d’achat et de vente de leur denrée. La collecte d’information, la fixation des prix
et la gestion de l’offre pour les marchés intérieur et d’exportation sont quelques-unes des
activités dont s’occupent les offices de commercialisation. Le budget d’exploitation de la
Commission canadienne du lait, par exemple, est d’environ 6 millions $ par année. D’autres
offices ont des budgets plus importants, mais incluent aussi leurs activités de promotion. Les
coûts administratifs comme les frais de bureau, les salaires, les dépenses juridiques et de
comptabilité, les voyages, les coûts d’élections, de même que les coûts de gestion des
programmes d’aide et l’accomplissement de certaines fonctions de commercialisation (par
exemple les fonctions d’accumulation, de tri, d’allocation et d’assortiment) qui nécessitent des
infrastructures à forte intensité en capital et la notation, l’étiquetage, la promotion et les
relations publiques – font qu’elles sont une solution de rechange coûteuse à un mécanisme de
marché ou même à des coopératives agricoles.
En général, les offices de commercialisation ont tous les attributs d’une organisation
commerciale qui opère dans un environnement sans marché. Quelques offices de
commercialisation agissent tout au long d’une longue chaîne d’approvisionnement, par
exemple pour les produits laitiers, les œufs, la dinde, le poulet ou le tabac. Dans ces cas, les
offices de commercialisation s’enorgueillissent d’un grand contrôle et de beaucoup de pouvoir
au sein de l’industrie, partout au pays. Les facteurs qui différencient un office de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%