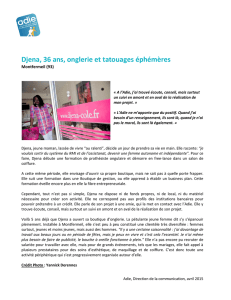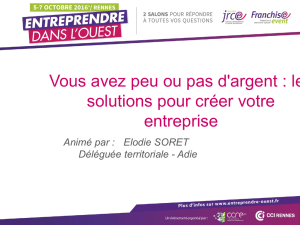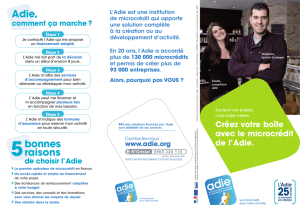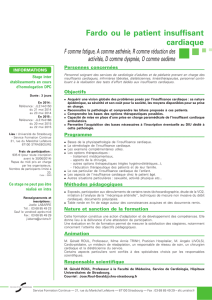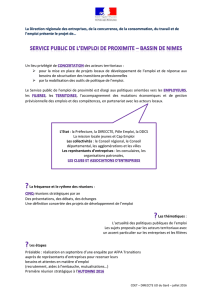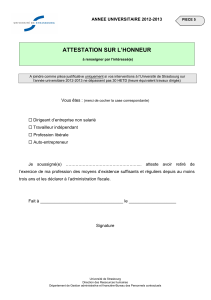concilier performance économique et responsabilité - Inet

Entretiens territoriaux de Strasbourg, 5 et 6 décembre 2007 1
Egalité des chances :
concilier performance économique et responsabilité sociale
Atelier organisé par La Poste
- SYNTHESE -
Intervenants :
Claude BREVAN, administrateur déléguée aux quartiers sensibles, association ADIE
Laurent DAVEZIES, professeur, institut d’urbanisme de Paris, université de Paris Val de Marne
Georges LEFEBVRE, directeur général du Groupe La Poste
Bernadette VERGNAUD, députée européenne, Parlement européen
L’atelier était animé par Jacques SAVATIER, directeur des affaires territoriales et du service
public, La Poste
I. Introduction (Georges LEFEBVRE)
La Poste, entreprise de produits et de services, souhaite développer ses activités en s’appuyant sur
la confiance de ses clients et, plus largement, de ses partenaires et de l’ensemble des
consommateurs. Cette confiance repose sur la qualité des services et, également, sur la qualité des
relations qu’elle entend lier avec ces différents acteurs. Ceci passe très largement par ses
personnels. La Poste a donc développé une politique sociale particulière, basée sur un recrutement
ouvert et une plus grande égalité des chances dans le déroulement carrière. La relation de confiance
s’appuie également sur les engagements sociétaux et environnementaux que l’entreprise a pris.
Pour la Poste, performance économique et responsabilité sociale vont donc de pair et, lorsque ces
notions sont bien articulées, constituent même un facteur de croissance et de différenciation
concurrentielle. Cet atelier permettra d’évoquer l’efficacité de cette combinaison.
II. Panorama du développement territorial (Laurent DAVEZIES)
Loin d’être systématiquement opposés, les termes « performance économique » et « responsabilité
sociale » peuvent correspondre à un seul et même projet. Celui-ci a été très clairement dénommé au
niveau européen : « économie sociale de marché ».
Pourtant, au niveau territorial, deux forces qui semblent antagonistes font leur apparition. D’une
part, la mondialisation, invincible et brutale, déchire le territoire. Les économistes constatent que
les facteurs de production se concentrent dans les zones les mieux équipées. Il n’y a donc d’avenir

Entretiens territoriaux de Strasbourg, 5 et 6 décembre 2007 2
que pour les territoires excellents. D’autre part, derrière ces mécanismes plutôt cruels, des
mécanismes, au moins aussi puissants, de cohésion, de solidarité et d’égalisation entre territoires
apparaissent. Ainsi, si le taux d’ouverture de l’économie française a évolué de 13 % à 26 % en
trente ans, les dépenses publiques sont également passées de 26 % à 53 % du PIB. La montée en
puissance des mécanismes de mutualisation constitue donc le mouvement le plus important, en
termes absolus, et un mouvement comparable, en termes relatifs.
D’autres phénomènes opposés sont enregistrés au niveau des territoires. Les activités les plus
productives se concentrent dans les régions les plus riches. Ce phénomène nouveau est très
inquiétant. On passe d’un système d’avantage comparatif lié aux coûts de main d’œuvre à un
système d’avantage cumulatif. Le plus gros actuellement sera le plus gros demain, situation qui
tend naturellement vers des systèmes monopolistiques. Parallèlement à cette concentration de la
contribution à la croissance, le bénéfice de la croissance s’étale. Les disparités de revenu en France,
selon les territoires, n’ont pas cessé de diminuer depuis les années 1960. Cette évolution s’est faite
au même rythme que la montée en puissance des fonds publics, autant sous les gouvernements de
droite que de gauche. D’autres éléments, comme l’essor du tourisme, interviennent dans cet
étalement. Ainsi, le monde rural français est actuellement aussi peuplé que dans les années 1950, si
l’on tient compte des mobilités liées au tourisme et aux résidences secondaires. Enfin, les disparités
au sein des zones urbaines ont explosé. Les problèmes réels de rupture et de perte de cohésion
apparaissent essentiellement dans les métropoles.
On se retrouve ainsi dans une situation étonnante. Les territoires qui contribuent le moins à la
croissance nationale enregistrent des taux de croissance très rapide et des soldes migratoires très
positifs alors que les métropoles, qui tirent la croissance nationale, sont en grande difficulté. Il n’est
pas certain que cette situation aille dans le bon sens. Il faut donc peut-être aborder la thématique de
la responsabilité sociale et de l’efficacité économique d’une manière un peu différente de la façon
dont on traite traditionnellement cette question.
III. Accessibilité au crédit des populations les plus démunies (Claude
BREVAN)
L’ADIE, Association pour le droit à l’initiative économique, a été fondée par Maria Novak, il y a
une vingtaine d’années, sur le modèle de la Grameen Bank. Des initiatives européennes existaient
déjà. La France, où il existe une immense difficulté à faire confiance aux personnes insolvables ou
exclues du monde économique, était même plutôt en retard sur cette question. Il s’agit donc d’aider
les personnes qui le souhaitent – allocataires des minima sociaux ou chômeurs qui n’ont pas accès
au crédit bancaire – à s’insérer dans l’économie.
En 2006, la structure a financé plus de 7 000 projets avec un taux de survie des entreprises à deux
ans, qui est identique à celui de toutes les autres entreprises. A l’issue de cette même période, 75 %
des personnes financées sont sorties durablement du système de minima sociaux. Ce taux
d’insertion est très intéressant, même si la population visée est volontariste et si tous les projets
présentés ne sont pas forcément financés. Le fait même que ce public soit défini par son statut
d’allocataire est parfaitement anormal. Il s’agit d’un public très varié, notamment en matière
d’éducation. Ces personnes rencontrent des difficultés à s’insérer dans le monde économique car
elles n’ont pas accès au crédit bancaire et ne bénéficient pas d’un accompagnement pour les aider
dans les premiers pas de leur projet. L’ADIE porte également la volonté de revaloriser l’économie
populaire. Certains métiers de service ne nécessitent pas de grosses structures et s’exercent dans
des milieux diffus dans lesquels les entreprises les plus importantes n’interviennent pas. Ces micro-
activités répondent donc à des besoins réels de la société.

Entretiens territoriaux de Strasbourg, 5 et 6 décembre 2007 3
La loi bancaire autorise l’association à proposer des prêts à taux d’intérêt ou des prêts d’honneur.
Les sommes correspondantes sont peu importantes, un plafond de 10 000 euros étant fixé par
enveloppe de financement. Ces prêts sont associés à d’autres aides versées par l’Etat ou par les
collectivités territoriales. Les bénéficiaires présentent un plan de financement et un projet précis. Ils
bénéficient, pendant toute la durée de remboursement du prêt, d’un accompagnement. L’ADIE
tente également de régler les problèmes d’assurance ou de locaux qu’ils peuvent rencontrer.
L’activité de l’association se situe donc sur le secteur des toutes petites structures, sachant que la
France a la spécificité d’être l’avant-dernier pays européen en matière de travail indépendant. Il
s’agit d’une société de salariés où, de plus, tout encourage le travail au noir. Pourtant, malgré ces
verrous, il existe un potentiel fort et le taux de satisfaction des personnes ayant tenté l’aventure
avec l’ADIE est important. Les métiers concernés sont très variés. Ils vont du traducteur technique
au marchand sur les marchés. L’encadrement très strict des professions en France crée certaines
difficultés supplémentaires. Enfin, l’ADIE travaille pour que les entreprises créées soient
considérées, à l’issue des deux ans, comme des entreprises comme les autres. Or, elles n’ont pas
toujours accès aux services bancaires au terme de cette période.
En voyant comment La Poste travaille, dans certains quartiers, vis-à-vis des personnes à très faibles
ressources, on mesure le rapport existant entre une forme de « temps social » et l’économie
dégagée face à celui-ci. L’ADIE travaille dans un cadre similaire. Pour faire émerger cette
économie, il faut lui consacrer un certain temps qui n’est pas complètement rémunéré.
IV. Les services d’intérêt général sous l’angle européen (Bernadette
VERGNAUD)
La croissance économique n’a de sens que si elle est au service du développement. Elle ne saurait
constituer un seul objectif en soi. Ceci correspond à la vision européenne qui a été soutenue à
Lisbonne et à Göteborg et tendait à créer l’économie la plus dynamique, cohésive et durable du
monde. Le développement doit effectivement être durable d’un point de vue social, écologique et
économique, ce qui nécessite des mesures garantissant l’égal accès de tous aux services publics.
Dans cet objectif et dans le cadre de la mondialisation, l’Europe apparaît comme l’unique échelon
pertinent, sachant que les seules règles du marché ne peuvent surmonter la stagnation économique
et l’exclusion sociale.
La construction européenne a affiché, dès ses débuts, l’objectif de construire une économie de
marché sans entrave aux échanges. Toutefois, ce système génère des déséquilibres et de nombreux
citoyens s’interrogent, à juste titre, sur la nature et la finalité d’un projet trop souvent dominé par
une logique de marché et de concurrence. Deux questions se posent dans ce cadre. Dans quelle
mesure la construction européenne a-t-elle un impact sur le service public ? Dans quelle mesure le
service public peut-il être le moteur d’une refondation de l’Europe ?
Chaque pays a un mode propre d’organisation et de gestion de ses services et de son territoire. Il
faut donc déjà s’entendre sur le terme et le contenu de la notion de service public. L’expression
« service d’intérêt général » a ouvert un consensus entre tous les pays, mais il faut savoir distinguer
ces services et les services d’intérêt économique général. Ces derniers sont toujours soumis aux
règles du marché dans la limite du bon accomplissement des missions particulières qui leur sont
confiées. Alors que les services d’intérêt général (éducation, culture et santé) ont toujours été
considérés comme non-marchands, la quasi-totalité des services prestés dans le domaine social
peuvent être considérés comme des services économiques.
A partir de l’acte unique de 1986, une politique de libéralisation a donc été mise en place. Mais, le
terme « libéralisation » ne signifie pas « privatisation ». Il illustre simplement le fait qu’on casse

Entretiens territoriaux de Strasbourg, 5 et 6 décembre 2007 4
une exclusivité en matière de production et de fourniture d’un service. Les principes du marché
concurrentiel entrent en contradiction avec le subventionnement de certaines entreprises, sauf pour
certaines missions spécifiques d’intérêt général comme, dans le cas de La Poste, la desserte de
zones géographiques peu rentables. Ceci explique l’importance des débats qui traversent
actuellement l’Europe sur la définition des aides d’Etat, de la compensation de service public, de
l’obligation de service universel ou de la péréquation tarifaire. Ces notions fondamentales
recouvrent la question de la répartition des compétences entre les Etats membres et l’Union
Européenne et doivent être précisées.
Sans cadre juridique clair, le financement et la gestion des services publics en Europe dépend du
développement, imprévisible et complexe, de la jurisprudence de la Cour de justice européenne.
C’est pourquoi une demande forte est exprimée pour que la Commission européenne élabore une
directive cadre délimitant clairement les responsabilités des Etats et de l’Union, définissant
différentes notions et établissant les cadres du financement de ces services. L’incertitude juridique
ne peut perdurer si l’on souhaite que les citoyens européens reprennent confiance dans le projet
communautaire.
L’Europe ne peut pas être accusée de démanteler le service public puisque les Etats et les
collectivités locales conservent la maîtrise de la définition des services publics qui viennent en
complément des services publics universels européens. Ils gardent aussi le droit de définir les
statuts des entreprises publiques et de leurs agents. Or, souvent, on ne dissocie pas, en France, le
discours sur les missions de celui concernant les statuts.
A l’heure actuelle, les Etats sont incapables d’alimenter financièrement le développement des
grandes entreprises nationales qui ont vocation à devenir européennes. La réponse au nouvel ordre
mondial est donc de nature politique. Elle nécessite un dépassement, volontaire et affirmé, du fait
national par un statut clarifié en droit positif européen sur les services publics. La réticence de la
Commission européenne à l’égard d’une législation transversale s’explique par l’existence, en
Europe, de trois grands clivages politiques :
• la stratégie libérale dans laquelle le consommateur prime sur le citoyen ;
• la stratégie intermédiaire privilégiant la gestion des grands réseaux nationaux de service public,
à caractère industriel, par des directives sectorielles ;
• la stratégie juridique qui n’existe pas et s’articulerait autour d’une directive cadre reconnaissant
une société de services publics au niveau européen.
Ce débat est déjà rouvert au sein du Parlement européen. L’article 14 du nouveau traité de
Lisbonne donne, pour la première fois, une valeur juridique aux services d’intérêt général. Mais, la
Commission européenne, dans une communication datant du 20 novembre, se refuse toujours à
légiférer sur cette question, comme si le protocole qui allait être signé lui servait d’alibi pour
s’exonérer d’un cadre juridique. Or, l’article 14 est loin d’être suffisant pour organiser la gestion et
le financement de ces services.
Ces discussions étant très importantes en France, la future présidence française devra appréhender
clairement les enjeux territoriaux et sociaux des politiques européennes communautaires. Il faudra
rapidement choisir entre une société de cohésion et une société de compétition. Les services publics
constituent, en cela, un défi que l’Europe doit relever très rapidement si elle veut contribuer à faire
vivre un vrai modèle social européen.

Entretiens territoriaux de Strasbourg, 5 et 6 décembre 2007 5
V. Stratégie sociale du Groupe La Poste (Georges LEFEBVRE)
La Poste éprouve la nécessité très forte de concilier son développement économique, indispensable
à sa survie, et la responsabilité sociale qui est la sienne. Le développement responsable constitue
donc un axe majeur de sa stratégie.
En termes de politique sociale, ceci se traduit par la volonté de s’appuyer sur l’engagement des
collaborateurs de la société. A la suite du changement de statut de 1990, La Poste a
progressivement adapté ses besoins en ressources humaines à son activité par l’emploi de CDD. Si
cette idée était économiquement bonne puisqu’elle a permis de dégager des économies sensibles,
elle a constitué une erreur en termes de qualité de service. Contrairement à la majorité des autres
opérateurs postaux européens, l’entreprise fait donc désormais le pari d’un emploi de qualité. En
revanche, elle demande à ses collaborateurs d’être mobiles, capables de s’adapter au travers de la
formation et d’avoir des régimes de travail qui ne sont pas toujours réguliers.
La Poste représente 1 % du PIB français et 1 % de la population active. Sa place est très importante
dans la société dont elle se veut le miroir. La population féminine est aussi importante que la
population masculine. La volonté d’intégrer les minorités est très forte. Enfin, il existe une réelle
promesse de développement à l’intérieur de l’entreprise. La Poste fait donc le pari que sa réussite
économique passe par sa responsabilité sociale. Au-delà de la mise en place de régulateurs dans le
cadre de la libéralisation des marchés, elle milite également pour une régulation sociale.
VI. Echanges
Réaction face à l’intervention de Monsieur Lefebvre sur l’emploi dans son entreprise
Il n’est pas possible de demander à un salarié en CDD à temps partiel le même engagement que
celui d’un fonctionnaire ou d’un salarié en CDI. Sur la base de ce constat, La Poste a décidé de
recruter des collaborateurs en CDI et à temps complet.
Ressources de l’ADIE
L’ADIE travaille essentiellement à partir de fonds bancaires, sachant qu’elle dispose également de
quelques fonds propres et que le mécénat d’entreprises démarre.
Présence et heures d’ouverture de La Poste dans certaines communes
La Poste est toujours une entreprise publique. Par ailleurs, la finalité du bureau de poste n’est pas
d’être ouvert, mais de servir des clients. La situation dans laquelle le guichetier attend le client n’a
économiquement pas de sens. Enfin, les points de contact n’ont pas diminué, mais la forme de la
présence de La Poste a changé. En particulier, elle partage sa présence avec d’autres activités
économiques afin d’assurer une plage d’ouverture plus importante.
Démographie rurale, désertification et inégalité des territoires
Le fait même que de nombreux habitants des banlieues déménagent en zones rurales démontre que
celles-ci se portent mieux aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Par ailleurs, la question du peuplement a
été évoquée en termes de présence, et non en termes d’habitants recensés.
 6
6
1
/
6
100%