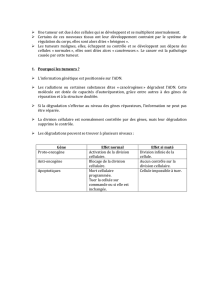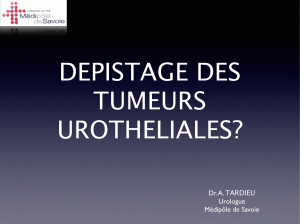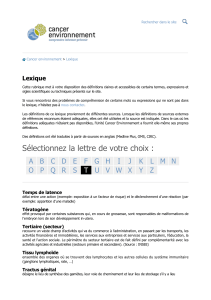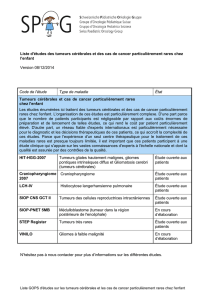Conduite à tenir devant la découverte dPune tumeur abdominale de

Conduite à tenir devant
la découverte d’une tumeur
abdominale de l’enfant
Sabine Sarnacki
1,4
, Hervé Brisse
2
, Gudrun Schleiermacher
3
,
François Doz
3,4
1
Service de chirurgie pédiatrique, Hôpital Necker Enfants-Malades, 149 rue de Sèvres,
75015 Paris
2
Département d’imagerie, Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75005 Paris
3
Département d’oncologie pédiatrique, Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75005 Paris
4
Faculté de Médecine Paris Descartes
Les tumeurs abdominales de l’enfant sont souvent de découverte fortuite. Leur
diagnostic étiologique repose sur une évaluation des données cliniques et radio-
logiques. Il est avant tout nécessaire de préciser la topographie exacte de la
tumeur : rétropéritonéale (rénale ou extra-rénale), intrapéritonéale (hépatique ou
extra-hépatique) ou abdomino-pelvienne. Cette localisation qui oriente déjà le
diagnostic est au mieux précisée par une échographie puis souvent par une IRM
ou un scanner abdomino-pelvien. Les autres explorations sont au mieux menées
en centre spécialisé et permettent de poser rapidement le diagnostic étiologique,
d’effectuer le bilan d’extension et de caractériser les paramètres biologiques de
la tumeur. La prise en charge des tumeurs abdominales de l’enfant est une
urgence qui doit être réalisée en concertation pluridisciplinaire, permettant de
planifier les prochaines étapes diagnostiques et thérapeutiques.
Mots clés : diagnostic, tumeur pédiatrique, abdomen, pelvis
La découverte, souvent fortuite,
d’une masse abdominale palpable
chez l’enfant nécessite un diagnostic
précis et rapide, car elle est le signe
clinique révélateur le plus fréquent
d’une tumeur solide maligne. De plus,
certaines tumeurs bénignes peuvent
également se présenter comme une
masse abdominale. Le diagnostic de
fécalome sur constipation doit être
un diagnostic d’élimination qui ne
peut être retenu chez l’enfant que
dans le cadre d’une maladie de
Hirschsprung ou d’une maladie neu-
rologique centrale ou périphérique.
La découverte d’une masse abdomi-
nale chez l’enfant doit donc conduire
systématiquement à la réalisation
d’une imagerie non invasive de pre-
mière intention. Celle-ci permet de
préciser la topographie de la masse
et ainsi d’orienter le diagnostic étiolo-
gique. Les examens complémentaires
radiographiques, biologiques et, selon
les cas, anatomo-pathologiques, sont
au mieux réalisés en milieu spécialisé
pour aboutir rapidement au diagnostic
étiologique et à la mise en route du
traitement spécifique.
Lors de l’examen clinique, la pal-
pation prudente de l’abdomen précise
la topographie et les mensurations de
la masse, sa consistance dure, ferme
ou molle, l’aspect de ses contours
ainsi que l’existence ou non d’un
contact lombaire. Il est important de
rechercher si la masse peut être mobi-
lisée ou non, car cela signe une loca-
lisation ovarienne ou mésentérique et
restreint le champ des diagnostics pos-
m
t
p
Tirés à part : S. Sarnacki
doi: 10.1684/mtp.2009.0208
mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009
Dossier
29
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

sibles. Des symptômes digestifs, urinaires, endocriniens
ou neurologiques doivent être recherchés, car ils peuvent
là encore orienter le diagnostic. Une altération de l’état
général avec perte pondérale ou des douleurs osseuses
peuvent témoigner d’une maladie métastatique. Certains
signes fonctionnels ou complications orientent sur des
diagnostics spécifiques, de même que certains signes cli-
niques associés à des syndromes de prédisposition à la
survenue de tumeurs (tableau 1).
Le bilan radiologique de première intention doit com-
porter un cliché d’abdomen sans préparation (ASP) et une
échographie abdomino-pelvienne. L’ASP peut orienter le
diagnostic par l’aspect du refoulement des clartés gazeu-
ses digestives, d’éventuelles calcifications, des plages
graisseuses, ou une atteinte osseuse (rachidienne, pel-
vienne ou costale). L’échographie est l’examen de pre-
mière intention le plus contributif. Elle permet de :
–confirmer le diagnostic de masse ;
–affirmer son siège sous-diaphragmatique : certaines
masses médiastinales inférieures comme les neuroblastomes
se présentent parfois comme une masse « abdominale » ;
–préciser le plus souvent son origine rétropéritonéale
ou intrapéritonéale,
–mettre éventuellement en évidence l’organe d’origine ;
–préciser sa nature solide et/ou kystique et/ou calcifiée ;
–analyser sa vascularisation (en mode Doppler) ;
–mesurer ses trois dimensions ;
–apprécier ses rapports avec les organes et vaisseaux
adjacents ;
–évaluer l’extension locorégionale (vasculaire, gan-
glionnaire, péritonéale) voire métastatique (foie, surrénales).
Ces explorations cliniques et radiologiques simples
conduisent le plus souvent à un premier diagnostic topo-
graphique de la tumeur intra-abdominale :
–rétropéritonéale : rénale ou extra-rénale (surrénale,
notamment) ;
–intrapéritonéale : hépatique ou extra-hépatique
(mésentère, péritoine, ovaires) ;
–abdomino-pelvienne : à point de départ pelvien
(appareil génito-urinaire, sacrum, espace présacré).
Certaines tumeurs sont rares et ne seront décrites que
dans le tableau 2.
Après cette première orientation, des examens radio-
logiques (scanner ou IRM) et biologiques plus ciblés sont
réalisés, permettant le plus souvent de faire le diagnostic
étiologique. Dans le cas contraire, il peut être indiqué de
réaliser une cytoponction et/ou une ponction-biopsie de
la masse tumorale. L’obtention de matériel tumoral peut
également être nécessaire pour certaines tumeurs dont les
modalités de traitement, et en particulier la chimiothéra-
pie, sont conditionnées par les résultats de l’analyse bio-
logique de la tumeur. Ces prélèvements tumoraux sont
réalisés en milieu spécialisé sous contrôle échographique
ou scanner, le plus souvent sous anesthésie générale. Il est
Tableau 1. Circonstances de découverte d’une tumeur abdominale chez l’enfant
Signes cliniques Diagnostic évoqué
1. Découverte fortuite d’une masse abdominale
2. Douleurs abdominales et/ou fièvre
3. Complications révélatrices :
Hémorragie interne par rupture tumorale T rénale : néphroblastome
Hypertension artérielle T rétropéritonéale avec compression du pédicule rénal. Phéochromocytome
(rare)
Compression médullaire Neuroblastome avec extension intra-rachidienne en sablier
Retentissement sur le haut appareil urinaire T abdomino-pelviennes
4. Symptômes associés à la tumeur pouvant orienter le diagnostic
étiologique :
Altération de l’état général ± douleurs osseuses Neuroblastome métastatique ; Lymphome
Hématurie T Rénale ; T abdomino-pelvienne avec envahissement vésical
Syndrome opsomyoclonique (rare) Neuroblastome
Diarrhée acqueuse (rare) Neuroblastome avec hypersecrétion de VIP
Hypercalcémie (rare) T rhabdoïde rénale, lymphome
Signes endocriniens (rares) : virilisation, féminisation, puberté précoce Corticosurrénalome ; T des cordons sexuels
5. Syndromes prédisposants à la tumeur :
WAGR, Denys-Drash, hémihypertrophie Nephroblastome
Wiedemann-Beckwith Néphroblastome, Hépatoblastome, Rhabdomyosarcome
Neurofibromatose de type I (débattu) Neuroblastome, Phéochromocytome, Rhabdomyosarcome, neurofibromes
plexiformes
Von Hippel Lindau (type 2) Phéochromocytome, adénocarcinome rénal, angiomyolipome rénal
Li-Fraumeni Corticosurrénalome, sarcomes
mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009
Conduite à tenir devant la découverte d’une tumeur abdominale de l’enfant
30
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 2. Étiologie des masses abdominales chez l’enfant
Masses rétropéritonéales Clinique Examens complémentaires
1) Tumeurs rénales
Tumeurs rénales malignes Contact lombaire, hématurie
–Néphroblastome Âge 2-5 ans, syndrome de prédisposition Biologie moléculaire
–Adénocarcinome juvénile Âge > 10 ans
–Tumeur rhabdoïde Hypercalcémie
–Sarcome à cellules claires Métastases osseuses
–Lymphome Autres localisations
Masses solides bénignes du rein
–Néphrome mésoblastique < 6 mois
–Cystadénome multiloculaire
–Adénome métanéphrique Polyglobulie
–Angiomyolipome
–Pyélonéphrite chronique, abcès Contexte infectieux
Masses kystiques du rein
–Hydronéphrose
–Dysplasie multikystique
–Polykystose familiale Antécédents familiaux
2) Tumeurs rétropéritonéales extra-rénales
–Neuroblastome Envahissement médullaire
Extension endocanalaire en sablier
Syndrome opsomyoclonique
Catécholamines urinaires
Scintigraphie MIBG
–Ganglioneuroblastome
–Ganglioneurome
–Phéochromocytome HTA sévère Catécholamines urinaires
–Tumeur germinale maligne AFP, bêtaHCG
–Tératomes matures
–Sarcomes
–Corticoïsurrénalome Signes endocriniens Dosages endocriniens
–Adénome surrénalien
Masses intrapéritonéales Clinique Examens complémentaires
1. Tumeurs hépatiques
Tumeurs primitives malignes du foie
–Hépatoblastome Syndrome prédisposant AFP
–Hépatocarcinome Hépatopathie chronique préexistante AFP
–Carcinome fibrolamellaire
(suite)
mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009 31
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Tableau 2 (suite)
–Sarcome, rhabdomyosarcome
–Hémangiosarcome
Tumeurs bénignes du foie
–Adénome Glycogénoses (type 1 ou 3)
–Hyperplasie nodulaire focale
–Hamartome mésenchymateux
–Kyste hydatique Sérologies
–Hémangioendothéliome infantile Rétentissement cardiaque Thrombopénie
Tumeurs secondaires du foie
–Neuroblastome (Pepper)
–Hémopathies malignes
2. Autres tumeurs malignes
3. Tumeurs intra-péritonéales extra-
hépatiques
Autres localisations, signes digestifs
–Lymphome malin non hodgkinien
–Carcinoïde
–Lymphangiome kystique
–Duplication digestive
–Masses pariétales digestives (polype juvénile,
hématome)
–Tumeurs peritonéales (mésothéliome, tumeur
desmoplastique)
–Tumeurs spléniques (lymphangiome, kyste
épidermoide, lymphome)
–Tumeurs myofibroblastiques inflammatoires
4. Tumeurs abdomino-pelviennes Clinique Examens complémentaires
Tumeurs ovariennes
–Tumeurs germinales malignes ± signes endocriniens AFP, bêtaHCG
–Tumeur des cordons sexuels signes endocriniens Oestradiol, testosterone, AMH, inhibine B
–Lymphome, Leucose
–Tératome bénin Ossifications organoïdes
–Kyste fonctionnel
Tumeurs du sinus urogénital
–Rhabdomyosarcome
–Tumeur germinale maligne (vaginale) AFP, bêtaHCG
Tumeurs pelviennes
–Tumeurs germinales malignes (sacrococcygienne) AFP, bêtaHCG
–Neuroblastome pelvien Catécholamines urinaires, MIBG
(suite)
mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009
Conduite à tenir devant la découverte d’une tumeur abdominale de l’enfant
32
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

important de discuter au préalable avec les oncologues
qui vont avoir en charge l’enfant de l’opportunité de
réaliser dans le même temps un bilan d’extension (myélo-
gramme, biopsie médullaire, ponction lombaire) et/ou de
poser une voie d’abord centrale. Il est en outre fondamen-
tal de s’assurer de la représentativité des prélèvements
effectués par un examen extemporané (cellules non nécro-
sées) et de réaliser la congélation d’une partie des prélève-
ments pour une étude en biologie moléculaire. Certaines
tumeurs nécessitent en outre d’être transmises à l’état frais
au laboratoire pour mise en culture (lymphomes).
Dans tous les cas, le message qui va être délivré à
l’enfant et surtout aux parents au moment de la décou-
verte de la masse abdominale est essentiel car il va s’im-
primer pour plusieurs mois, voire plusieurs années, dans
l’esprit de la famille, quel que soit le discours qui sera
tenu par la suite par les spécialistes de la tumeur. Il est
donc impératif de mesurer ses propos, de rester très pru-
dent sur le diagnostic précis et surtout sur le pronostic tant
que le bilan complet n’a pas été réalisé. La meilleure stra-
tégie est probablement de contacter d’emblée l’équipe
médicale qui aura en charge l’enfant afin de convenir
avec elle de l’information qui peut être donnée à cette
étape du diagnostic. Les équipes habilitées à prendre en
charge les tumeurs pédiatriques sont le plus souvent orga-
nisées en réseaux locorégionaux et affiliées à la Société
Française de Lutte contre les Cancers de l’Enfant et de
l’Adolescent (SFCE)
1
.C’est au sein de cette société
savante que les stratégies thérapeutiques sont établies et
les résultats évalués et discutés au niveau européen et
international.
Masses rétropéritonéales
(environ 2/3 des cas)
L’échographie abdominale qui est réalisée devant la
découverte d’une masse abdominale permet le plus sou-
vent de déterminer si la tumeur est rétro ou intrapérito-
néale. Ceci pourra être précisé sur le scanner ou l’IRM
qui est le plus souvent réalisé pour préciser le diagnostic
et faire le bilan d’extension. Lorsque la topographie rétro-
péritonéale de la masse est affirmée, on s’attache alors à
savoir si elle est intra- ou extrarénale.
Tumeurs rénales
La tumeur rénale la plus fréquente de l’enfant est le
néphroblastome, aussi appelé tumeur de Wilms. Elle
représente 5,9 % des cancers observés chez les enfants
de moins de 15 ans. L’incidence annuelle est estimée à
7,8 nouveaux cas par an et par million d’habitants de
moins de 15 ans en France [1]. Il s’agit d’une tumeur déri-
vée de cellules précurseurs rénales embryonnaires pluri-
potentes. Elle survient classiquement entre 2 et 5 ans et est
le plus souvent découverte à l’occasion d’un examen sys-
tématique fait par le pédiatre. Elle peut également être
révélée par une hématurie ou un syndrome douloureux
abdominal qui doit faire craindre une hémorragie intratu-
morale, rétropéritonéale, voire une rupture intrapérito-
néale. Dans tous les cas, il faut rechercher une hyperten-
sion artérielle associée (d’origine vasculorénale) pour
pouvoir rapidement la traiter. L’échographie retrouve
généralement une masse rétropéritonéale volumineuse,
bien limitée, souvent hétérogène, avec des zones liqui-
diennes et tissulaires, bordée par un éperon de paren-
chyme rénal sain confirmant son siège intrarénal. Le rein
controlatéral doit être exploré à la recherche d’une
tumeur bilatérale ou de lésions de néphroblastomatose
Tableau 2 (suite)
–Rhabdomyosarcome
–Tumeurs mesenchymateuses malignes
Masses kystiques médianes (chez une fille)
–hydro ou hématométrocolpos (duplication
mullerienne, atrésie vaginale)
Période prépubaire
–Imperforation hyménéale
5. Tumeurs de la paroi abdominale
–Rhabdomyosarcome
–Tumeurs mesenchymateuses malignes
–Sarcome d’Ewing
–PNET
1
http://www.sfpediatrie.com/fr/groupes-de-specialites/sfcancerenfant.
html.
mt pédiatrie, vol. 12, n° 1, janvier-février 2009 33
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%