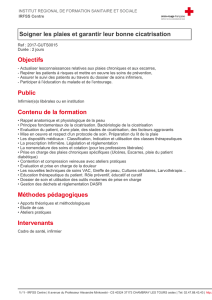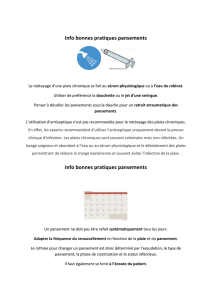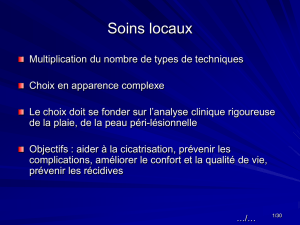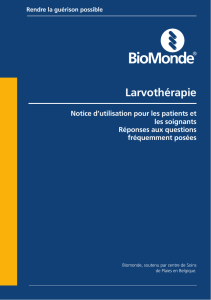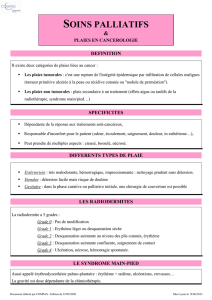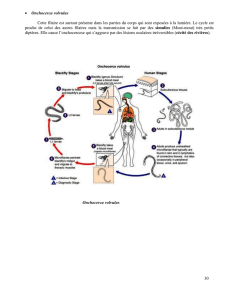pratique - CHU de Poitiers

La larvothérapie, une nouvelle
prise en charge des détersions de plaies
En orthopédie-traumatologie, à Poitiers, une équipe infirmière a mis en œuvre les moyens nécessaires
pour que les patients concernés par des difficultés de cicatrisation de plaies complexes, avec présence
de fibrine ou de nécrose, puissent bénéficier, s’ils le souhaitent, des bienfaits de la technique ancestrale
de larvothérapie. Explications.
La larvothérapie recouvre l’em-
ploi délibéré de la procréation
naturelle de la mouche Lucilia
sericata. En effet, les larves de
cette mouche se nourrissent
exclusivement de tissus morts. L’emploi
de larves pour nettoyer les plaies est utilisé
depuis des milliers d’années chez les abo-
rigènes australiens et en 1557, Ambroise
Paré observe que la présence de larves
d’insectes semblait avoir
empêché la suppuration de
plaies vieilles de plusieurs
jours. Au XXe siècle, William
Baer, professeur de chirur-
gie orthopédique aux États-
Unis, soigna deux blessés
de guerre atteints de frac-
ture ouverte du fémur en
recouvrant leurs plaies
étendues de larves1. Bien que supplan-
tée par l’apparition des antibiotiques, la
larvothérapie suscite de nouveau l’intérêt
pour sa simplicité et son efficacité, mais
également du fait de l’augmentation de la
résistance aux antibiotiques.
Principes
de la larvothérapie
La détersion, l’activité antimicrobienne et
la stimulation du tissu de granulation sont
les principaux mécanismes de
circulation apportés par la larve
de mouche Lucilia sericata.
La détersion. • En sécrétant des enzy-
mes protéolytiques, les larves liquéfient la
nécrose ou la fibrine et éliminent le tissu
nécrosé en l’ingérant. La détersion méca-
nique a lieu par grouillement sur le lit de la
plaie et dilacération mandibulaire.
L’effet anti-microbien. • Les larves
sécrètent des substances anti-bactérien-
nes (ammoniaque, carbonate de calcium)
qui alcalinisent la plaie. Il devient donc
difficile, voire impossible,
pour les bactéries de colo-
niser les tissus.
Stimulation du tissu •
de granulation. Les sécré-
tions produites par les
larves stimulent la crois-
sance des fibroblastes chez
l’homme. La prolifération
cellulaire est accélérée lors
de l’utilisation de larves.
Projet de service
C’est dans le cadre d’un congrès “plaies et
cicatrisations” que les infirmières du service
orthopédie traumatologie du CHU de Poi-
tiers (86) ont découvert la larvothérapie. La
similitude des plaies présentées avec celles
rencontrées dans leur service les ont ame-
nées à penser que la larvothérapie pouvait
être nécessaire à la guérison de certaines
plaies. En effet, des retards ou
difficultés de cicatrisation de
plaies complexes, dus à la pré-
sence de fibrine et/ou de nécrose mais éga-
lement à la douleur engendrée par les
détersions mécaniques, mettaient à mal
l’équipe soignante. Avec l’accord du chef
de service, le soutien de l’équipe chirurgi-
cale et du cadre de santé, le projet de larvo-
thérapie a pu voir le jour. Jusqu’alors, cinq
patients ont pu en bénéficier.
Vaincre les réticences
Les larves ou asticots sont généralement
associés à la pourriture et à la mort. Il est
donc nécessaire de communiquer auprès
de l’ensemble de l’équipe afin de vaincre
les réticences. Sous forme de réunions
d’information organisées dans le service,
les connaissances ont été partagées avec
l’ensemble du personnel. Tenir un discours
clair et uniforme est important pour une
meilleure prise en charge du patient.
Notes
1 Source : www.
larvothérapie.com.
Le sachet de larves est apposé directement sur la plaie, nettoyée
et débarrassée de toute trace de produits précédemment employés.
© Zoobiotic Ltd Bridgent
pratique
38
pratique
démarche qualité
La revue de l’infirmière • Octobre 2009 • n° 154
Lorsque le patient
accepte
un pansement
de larves,
il devient acteur
de son traitement

Mise en place
d’un classeur référentiel
Un document de référence a été rédigé en
interne pour le service de soins bénéfi-
ciaire de la nouvelle technique ainsi que
pour la pharmacie où une personne était
chargée du suivi du projet. Des éléments
utiles pour la commande, l’application et
la surveillance ont été réunis dans un clas-
seur référentiel qui a évolué avec la mise
en place de la technique dans le service
(tableau). La réévaluation du système a
engendré la création d’unités de mesure
de la plaie (réglettes), la création de gaba-
rits pour les sachets de larves ainsi que
l’ajout d’une feuille comprenant un code
couleur pour évaluer celle de la plaie. Un
classeur nominatif pour chaque patient
bénéficiant de ce pansement a été créé.
Diminuer le temps
de détersion
en complément
d’un pansement
à pression négative
Voici une étude de cas dans un contexte d’utilisation
d’un sachet de larves chez un patient souffrant d’une
plaie post-traumatique fibrineuse.
M. X a été admis dans le service orthopédie-
traumatologie suite à une morsure de chien au niveau
du pied droit. Cette morsure a entraîné une fracture
du quatrième métatarsien, des plaies multiples sur
les faces interne et externe et sur la plante du pied,
ainsi qu’une perte de substance au niveau de la face
externe du pied.
Les soins post-opératoires immédiats concernant la
perte de substance cutanée ont été réalisés avec de
l’alginate puis par pansement à pression négative et de
nouveau de l’alginate. Devant l’absence d’amélioration
et à l’apparition de fibrine et de nécrose, il a été décidé
à J17 de tenter l’utilisation de larves.
Le traitement a nécessité deux poses et a entraîné
une diminution progressive de la fibrine et de la
nécrose jusqu’à disparition totale. La plaie devenue
bourgeonnante a été retrouvée réduite en largeur et
en profondeur. À J26, le patient a pu bénéficier d’une
greffe.
M. X témoigne :
« Quand le chirurgien et l’infirmière m’ont proposé ce
traitement avec des larves, j’ai été surpris et intrigué
par cette technique. Après des explications claires et
un délai de réflexion, j’ai accepté cette aventure. J’ai
été très attentif à ces “demoiselles chirurgiens” et à
chaque surveillance, je suivais l’évolution de la plaie.
Au bout de deux jours, j’ai vu diminuer la fibrine. Je
n’ai ressenti aucune douleur ni aucune gêne. Ma
seule préoccupation était de faire attention à ne pas
les écraser ! Au bout de sept jours, ma plaie était bien
rouge, débarrassée de la fibrine. J’ai pu bénéficier
d’une greffe et sortir dans les jours suivants. »
c a s c o n c r e t
J17 : Plaie avant la larvothérapie.
© Service communication CHU de Poitiers
J17 : Plaie avant la larvothérapie.
© Service communication CHU de Poitiers
J26 : La larvothérapie a réduit les plaies en largeur et en profondeur. Le patient peut bénéficier d’une greffe.
© Service communication CHU de Poitiers
pratique
39
pratique
démarche qualité
La revue de l’infirmière • Octobre 2009 • n° 154

Protocole d’utilisation
Préparation de la plaie
Il convient de nettoyer la plaie à l’eau et au
savon 24 à 48 h avant la pose de larves. Il
est important de ne laisser aucune trace ni
résidu des produits précédemment
employés. Lors de la pause du sachet de
larves, le pourtour de la plaie est protégé
avec une pâte à l’eau (car l’exsudat pro-
duit par les larves peut être “corrosif” pour
la peau saine).
Surveillance
Dans le service, a été mise
en place une surveillance
par équipe trois fois par
24 h, afin d’apprécier la
vivacité des larves, la quan-
tité d’exsudat et la qualité
de la peau périlésionnelle.
Évaluation
L’évalutation porte sur :
– la superficie de la plaie ;
– l’amélioration de l’état de la plaie, grâce
à une grille colorielle ;
– l’appréciation de la douleur au moyen
d’une échelle numérique ;
– et la reconduction éventuelle du traite-
ment par le chirurgien.
Limites
Les troubles de la coagulation peuvent
représenter un frein à l’utilisation de la
technique de la larvothérapie, ainsi que la
localisation de la plaie à proximité d’un ori-
fice ou d’un gros vaisseau.
Implication du patient
dans son projet thérapeutique
Lorsque nous proposons un pansement
de larves à un patient, nous lui fournissons
évidemment les informa-
tions nécessaires, nous
répondons à ses ques-
tions et nous lui laissons
un temps de réflexion
adapté à sa convenance.
Ce temps est nécessaire
car son accord l’implique
et le responsabilise dans
le choix du pansement. Il s’engage alors
dans cette thérapeutique en signant un
document de consentement.
De ce fait, mais également parce qu’il
doit être attentif aux larves qui sont des
êtres vivants, son implication dans l’évo-
lution de la plaie s’en trouve renforcée.
Entre le soignant et le patient se crée une
relation de partage beaucoup plus mar-
quée et le patient est acteur de sa prise
en charge.
Conclusion
Cette technique qui semble prometteuse
en orthopédie-traumatologie n’a malheu-
reusement pas encore fait l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché ni d’un
remboursement par la Sécurité sociale.
•
Myriam Hardy-Rocher
infirmière, titulaire du DU plaies et cicatrisations, et l’équipe infirmière
du service d’orthopédie-traumatologie, CHU de Poitiers (86)
Une expérience réalisée
grâce à la persévérance
des infirmières
« L’expérience du service de chirurgie
orthopédique et traumatologique du CHU de
Poitiers dans l’utilisation de la larvothérapie
a été très convaincante depuis sa mise en
place. La cible de cette thérapeutique était
axée sur les plaies atones et fibrineuses ne
répondant pas rapidement aux traitements
habituels utilisés selon les protocoles
du service. L’expérience a été tout à fait
concluante en améliorant rapidement la
phase de détersion et en raccourcissant
la prise en charge de ces patients. Elle a
été possible grâce au dynamisme et à la
persévérance de l’équipe infirmière du
service. Cette nouvelle technique prendra
rapidement sa place dans notre arsenal
des protocoles thérapeutiques de prise en
charge des plaies et cicatrisations. »
Hamid Hamcha,
praticien hospitalier, CHU de Poitiers
t é m o i g n a g e
Procédure avant la larvothérapie Protocole d’utilisation des larves
Autorisation temporaire d’utilisation délivrée
par l’Afssaps (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé)
Préparation de la plaie
(nettoyage, protection du pourtour)
Information et autorisation écrite du patient
(création d’un formulaire) Pose du sachet de larves
Information à la famille Surveillance (mesure des plaies, évolution
de la nécrose, présence de fibrine…)
Prescription médicale Évaluation
Évaluation par le service et le laboratoire
fournissant les pansements
Tableau
La détersion
mécanique se fait
par grouillement
sur le lit de la plaie
et dilacération
mandibulaire
pratique
40
pratique
démarche qualité
La revue de l’infirmière • Octobre 2009 • n° 154
1
/
3
100%