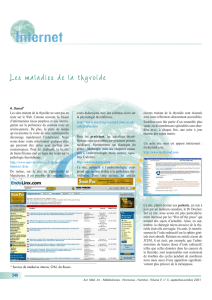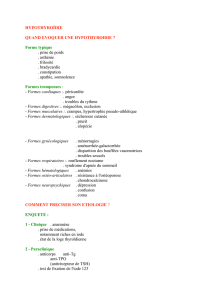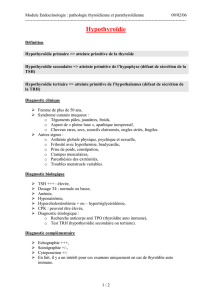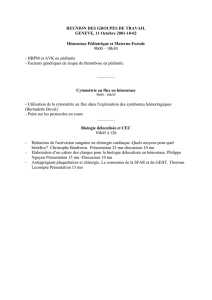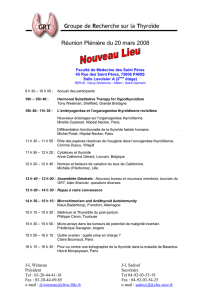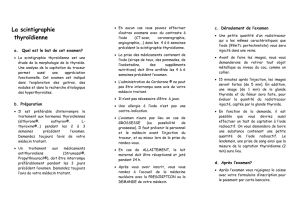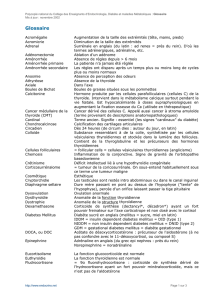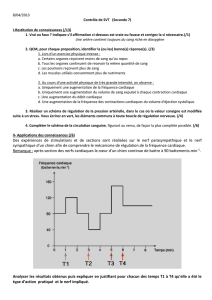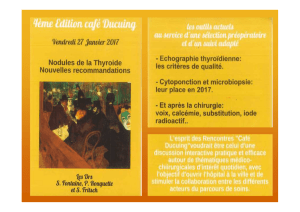Chirurgie thyroïdienne à l`heure de l`accréditation

FCC 3 - Chirurgie thyroïdienne a l'heure de l'accréditation
SOMMAIRE
Président :
M.MATHONNET (Limoges)
Modérateurs
J.-P. BIZARD (Arras)
J.-C. LIFANTE (Lyon)
E. D'HUBERT (Evry)
Base REX en chirurgie endocrinienne
J.-F. GRAVIE (Toulouse)
Risque récurrentiel lié aux énergies (mono, bipolaire, thermofusion,
ultrascission)
E. D'HUBERT (Evry)
Risque récurrentiel lié au patient (anatomie, BMI, sexe, réintervention)
E. MIRAILLIE (Nantes)
Risque récurrentiel lié au chirurgien et gestion du risque (annonce, monitoring,
détection systématique)
M. MATHONNET (Limoges)
Synthèse et questions
J.-P. BIZARD (Arras)

FCC 3 - Chirurgie thyroïdienne a l'heure de l'accréditation
BASE REX EN CHIRURGIE ENDOCRINIENNE
J.-F. GRAVIE
Clinique saint jean Languedoc
20 route de Revel
31077 Toulouse
La base REX (Retour d’expérience) est le support d’analyse et d’enregistrement des évènements indésirables
déclarés par les médecins engagés dans une démarche individuelle de gestion des risques dans le cadre de
l’accréditation des médecins. Les évènements déclarés sont dits évènements porteurs de risques (EPR) car il
s’agit exclusivement d’évènements indésirables qui n’ont pas causé de dommages graves au patient.
La base REX est au centre du dispositif d’accréditation des médecins qui a pour objectif de prévenir et réduire
les risques liés aux pratiques et actes médicaux, de diminuer la sinistralité et donc d’améliorer la qualité et la
sécurité des soins. Le premier objectif est de pouvoir analyser les processus qui ont conduit à l’événement
indésirable puis mettre en œuvre des actions d’amélioration avant d’évaluer leur impact sur la sécurité.
Le dispositif d’accréditation est opérationnel depuis 2008, regroupant 20 spécialités à risques. Actuellement
près de 37000 EPR ont été analysés et enregistrés dans la base toutes spécialités confondues. Au 9 septembre
dernier les déclarations des chirurgiens engagés auprès de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive
étaient de 7048, concernant divers champs d’activité (chirurgie d’urgence, chirurgie générale de l’adulte,
chirurgie de l’obésité etc…). Le champ de la chirurgie endocrinienne correspondait à 167 (2,3%) déclarations.
Les déclarations concernant la chirurgie thyroïdienne n’ont pas été faites exclusivement auprès de la FCVD 121
(1,7%), mais également d’autres organismes agréés de spécialité : ORL 11/149 (7,3%), Chirurgie thoracique et
cardiovasculaire 15/1202 (1,2%), Anesthésie réanimation 36/1891 (1,9%).
Le relevé de ces déclarations permet d’identifier plusieurs situations à risques qui ne sont pas uniquement
ciblées sur le risque récurrentiel. Il peut s’agir de situations spécifiques à une spécialité (difficultés
d’intubation), ou plus générales d’ordre systémique liées à la prise en charge du patient (erreur de côté, dossier
médical incomplet, problème d’installation, défaut de surveillance ou de prescription, indisponibilité d’examen
anapath extemporané, dysfonctionnement de matériel etc…).
L’analyse de la base REX et de ses situations à risques ne doit pas être considérée comme une analyse
épidémiologique. Elle ne doit pas tirer de conclusions sur l’incidence de la sinistralité, elle est strictement
limitée à l’identification de situations à risque et à l’analyse des processus qui ont conduit à l’événement
indésirable.

FCC 3 - Chirurgie thyroïdienne a l'heure de l'accréditation
Le rôle de l’organisme agréé est de tirer des enseignements de cette base de retour d’expérience et de
développer des outils spécifiques de gestion des risques comme par exemple un questionnaire d’analyse
approfondie spécifique à une situation à risque ciblée. La spécialité doit pouvoir élaborer des recommandations
à partir de ces analyses. Un des premiers travaux de la FCVD en collaboration avec l’AFCE a été de mettre à
disposition des chirurgiens un compte rendu type de thyroïdectomie actuellement accessible sur le site
www.chirurgie-viscerale.org

FCC 3 - Chirurgie thyroïdienne a l'heure de l'accréditation
RISQUE RECURRENTIEL LIE AUX ENERGIES (MONO, BIPOLAIRE,
THERMOFUSION, ULTRACISION)
E. D'HUBERT
Hôpital louise Michel quartier du canal
91014 Evry Cedex
Tél: 01 60 87 52 17
Email: etienne.dhubert@ch-sud-francilien.fr
Résumé
La lésion du nerf récurrent est une des complications les plus redoutées de la chirurgie thyroïdienne. Les
études récentes portant sur les récurrents à risque lors de la chirurgie thyroïdienne montrent un
dysfonctionnement cordal post opératoire de 10%, un taux de 7% pour PR transitoire et de 2,5% pour les PR
définitives.
Avec le développement de la cœliochirurgie, l’utilisation de nouvelles énergies s’est développée comme
moyen d’hémostase et a progressivement remplacé l’hémostase classique (ligatures et clips) en chirurgie
thyroïdienne.
Deux questions sont posées :
1) L’utilisation des énergies est-elle un facteur de risque récurrentiel?
2) Y a t-il des énergies moins ou plus dangereuses que d’autres ?
Les énergies utilisées comme moyen d’hémostase produisent une quantité de chaleur plus ou moins
importante qui peut, par contact direct ou par diffusion thermique, atteindre le nerf récurrent et le léser. La
température produite par les générateurs varie de 50°C à 400°C et entraine dans les tissus vivants une
altération de la structure et de la fonction des protéines.
Les énergies utilisées pour l’hémostase et éventuellement la section des tissus en chirurgie thyroïdienne sont
de deux types :
- L’énergie électrique (Electrochirurgie) avec deux modes, unipolaire et bipolaire, la plus récente et la
plus utilisée étant la thermofusion.
- L’énergie par ultrasons (Ultracision)
L’électrochirurgie :
Le bistouri électrique utilise le courant électrique alternatif, de Haute Fréquence, dont le seul effet est la
production de chaleur :
- Des températures de 60°C à 70°C (faible chaleur produite lentement) au niveau de l’électrode active
permettent l’hémostase
- Des températures supérieures à 100° (forte chaleur produite rapidement) ont un effet de coupe
mécanique.

FCC 3 - Chirurgie thyroïdienne a l'heure de l'accréditation
La quantité de chaleur produite obéit à la loi de Joule : Q = I
2
x R x t (I = intensité du courant, R= résistance des
tissus, T= durée), mais aussi aux électrodes utilisées et aux capacités de modulation du générateur et plus
récemment de ses capacités d’autorégulation.
La diffusion thermique des tissus est faible. La température atteinte après un temps donné de passage du
courant décroit très rapidement lorsqu’on s’éloigne du point d’application. La variation de température par
unité de temps, dT/dt, est proportionnelle à 1/r
4
(T= température, t = temps, r = distance).
1) Mode monopolaire
En mode monopolaire, l’électrode active (celle qui délivre le courant électrique au tissu) est dans le site
chirurgical, l’électrode passive (de retour ou plaque) est sur le corps du patient. Le courant passe à travers le
patient en allant de l’électrode active à l’électrode passive.
2) Mode bipolaire
En mode bipolaire, on opère à l’aide d’une pince, le courant passe d’un mors à l’autre de la pince et permet de
coaguler entre les deux mors. Les deux extrémités de la pince jouent le rôle d’électrode active et de retour.
Seul le tissu saisi est dans le circuit électrique. La coagulation d’un vaisseau reste localisée alors qu’en mode
monopolaire elle pourra suivre le vaisseau sur une grande longueur. Pour cette raison, la coagulation
monopolaire ne peut pas être utilisée à proximité du nerf récurrent. Les générateurs de dernière génération
permettent une coagulation bipolaire douce avec un système d’autorégulation de la puissance de sortie du
générateur au fur et à mesure de la transformation des tissus (en fonction de l’impédance de retour).
3) Thermofusion
C’est une électrocoagulation utilisant des courants bipolaires de très forte puissance et faible voltage. Elle
associe pression et énergie électrique. La force appliquée aux tissus par les mors de la pince comprime les
parois du vaisseau l'une contre l'autre et l'élévation thermique engendrée entraîne une dénaturation du
collagène et de l'élastine de la paroi vasculaire ce qui provoque une soudure de ces parois. Le générateur
mesure l'impédance et la résistance au contact de l'électrode et arrête automatiquement de délivrer l'énergie
une fois la fusion atteinte. Ce procédé permet la coagulation de vaisseaux allant jusqu'à 7 mm de diamètre. La
production de chaleur permettant l’hémostase est moindre et surtout contrôlée.
L’ultracision :
Ce n’est plus le courant électrique du générateur qui agit directement pour coaguler. On utilise l'énergie
ultrasonore pour réaliser la coagulation et la section des vaisseaux. Un transducteur convertit le signal
électrique en ondes ultrasoniques. L’énergie est produite à partir des vibrations ultrasonores. Elle permet
l’hémostase des artères jusqu’à 5 mm de diamètre avec une double action de coagulation et de section. Les
températures atteintes seraient moindres, de l'ordre de 50°C à 100°C, sans les risques de l’utilisation d’un
courant électrique.
Au cours de la dernière décennie, les publications ne montrent qu’une seule étude pour l’hémostase bipolaire
standard alors qu’elles se comptent par dizaines pour la thermofusion et les ultrasons.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%