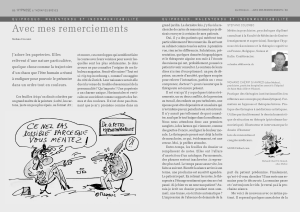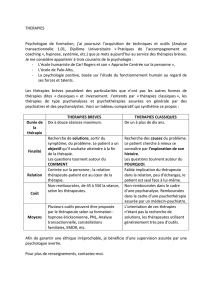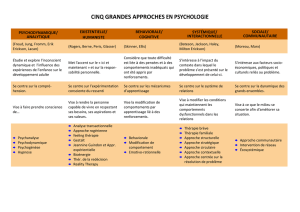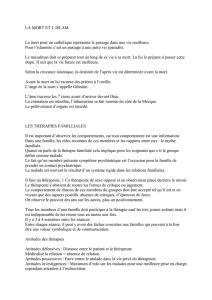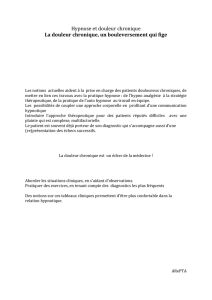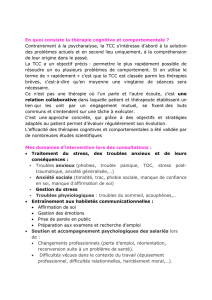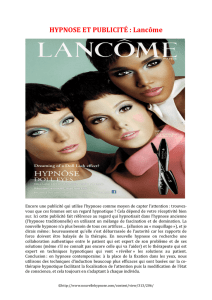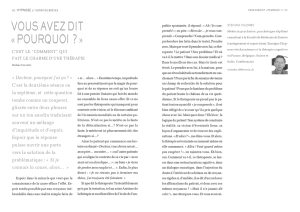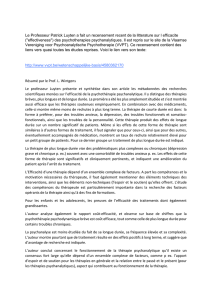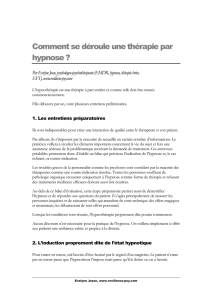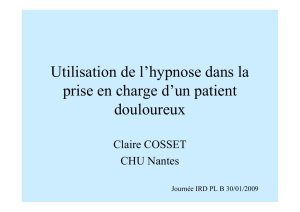Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté

L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 711–9
CLINIQUE
Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté
Philippe Aïm 1, Jean-Pierre Kahn 2
RÉSUMÉ
Se situer « entre norme et liberté » est un enjeu de psychothérapeute. Entre technique et créativité, stratégie et intuition,
rigueur de l’outil et chaleur de la relation, l’hypnose et ses « filles », les thérapies brèves, abordent ce débat. Erickson
a fait de l’hypnose une psychothérapie, s’éloignant de la vision normative qu’en avaient les chercheurs. L’école de Palo
Alto dissèque les subtilités de la communication systémique, tout en garantissant une thérapie sans cesse renouvelée et
anosographique. Les solutionnistes utilisent la position relationnelle pour faire émerger des ressources uniques à chacun.
Le diagnostic « opératoire » des thérapies stratégiques bouscule le diagnostic descriptif pour l’intégrer au fonctionnement
du patient. Enfin, nous verrons que ce qui fait l’efficacité de toute thérapie ne peut être normalisé... et ne s’apprend pas !
Mots clés : hypnose, psychothérapie brève, alliance thérapeutique, théorie systémique, efficacité, Erickson MH, Palo Alto,
psychothérapie centrée sur la solution, thérapie stratégique
ABSTRACT
Hypnosis and brief therapy, standards and freedom. The position between “standards and freedom” remains a challenge
for the psychotherapist. It is also the position between technology and creativity, strategy and intuition, tool precision and
the warmth of a relationship, hypnosis and its “offspring” of brief therapies which is included in this debate. Erickson has
made hypnosis a psychotherapy, moving away from the normative vision of original researchers. The Palo Alto School
dissects the subtleties of systems of communication, while at the same time guaranteeing a therapy which is constantly
renewed and at the same time non-nosographic. Solutionists use the relational position to extract resources that are unique
to each individual. The “operational” diagnosis strategic therapies disrupts the descriptive diagnosis approach in order to
integrate the functioning of the patient. Finally, we will see that which makes any therapy effective cannot be standardized...
and it is something that cannot be learned!
Key words: hypnosis, brief psychotherapy, therapeutic alliance, systems theory, efficacy, Erickson MH, Palo Alto, solution
centred psychotherapy, strategic therapy
1Praticien hospitalier, ancien assistant - chef de clinique, CHU de Nancy, service de psychiatrie et psychologie clinique, hôpitaux de Brabois,
Bâtiment Philippe Canton, rue du Morvan, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France
<p.aim@chu-nancy.fr>
2PU-PH, CHU de Nancy, service de psychiatrie et psychologie clinique, hôpitaux de Brabois, Bâtiment Philippe Canton, rue du Morvan, 54500
Vandœuvre-lès-Nancy, France
doi:10.1684/ipe.2012.0977
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 711
Pour citer cet article : Aïm P, Kahn JP. Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté. L’Information psychiatrique 2012; 88 : 711-9 doi:10.1684/ipe.2012.0977
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

P. Aïm, J.-P. Kahn
RESUMEN
Hipnosis y terapias breves, normas et libertad. Situarse “entre norma y libertad” es algo de lo que se juega el psicotera-
peuta. Entre técnica y creatividad, estrategia e intuición, rigor de la herramienta y calidez de la relación, la hipnosis y sus
“hijas” las terapias breves abordan este debate. Erickson convirtió en psicoterapia la hipnosis, alejándose de la visión nor-
mativa que tenían de ella los investigadores. La escuela de Palo Alto escudri˜
na las sutilezas de la comunicación sistémica,
a la vez que garantiza una terapia continuamente renovada y anosográfica. Los solucionistas utilizan la posición relacional
para que emerjan los recursos únicos que tiene cada uno. El diagnóstico “operatorio” de las terapias estratégicas maltrata
el diagnóstico descriptivo para integrarlo en el funcionamiento del paciente. Por fin veremos que lo que hace la terapia
eficaz no puede ser normalizado... y no se ense˜
na !
Palabras claves : hipnosis, psicoterapia breve, alianza terapeútica, teoría sistémica, eficacia, Erickson MH, Palo Alto,
psicoterapia centrada en la solución, terapia estratégica
Entre normes et liberté
Si cette petite phrase pouvait constituer à elle seule
l’argument d’une rencontre autour de la psychiatrie
publique, c’est aussi un enjeu de la position d’un thérapeute,
lui aussi « tiraillé » entre normes et liberté.
Les normes sont celles imposées, d’une part, par le
diagnostic descriptif, le savoir théorique qui l’oblige a clas-
sifier et à ranger son patient dans une catégorie qui devrait
de fac¸on logique entraîner un type de traitement, d’autre
part, la contrainte de l’outil thérapeutique qui emboîte le
pas au diagnostic et se codifie. Au niveau pharmacolo-
gique, les caractéristiques des médicaments ont souvent
les mêmes dimensions que les diagnostics. Mais le déve-
loppement, la modernisation des thérapies, a consisté pour
une part à affiner les techniques et à les appliquer à un
diagnostic donné. La thérapie, comme les autres traite-
ments pourrait ou devrait donc obéir à cette règle : une
maladie possède un traitement recommandé qui fait ses
preuves sur ses symptômes. Un thérapeute en formation
apprend des recettes, des outils, des fac¸ons de communi-
quer ou de concevoir la psyché qui correspondent à ce qu’il
est convenu d’appeler son « courant de pensée ». Il est
alors tenté d’appliquer la technique à la lettre, d’utiliser
une stratégie « normée ».
Face à cela, la liberté : constater, peut-être avec éton-
nement, que, pour un même diagnostic, chaque patient a
une manière on ne peut plus individuelle d’exprimer ses
symptômes. Peut-être faut-il diagnostiquer avant de trai-
ter, mais faut-il appliquer dans tout « cas » de la même
« catégorie » le même traitement de fac¸on uniforme ? Le
symptôme s’inscrit pourtant dans leur histoire, dans leur
fonctionnement quotidien, dans leur famille, dans leur vie,
dans leurs valeurs. Les patients n’étant jamais les mêmes,
le thérapeute ressent un besoin d’adaptation à la situa-
tion ; il est alors tenté d’agir avec liberté aussi : faire
preuve d’intuition, de créativité, améliorer la relation avant
tout.
Ces questions sont valables quel que soit le type de thé-
rapie ou plus largement de relation thérapeutique. Peut-on
parfois ou souvent rendre grâce à l’intuition dans la réus-
site d’une thérapie ? Sentons-nous parfois ou souvent que
nous devons beaucoup à la qualité de la relation plus qu’à
la technique elle-même ?
Si le débat est incessant pour tout thérapeute, il est sou-
vent bien mal formulé dans la littérature. Soit on cherche
à normaliser la thérapie, à formuler des outils « prêt-à-
l’emploi », à démontrer son efficacité, à en faire une part
de l’evidence-based medicine. On court alors le risque de
passer pour scientifique inhumain qui réduit l’esprit à une
pure machine que l’on pourrait dompter. Soit on parle
d’individualité, du caractère unique de la relation interper-
sonnelle, du fait qu’on ne peut pas mettre l’humanité en
pièces détachées manipulables et évaluables. On court le
risque de passer pour un charlatan qui cherche à imposer
une théorie douteuse qui ne repose que sur son opinion,
avec des arguments tautologiques.
Ces assertions un peu extrêmes sont bien sûr des cari-
catures, mais que l’on retrouve hélas dans les discours qui
alimentent les « querelles de clochers » entre les courants
de psychothérapies.
Méthode et intuition, technique et relation, norme et
liberté. Chaque thérapie a cherché à sa fac¸on à inscrire la
théorie dans la pratique et à évoluer malgré et avec ce débat.
Ne serons pas évoquées la thérapie d’inspiration analytique
ni la TCC (thérapie cognitive et comportementale), mais
seulement quelques aspects de ce questionnement au prisme
de l’hypnose ericksonienne et des thérapies « brèves »
(HTB) qui s’en inspirent (solutionnistes, systémiques,
stratégiques).
L’hypnose éricksonienne
et l’utilisation
L’hypnose est vieille comme le monde mais sa définition
n’a jamais été facile ni consensuelle. L’hypnose désigne à
la fois un état de conscience, une forme de relation par-
ticulière, mais aussi la technique pour y parvenir, et les
formes de thérapies qui en découlent. Elle n’a pas pour but
de remonter à la source des problèmes ou de disséquer un
symptôme, mais plutôt d’aider le patient à avoir accès et
712 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté
activer des ressources qui entraînent un changement. C’est
un processus connu depuis longtemps sous de multiples
formes et modernisé par Erickson qui en a fait une forme
de psychothérapie [28].
Malgré son efficacité empirique et les passions qu’elle
suscite au début du xxesiècle (se rappeler des controverses
entre Charcot et Bernheim), l’hypnose tombe en désuétude
devant le succès hégémonique de la psychanalyse de Freud
et ses suiveurs [20]. Aux États-Unis, tous les psychiatres
sont analystes et vice versa. L’hypnose est devenue un sujet
d’étude expérimental dans les laboratoires de psychologie.
Elle intéresse le jeune Erickson, étudiant en médecine dans
les années 1920. Il se forme en compagnie des chercheurs
de Stanford qui étudient les états de conscience et la disso-
ciation et qui cherchent à établir une méthode d’induction
hypnotique universelle. Très vite, il s’en éloigne. Il sent
que l’hypnose pourrait être avant tout une technique théra-
peutique, que l’on doit adapter aux patients. Ses premières
observations l’ont amené à penser que l’hypnose a un
potentiel thérapeutique énorme, si l’on s’y prenait un peu
autrement. Ainsi commenc¸a le questionnement sur sa pra-
tique et le renouvellement de l’hypnose, abandonnant les
procédures autoritaires des magnétiseurs et hypnotiseurs et
les procédures uniformes auxquelles rêvaient les chercheurs
[4].
Il pressent bien qu’il faut respecter l’individualité de
chacun. Il rend l’hypnose plus permissive, plus ouverte, il
étend les techniques pour contourner les résistances : méta-
phores thérapeutiques, suggestions indirectes. Erickson est
à la fois un technicien hors pair de l’hypnose et, à la fois,
un artisan de la relation. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître à ceux qui ont tenté de limiter l’hypnose à une série
de recettes, Erickson définit l’hypnose comme un type de
relation.
Erickson utilise le langage analogique, c’est-à-dire para-
verbal et non verbal, il communique à plusieurs niveaux
pour établir une relation non univoque. Pour lui, le patient
possède les ressources nécessaires aux changements, la
causalité n’est pas linéaire ou déductive mais circulaire.
L’inconscient ericksonien, loin d’être une poubelle à repré-
sentations pulsionnelles refoulées, est une boîte à trésors,
remplie de solutions, de nouvelles fac¸ons (ou anciennes
mais oubliées) de voir et d’agir. La technique sert ici à per-
mettre la créativité, celle du thérapeute bien sûr, mais pour
faire naître celle du patient [26]. Les capacités associatives
du thérapeute ne seront pas employées dans un but explicatif
mais solutionniste.
Certaines situations cliniques sont étonnantes non tant
par le succès thérapeutique mais par le surgissement à un
moment précis d’une intervention « à propos » qui déter-
mine le changement. Les consultations d’Erickson sont
remplies de tels exemples [11, 24], les nôtres aussi parfois.
Mais s’agit-il d’improviser ? De « faire n’importe
quoi » ? Sûrement pas, car cela nécessite un long appren-
tissage, beaucoup d’observation et une certaine flexibilité
pour saisir un élément et laisser glisser l’attention vers une
direction plus opportune, aborder la situation du patient de
fac¸on inédite. Le changement suscité est une boule de neige,
quand un effet se produit il va s’étendre à d’autres domaines.
Erickson enseignait l’intégration de technique et intui-
tion sous la forme du « principe d’utilisation » [4].
L’observation attentive et continue permet de saisir le détail
qui serait la clé du changement et d’en faire un usage théra-
peutique. Mais elle nécessite du thérapeute qu’il soit attentif
en attendant sans rien attendre de spécial [27], qu’il accepte
de se laisser surprendre pour justement « utiliser » dans la
transe hypnotique ce que le client lui amène « comme sur
un plateau », et en « parlant le langage du patient ».
L’intuition, connaissance immédiate et « évidente »
n’est-elle qu’une utilisation synthétique de souvenirs
inconscients ? Comme le souligne P. Bellet, que nous citons
largement ici à ce sujet, c’est une tautologie indémontrable
et plausible, qui ne permet pas pour autant de l’utiliser [4] !
Malgré la faculté de lier des informations, comment expli-
quer les idées nouvelles ? La créativité peut-elle se réduire
à la multiplication des connexions entre les souvenirs ?
De nos jours, les modes d’explication et de connais-
sance valorisent la clarté, la procédure, la preuve, comme
si des jalons préalables étaient l’assurance de conduire à
une bonne fin le processus thérapeutique... L’absence de
cadre inquiète, pas de repères évidents. L’hypnose utilise
la technique comme un procédé élémentaire de base et non
comme un protocole fermé et standardisé.
Alors l’intuition pourquoi pas ? Beaucoup de décou-
vertes scientifiques et non des moindres semblent surgir
du néant, d’une intuition parfois dans un moment de
relâchement : Archimède, Kékulé, Newton, Flemming et
d’autres. L’intuition est une fonction physiologique, pas
une manifestation extraordinaire. Cette fonction associative
est étouffée non seulement par le système de l’enseignement
officiel, mais aussi par les préjugés, les craintes, les
dogmes... et notamment tous ceux qui entourent le mot
hypnose [4] qui désigne à la fois un état, le moyen d’y
parvenir, et ce à quoi il peut servir...
L’intuition, selon Bergson, « est une sympathie
par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet
pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par consé-
quent d’inexprimable. » Indispensable en thérapie autant
qu’impossible à codifier.
Mais comment apprendre et appliquer quelque chose
qui ne serait pas codifié ? Avoir confiance en soi, en sa
propre liberté plutôt qu’en ses pures connaissances ? Car
faire confiance à la technique peut rassurer. Mais toujours
vouloir se rassurer peut susciter de plus en plus d’angoisse
à la sensation qu’on ne maîtrise pas tout... Trop d’attentes,
trop d’exigence d’efficacité, trop de « vouloir qu’il aille
mieux » peuvent troubler le thérapeute et le patient. On
peut aussi empêcher le changement si on ne croît pas aux
possibilités d’amélioration du patient. Le but est souvent
atteint quand on arrête de trop le poursuivre [18]. Alors
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 713
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

P. Aïm, J.-P. Kahn
pour laisser passer ce désir de trop en faire, il faut se rap-
peler que les ressources du patient, son désir de changer,
ne dépendent pas du thérapeute. Il faut ne pas trop vouloir,
il faut laisser faire, laisser venir pour permettre que c¸a se
passe [27]. C’est là le positionnement thérapeutique que
permet la technique et la relation hypnotique. L’intuition
embellit la technique, l’assouplit, l’adapte. Il faut en fait
apprendre les techniques, c’est un passage obligé, ce sont
elles qui permettent de repenser le patient. Puis ensuite les
oublier pour qu’elles s’intègrent à notre fonctionnement de
fac¸on appropriée, utile et automatique, pour qu’elles soient
nouvelles, personnelles et relationnelles [18].
Erickson disait qu’il faisait de l’hypnose un tiers du
temps, qu’il donnait de l’information au patient un tiers
du temps et que le dernier tiers du temps il ne savait pas
exactement ce qu’il faisait.
Palo Alto et la communication
L’histoire de Palo Alto est complexe et riche comme
les concepts développés dans le courant de pensée sys-
témique [21]. Rappelons juste tout d’abord que les liens
avec l’hypnose éricksonienne sont très forts. Dès le début,
Bateson s’intéressant aux feedbacks et aux paradoxes va
rapidement rencontrer Erickson. L’école de Palo Alto
cherche à comprendre ce que font les thérapeutes effi-
caces. Pour Watzlawick, Erickson fait partie de ceux qui
guérissent avec les mots [37]. Deux élèves de Bateson,
Haley et Weakland, demandent à aller le rencontrer et à le
voir travailler. Erickson les recevra tous les lundis pendant
plusieurs années.
Ils arrivent à l’idée qu’Erickson réussit parce qu’il entre-
tient de bonnes relations avec les patients. Et s’il a de
bonnes relations c’est parce qu’il a de bons outils de
communication. Ils extraient en quelque sorte les outils
de communication utilisés et parlent d’« hypnotherapy
without trance », de l’hypnose sans transe, c’est-à-dire de
la communication efficace et thérapeutique sans hypnose
formelle. Ils utiliseront donc les métaphores, les situations
de doubles liens, les paradoxes, etc. [38]. Rappelons qu’ils
insistent aussi beaucoup sur la notion de « système », le
patient n’est pas son symptôme, le symptôme n’ayant pas de
signification en dehors du système relationnel dans lequel
il s’inscrit. Changer les relations dans le fonctionnement du
système fait forcément bouger le symptôme. Ils dénoncent
l’illusion dans laquelle sont les thérapies basées sur une
anthropologie de l’homme seul.
Beaucoup de notions très complexes sont intégrées dans
un modèle thérapeutique. Pourtant, chaque thérapie doit
être individuelle, il n’y a plus de nosographie, chaque situa-
tion est nouvelle [40]. Ils intègrent tout cela dans leur
fameuse grille dont voici un résumé simplifié (tableau 1).
Ce cadre est suffisamment bien établi pour constituer
un modèle (normes) et à la fois suffisamment souple pour
Tableau 1. Grille de Palo Alto simplifiée.
Qui est le demandeur ?
Quel est le problème ?
En quoi est-ce un problème ?
Quel est l’objectif ?
Quelles sont les ressources ?
Quelle est la position du client ? Son système de valeurs ?
Quelles sont les tentatives de solutions ?
Y a-t-il une thématiques des tentatives de solutions ?
s’adapter (liberté). Le problème est d’abord clarifié, la
demande incluse dans le système dans lequel elle s’inscrit.
On explore ensuite les tentatives de solution, ce que le
patient a tenté de faire pour résoudre le problème et qui
relève souvent du bon sens. Les thérapeutes de Palo Alto
rappellent judicieusement que le bon sens marche dans
95 % des cas. Donc, dans 5 % des cas, il faut essayer autre
chose.
Le principe de l’intervention est d’extraire une théma-
tique des tentatives de solution inefficaces et de proposer
une tâche dont la thématique est à l’opposé. Cesser ainsi
de faire ce qui ne marche pas et maintient le problème,
voire l’aggrave. C’est ce qui peut donner l’aspect paradoxal
des tâches thérapeutiques, mais comme on le voit, il existe
des bases théoriques solides, ce n’est pas le « paradoxe
pour le paradoxe ». Au fond, dans un cadre méthodolo-
gique établi, le modèle de Palo Alto correspond aux mots
d’Erickson selon lequel il faut une nouvelle théorie pour
chaque patient.
La thérapie orientée sur la solution
et les types de relation thérapeutique
Steve de Shazer et son équipe sont à l’origine de la
thérapie centrée sur les solutions. Résumer la thérapie solu-
tionniste en quelques lignes est impossible. Il s’agit d’un
changement paradigmatique important par rapport à l’idée
générale qu’on peut avoir de la thérapie. L’idée est encore
de pouvoir communiquer efficacement en se centrant non
pas sur le problème et ses causes mais sur les compétences
du patient et les solutions qu’il peut mettre en place [30]. Le
patient possède des ressources, le thérapeute est un « pas-
seur » qui l’aide à les trouver et jamais ne lui impose. Par le
passé, il a su aller mieux, comment faisait il ? Il sait encore
parfois aller mieux certains jours : comment fait-il ? Peut-
il le refaire ? Quand le problème sera résolu, que fera-t-il
de différent ? Peut-il, a-t-il déjà commencé ? Beaucoup de
rigueur et de pratique sont nécessaires.
714 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Hypnose et thérapies brèves, normes et liberté
Les solutionnistes restent anosographiques dans
l’application de leurs modèles. On ne juge pas de
l’amélioration selon nos critères. Car le thérapeute est
expert de la relation thérapeutique mais le patient est
expert de sa vie. Il est le seul à pouvoir juger que les choses
sont mieux pour lui. Parfois, seul son angle de vue s’est
modifié, ou bien il réalise qu’il a plus d’outils qu’il ne le
pensait pour le rapprocher de la solution qui n’a rien à voir
avec le problème.
Sans entrer dans les détails de la méthode, revenons
à notre questionnement. Comment les solutionnistes ont
ils abordé notre question de norme et de liberté dans leur
modèle : associer la rigueur de ces techniques de commu-
nication, au caractère unique de chaque type de relation.
De Shazer a modélisé les types de relations [29] en thé-
rapie dans une simplification extrêmement pertinente et
maniable. Le patient entre avec vous soit dans une relation
de type « client », soit dans une relation de type « plai-
gnant », soit dans une relation de type « touriste » ;
•le « client » a une demande d’emblée travaillable, il peut
admettre qu’il a des ressources et souhaite qu’on l’aide. Il
peut être « acheteur », prêt à accepter ce qu’on lui propose et,
dans le meilleur des cas, il est même « co-thérapeute », il éla-
bore avec le thérapeute une solution pertinente. Ces patients
existent. S’ils étaient tous ainsi, presque tout marcherait
presque à tous les coups ;
•le « plaignant » n’a pas de vraie demande mais surtout
une plainte. Il cherche à être compris, entendu, il cherche
une reconnaissance de sa souffrance au travers de sa plainte.
Il a du mal à reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui
lui arrive, c’est souvent la faute des autres. Si vous l’abordez
de fac¸on trop directe en proposant un changement de point
de vue ou une proposition de changement, vous risquez de
compromettre la relation : « Mais Docteur, je crois que vous
ne comprenez pas : je souffre » ;
•enfin le touriste vient parce qu’on l’a envoyé. Ce n’est pas
sa demande, mais celle d’un autre. Il n’a pas de demande et
ne souscrit même pas à celle du tiers. Le patient alcoolique
qui est envoyé par sa femme, l’adolescent par ses parents,
le suivi sociojudiciaire en sont des exemples.
Le génie de Shazer et son équipe est, entre autres, de se
comporter différemment avec un patient selon sa position
relationnelle. Ils élaborent des outils pour amener le plai-
gnant ou le touriste à devenir client. Et si les solutionnistes
utilisent parfois des tâches thérapeutiques, des échelles, des
compliments et autres outils de communication et de théra-
pie, ce ne sera pas en fonction du symptôme, mais du type
de relation.
Thérapies stratégiques : notion
de diagnostic fonctionnel
Un élève italien de Palo Alto, Giorgio Nardone, par-
rainé par Watzlawick, va faire évoluer la thérapie vers ce
qu’il nomme la thérapie stratégique [39]. Plusieurs intérêts
le guident et peuvent nous intéresser dans son approche.
Nardone s’intéresse avant tout aux problèmes enkystés, aux
problèmes tellement ancrés dans la personne que la théra-
pie devient difficile car le symptôme fait partie de l’identité.
Par ailleurs, Nardone s’intéresse aux tâches thérapeutiques
à l’époque où les TCC codifient les tâches à donner aux
patients. Il se demande quelles sont les tâches qui fonc-
tionnent. Cependant, son influence ericksonienne et Palo
Alto lui font dire que les tâches ne doivent pas avoir pour but
de modifier les cognitions mais les perceptions et qu’il ne
suffit pas de s’intéresser au comportement dans une tâche,
car le but n’est pas de modifier une réaction comporte-
mentale mais bien la perception qui en est à l’origine (ce
qui le rend, de ce point de vue, une peu plus proche de
l’hypnose qui est psychocorporelle).
Enfin, Nardone et al. souhaitent replacer un peu de
nosographie dans la pratique, nécessaire selon lui, mais de
fac¸on originale et stratégique. Un diagnostic ne doit pas
être descriptif uniquement (c’est-à-dire visant à classifier
les patients en catégories), mais plutôt fonctionnel (c’est-à-
dire expliquant le fonctionnement du symptôme et devant
mener à une intervention) [23].
Il décrit le système de perceptions réactions (SPR)
(figure 1). Si le symptôme est ancré, fait partie de la per-
sonne, c’est parce que la personne est entrée dans un SPR
qui tourne en boucle, dont elle ne sort plus, qui l’identifie
à son symptôme [22].
Par exemple, dans l’attaque de panique : le patient
« perc¸oit » des sensations physiques (palpitations, trem-
blements), il « réagit » par une tentative de contrôle de ces
sensations qui généralement aggrave les sensations problé-
matiques et lui donne envie encore plus de contrôler, etc.
Pour les autres troubles anxieux, les SPR comportera une
perception de peur et une réaction d’évitement pour la pho-
bie et une perception d’une idée obsédante avec une réaction
Réaction
Perception
Le SPR
Figure 1. Le système de perception-réaction d’après G. Nardone.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 715
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%