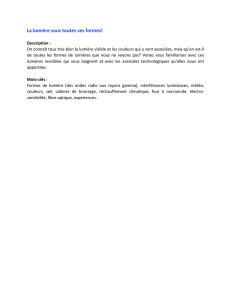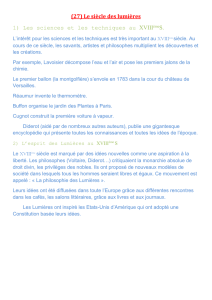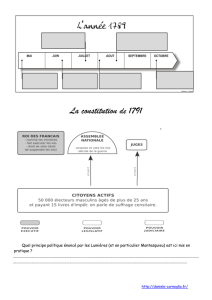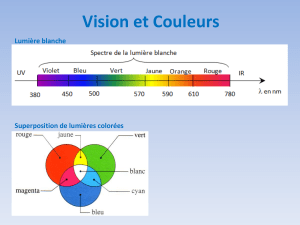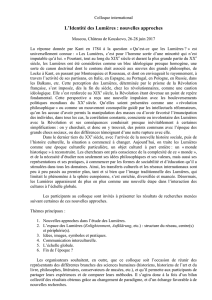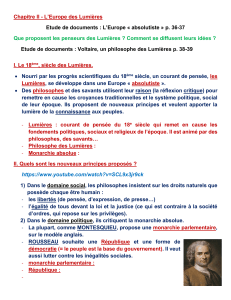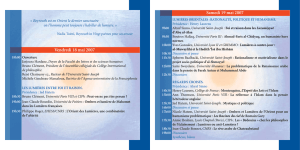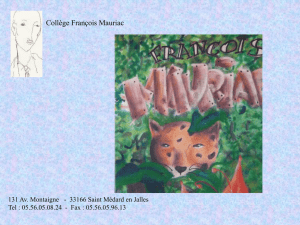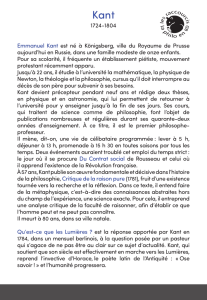I. Les deux dix-huitièmes siècles Dans les années 1980, les éditions

QU’EST-CE QUE LES LUMIERES ?
I. Les deux dix-huitièmes siècles
Dans les années 1980, les éditions Arthaud font paraître en dix volumes une
Littérature française qui propose, pour le dix-huitième siècle, une nouvelle périodisation
tendant à la couper en deux. De 1680 à 1750, « De Fénelon à Voltaire », se déploierait une
première période centrée sur la littérature morale : depuis les moralistes et les
mémorialistes du siècle de Louis XIV (les Caractères de La Bruyère, publiés de 1688 à
1696 ; Les Aventures de Télémaque de Fénelon, de 1694 à 1696 ; les Mémoires de Saint-
Simon, commencées en 1694, rédigées pour l’essentiel de 1739 à 1749) jusqu’aux
romanciers et dramaturges de la sincérité et de l’examen de soi (le Cleveland de Prévost est
publié de 1731 à 1739, La Vie de Marianne de Marivaux, de 1731 à 1742) et même aux
premiers philosophes modérés (les Lettres persanes de Montesquieu paraissent en 1721, les
Lettres philosophiques de Voltaire datent de 1734, son Zadig, de 1747), se dessinerait un
siècle intermédiaire heureux et raisonnable, qu’il conviendrait d’opposer à une seconde
période, plus tumultueuse, allant de 1750 à 1820, c’est-à-dire des débuts de l’Encyclopédie
(le Prospectus est mis en circulation en novembre 1750, le 1er volume sort en 1751, puis un
volume par an jusqu’en 1757, le tome VII contenant l’article GENEVE) au combat
voltairien contre l’infâme dans les années 60 (affaire Calas, Traité sur la tolérance,
Dictionnaire philosophique) et parallèlement à la publication des principales œuvres de
Rousseau (Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761 ; Émile ou de l’Éducation, 1762), aux dialogues
philosophiques les plus audacieux de Diderot au début des années 70 (Rêve de D’Alembert
en 1769, Paradoxe sur le comédien en 1770), puis à Restif de la Bretonne (Le Paysan
perverti, 1775), à Laclos (Les Liaisons dangereuses, 1782) et à Beaumarchais (Le Mariage de
Figaro, 1778, représenté en 1784), enfin à Sade pendant la période révolutionnaire (la
première Justine paraît en 1791, La Nouvelle Justine en 1799). Mais Sade ne clôt plus la
période : le courant pré-romantique lui est adjoint, avec Mme de Staël (Corinne ou l’Italie,
1807) et Benjamin Constant (Adolphe, 1816).
Toute périodisation implique un choix : privilégier une œuvre, un courant, établir
une rupture, c’est nécessairement minorer en contrepartie d’autres œuvres, d’autres
ruptures. Le mérite de celle-ci est de réévaluer les littératures de tournants de siècle, qui
ont connu, de la part des chercheurs, un fort regain d’intérêt depuis maintenant une
trentaine d’années : il s’agit d’une part de la littérature morale du Grand Siècle finissant
(La Bruyère et ses épigones), d’autre part de la littérature de la période pré-révolutionnaire,
révolutionnaire et impériale (Restif, Mercier, Mme de Staël). Deuxième intérêt : en
plaçant au milieu du dix-huitième siècle le moment d’une rupture décisive, cette
périodisation met en évidence le rôle majeur de la publication de L’Esprit des lois en 1748
par Montesquieu. De l’aveu même des contemporains, cette publication a fait date comme
point de départ de l’aventure philosophique des Lumières : en témoigne par exemple
l’Éloge de Montesquieu placé en tête du tome V de l’Encyclopédie, en hommage à l’auteur
de L’Esprit des lois qui venait de mourir.

Stéphane Lojkine, Qu’est-ce que les lumières ?
2
II. Y a-t-il un siècle de Louis XV ?
Mais le dix-huitième siècle en tant que moment, et que moment français de la pensée
européenne, disparaît, au mépris de la périodisation historique, pourtant fortement
marquée : en 1715, la mort de Louis XIV marque la fin d’une époque, qui conduira
Voltaire à nettement différencier un Siècle de Louis XIV et un Siècle de Louis XV. A l’autre
bout du siècle, la Révolution puis l’Empire introduisent des bouleversements politiques
sans précédent dans notre Histoire. On gardera donc en tête ces jalons historiques :
1715, mort de Louis XIV, Régence du duc d’Orléans. L’événement marquant de la
Régence est la crise financière initiée par le système de Law (1715-1720)
1. 1716, John Law crée la Banque générale, qui est autorisée par le Régent à émettre du
papier monnaie, gagé sur l’or. Forte de son succès, la banque émet plus d’argent en
billets qu’elle ne possède de réserves en or.
2. 1717, John Law se lance dans le commerce colonial et crée la Compagnie
d’Occident, pour exploiter notamment la Louisiane. Sa Compagnie absorbe
diverses compagnies existantes, pour devenir en 1719 la Compagnie perpétuelle
des Indes, qui rachète les rentes versées par le royaume : elles seront désormais
payées en billets.
3. 1720, fusion de la Banque générale, devenue Banque royale et de la Compagnie des
Indes. Les ennemis de Law spéculent à la hausse, puis vendent brutalement leurs
actions : c’est la banqueroute. Law s’enfuit à Venise.
1723, début du règne de Louis XV, sous le ministère du cardinal de Fleury jusqu’en 1743.
1745 Louis XV rencontre Jeanne Poisson, future Mme de Pompadour
1757, attentat de Damiens
Le règne de Louis XV est marqué par trois guerres européennes, centrées sur la Pologne
dans les années 30, sur l’Autriche dans les années 40 et sur le Canada dans les années 50 :
1. 1733-1738. Guerre de succession de Pologne. La France ne réussit pas à imposer son
prétendant, Stanislas, qui deviendra duc de Lorraine. C’est le candidat des
Prussiens, Auguste III, qui monte sur le trône.
2. 1740-1748. Guerre de succession d’Autriche. Elle démarre avec l’invasion de la
Silésie par la Prusse. La France soutient la Prusse, mais est trahie par une paix
séparée. Elle se trouve alors diplomatiquement isolée.
3. 1756-1763. Guerre de Sept Ans. Son enjeu est à la fois européen (conflit entre
l’Autriche et la Prusse pour le contrôle de la Silésie) et colonial (conflit entre la
France et l’Angleterre dans les colonies d’Amérique du nord et d’Inde). L’Autriche
et la France sortent grands perdants de cette guerre : c’est notamment la fin du
Canada français.
1774, mort de Louis XV, Louis XVI lui succède
1792, proclamation de la 1ère république, qui va durer jusqu’en 1804. La 1ère phase de la 1ère
république est désignée comme « La Convention ».
1793 Louis XVI est guillotiné
1795-1799 Directoire (2e phase de la 1ère république), jusqu’au coup d’état du 18 Brumaire
(9 novembre 1799)
1799-1804 Consulat (3e phase de la 1ère république), jusqu’au couronnement de Napoléon
Ier.

Stéphane Lojkine, Qu’est-ce que les lumières ?
3
III. La définition kantienne des lumières : usage public et usage privé des lumières
Il apparaît dès lors nécessaire de se poser une question que le dix-huitième siècle s’est
lui-même posée : qu’est-ce que les Lumières ? Les Lumières ne désignent pas à strictement
parler une époque, mais plutôt un état d’esprit, un engagement intellectuel. Les Lumières
ne sont pas idéologiquement neutres : elles politisent et donc nécessairement elles
partialisent l’approche historique. Mais la définition du dix-huitième siècle comme siècle
des Lumières est la seule définition qui en circonscrive, sans fracture, l’unité séculaire,
définie comme une unité épistémologique, le contenu intellectuel d’une époque qui n’est
ni celle de la pensée classique, ni celle du romantisme. On voit ainsi se dessiner les attendus
idéologiques de ce débat sur la périodisation : séparer le temps de la littérature morale et
rococo d’une part, le temps de la contestation et du sentiment pré-romantique d’autre
part, c’est refuser l’unité des Lumières au nom de l’objectivité de l’historien, qui ne peut
laisser dans l’ombre des pans entiers du corpus littéraire ; maintenir un dix-huitième siècle
unique, c’est se réclamer des Lumières contre une objectivité de façade qui pourrait cacher
un dangereux désengagement, mettre sur le même plan des textes qui n’ont pas du tout la,
les mêmes portées, noyer Marivaux dans La Bruyère, et Sade dans Mme de Staël.
Mais au fait qu’est-ce que ces Lumières qui, aujourd’hui encore, implicitement ou
explicitement, divisent la communauté scientifique ? Kant peut nous aider à y voir plus
clair. En effet, en décembre 1783, une revue berlinoise, Berlinische Monatsschrift (Le
Mensuel berlinois), publie la note d’un pasteur, Johann Friedrich Zöllner, qui, partisan des
Lumières, s’irritait cependant de ses excès, et notamment de l’abolition que ses partisans
préconisaient du mariage religieux, dans le numéro de septembre. Zöllner s’exclamait
donc :
« Qu’est-ce que les lumières ? Cette question, qui est presque aussi importante que la
question : “Qu’est-ce que la vérité ?”, devrait tout de même recevoir une réponse, avant qu’on
se mît à éclairer les gens ! Or cette réponse, je ne l’ai rencontrée nulle part !1 »
Il est intéressant de noter d’emblée le contexte polémique dans lequel cette question
s’inscrit, comme s’il ne pouvait y avoir de Lumières sans soupçon d’un terrorisme
intellectuel des Lumières. Un an plus tard, en décembre 1784, Kant fait paraître sa réponse
à la question de Zöllner, sous le titre « Réponse à la question : qu’est-ce que les
lumières ? » (Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung ?). La première phrase de ce
court texte d’une demi douzaine de pages est en italiques, et délivre la définition
proprement dite :
« Les lumières se définissent comme la sortie de l’homme hors de l’état de minorité, où il se
maintient par sa propre faute. » (P. 209.)
Il y a eu une enfance de l’homme, et il y aura une maturité : les lumières sont l’expérience
d’un entre-deux, une sorte de prise de conscience de l’adolescence de l’humanité. La
définition kantienne des lumières inscrit donc un statut, un état de l’homme dans un
processus, ou autrement dit un contenu idéologique dans une périodisation. L’ambiguïté
est là dès le départ : les lumières sont une période de l’histoire et les lumières sont un
engagement militant, personnel, de l’homme. Les lumières périodisent l’histoire, avec ce
1 Kant, Œuvres philosophiques, éd. F. Alquié, Gallimard, Pléiade, 1985, t. II, p. 1440.

Stéphane Lojkine, Qu’est-ce que les lumières ?
4
que cela suppose d’objectivation ; mais les lumières engagent l’homme, avec ce que cela
implique de subjectivation.
Cette dimension subjective est soulignée par Kant : c’est « par sa propre faute » que
l’homme se maintient dans l’état de minorité ; c’est de lui seul donc, de sa « résolution » et
de son « courage » que dépend la sortie de la minorité :
« Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des
lumières. »
La formule latine est empruntée aux épîtres d’Horace2, mais détournée de son sens : il ne
s’agit plus de curiosité, ou d’esprit d’entreprise, mais plutôt du courage que requiert
l’autonomie intellectuelle : il faut sortir du confort des arguments d’autorité, se détacher
de l’autorité de l’église, de l’état, comprises moins comme des tutelles qui nous sont
imposées de l’extérieur que comme une servitude volontaire.
La devise des lumières est donc d’abord une injonction morale. Ce qu’on désigne
comme littérature morale, de Fénelon et La Bruyère à Marivaux, se trouve scindé par cette
injonction, entre une morale qui tire sa grandeur de la soumission à l’Église (c’est le sens
des Caractères et de leur dernière section « Des esprits forts ») et une morale de
l’autonomie, qui ne produit ses valeurs que dans l’expérience et dans la rétrospection (la
solitude de la Marianne de Marivaux, orpheline et abandonnée, est significative de ce
nouvel état d’esprit). On ne distingue pas ici la morale conçue comme genre à part entière
de la morale prise comme cadre de la fiction : de la même façon en effet, le courage,
héroïque et sublime, de Mme de Clèves, dans le roman de Mme de Lafayette (1678) ne
relève pas du sapere aude kantien, mais de la soumission aux prescriptions de Mme de
Chartres, du renoncement de soi, à l’opposé du courage révolté de la Clarisse de
Richardson (1747), héroïne pourtant tout aussi pieuse, mais dont le calvaire tragique passe
par l’émancipation de sa famille, de ses amis même, et la revendication de son autonomie :
Clarisse ne renonce pas à l’adultère, mais au mariage ; elle ne cherche pas la retraite hors du
monde, mais l’inscription dans le monde, grâce à la laiterie que son grand-père lui a léguée.
Mais cette sortie de la minorité, quel est son processus ? Après avoir insisté sur la
dimension subjective de cette sortie, et sur l’injonction morale qui se pose
individuellement à chacun d’entre nous, Kant souligne paradoxalement le caractère
collectif de ce processus :
« Il est donc difficile pour l’individu de s’arracher tout seul à la minorité, devenue pour lui
presque un état naturel. Il s’y est même attaché, et il est pour le moment réellement incapable
de se servir de son propre entendement, parce qu’on ne l’a jamais laissé s’y essayer. […] En
revanche, la possibilité qu’un public (ein Publikum) s’éclaire lui-même est plus réelle ; cela est
même à peu près inévitable, pourvu qu’on lui en laisse la liberté. » (P. 210.)
Il n’y a pas de lumières sans « un public », c’est-à-dire une opinion publique, dont la
constitution est directement et intimement liée au développement de la littérature au dix-
huitième siècle. L’essor de la presse contribue de façon décisive à cette constitution des
opinions publiques ; la presse à son tour forme, nourrit les écrivains : Marivaux crée Le
Spectateur français (1721-1724), puis Le Cabinet du philosophe ; Prévost, espérant régler
ainsi ses dettes, crée Le Pour et le contre (1733) ; Restif s’achète une presse pour imprimer
2 Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, | incipe, Celui qui a commencé tient la moitié du fait : ose
savoir, commence (Horace, Épîtres, I, 2, 40).

Stéphane Lojkine, Qu’est-ce que les lumières ?
5
Les Nuits de Paris et projette de créer un journal en 1789… Mais la presse n’est ici que le
symptôme d’un nouveau rapport au lecteur et, par lui, à la diffusion des écrits, qui dépasse
désormais largement les cercles feutrés des salons parisiens et les loisirs solitaires des oisifs
provinciaux : l’Encyclopédie se constitue d’abord comme une société de gens de lettres,
pour s’adresser ensuite à une communauté de lecteurs éclairés ; elle interpelle la société
tout entière et, comme en témoigne les scandales que produit la sortie de chacun des 7
premiers volumes, ladite société réagit vivement ; la campagne de Voltaire contre l’Infâme,
autour des grandes affaires judiciaires des années 1760, vise et réussit efficacement à
mobiliser une opinion publique qui obtient la réhabilitation de Calas ; la retraite même
d’un Rousseau3, qui refuse ce qu’il considère comme une compromission avec la
corruption du monde, témoigne de l’émergence inédite et décisive de ce nouvel espace
public, par rapport auquel l’ensemble de la littérature des lumières se définit désormais.
Le nouvel espace public favorise la diffusion des lumières et l’émergence de la
liberté, qui devient la nouvelle valeur fondamentale. La question qui se pose alors est celle
de la limitation de cette liberté, qu’exigent l’officier à l’armée, le percepteur au moment de
percevoir l’impôt, le prêtre exigeant la foi, et Dieu même qui commande obéissance :
« Dans tous ces cas, il y a limitation de la liberté. Or quelle limitation fait obstacle aux
lumières ? Quelle autre ne le fait pas, mais les favorise peut-être même ? — Je réponds : l’usage
public de notre raison doit être toujours libre, et lui seul peut répandre les lumières parmi les
hommes ; mais son usage privé peut souvent être étroitement limité, sans pour autant
empêcher sensiblement le progrès des lumières. Or j’entends par usage public de notre propre
raison celui que l’on en fait comme savant devant l’ensemble du public qui lit. J’appelle usage
privé celui qu’on a le droit de faire de sa raison dans tel ou tel poste civil, ou fonction, qui nous
est confié. » (P. 211.)
Par usage public, Kant entend donc la communication savante des idées à un public, c’est-
à-dire une liberté abstraite, d’opinion, permettant la publication libre d’ouvrages, la liberté
de la presse. Par usage privé, il faut comprendre au contraire l’application pratique de ces
idées, au niveau individuel, dans le travail ou la charge qui nous est confiée : l’usage privé de
la liberté comporte la désobéissance civile, et ne saurait être toléré.
On est frappé ici de l’usage pour ainsi dire paradoxal que Kant fait des termes
« public » et « privé ». L’usage public touche à la réflexion personnelle que le citoyen
développe chez lui ou avec des amis, ou dans telle ou telle société savante, en dehors de
toute fonction politique, de tout travail. C’est que nous appellerions aujourd’hui la sphère
privée, mais Kant porte tout l’accent sur la liberté de publier, de livrer à l’opinion publique
ce qui a été élaboré dans cette sphère privée.
A contrario, l’engagement du citoyen dans la société, par son travail, par ses fonctions,
délimite ce que nous appellerions aujourd’hui la sphère publique. Mais Kant porte tout
l’accent sur la marge de manœuvre individuelle dans cette sphère, c’est-à-dire bel et bien
sur l’usage privé qu’on en peut faire, et qui se trouve légitimement, selon lui, limité.
Cette distinction du public et du privé, absolument centrale dans la description du
processus de diffusion des lumières, paraît en tous cas pour le moins embrouillée : derrière
la nette séparation posée par Kant entre un usage public absolument libre et un usage privé
nécessairement limité, nous voyons se dessiner un entrelacement beaucoup plus complexe
entre sphère privée et usage public, entre sphère publique et usage privé. Tout porte à
3 Tout commence en avril 1756, lorsque Mme d’Épinay offre à Rousseau un ermitage au fond de sa propriété
de la Chevrette.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%