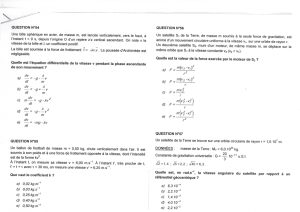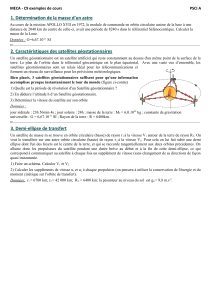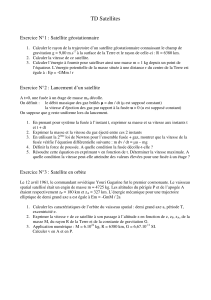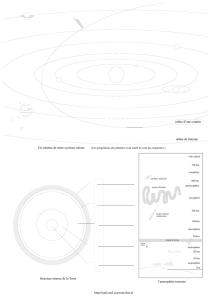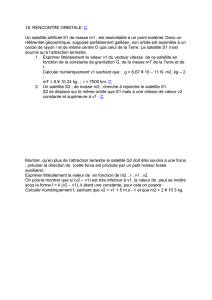D.S.T. N° 5

CLASSE DE TERMINALE S
Le : 11 mars 2015
Durée : 3 h 30
Physique-Chimie
DEVOIR SUR TABLE N° 5
L’épreuve a été conçue pour être traitée sans calculatrice.
L’usage des calculatrices est rigoureusement interdit.
TOUT DOCUMENT INTERDIT.
Les résultats numériques doivent être précédés d’un calcul littéral.
La présentation et la rédaction font partie du sujet et interviennent dans la notation.
L’épreuve est notée sur 16 points auxquels s’ajouteront les points d’épreuve pratique sur 4 points.
I ] EXERCICE 1 : sur 5,0 points.
STÉRÉOISOMÉRIE
STÉRÉOISOMÉRIESTÉRÉOISOMÉRIE
STÉRÉOISOMÉRIE
A ] L’éphédrine.
L'éphédrine A est une molécule naturelle qui peut être extraite de petits arbustes appelés éphédras. Elle a des
activités thérapeutiques (décongestionnant, broncho-dilatateur), mais accroît les risques d'hypertension. Une représentation
de cette molécule est donnée en A ci-dessous.
1. 1.1. Reproduire la molécule A et encadrer les groupes caractéristiques qu’elle contient. Les nommer.
1.2. L'éphédrine est-elle une molécule chirale ? Justifier la réponse.
2. On s’intéresse aux molécules B et C représentées ci-dessus.
2.1. Laquelle est énantiomère de la molécule A ? Justifier.
2.2. Laquelle est diastéréoisomère de la molécule A ? Justifier.
3. On compare les molécules A et B.
Ont-elles la même température de fusion ? Ont-elles la même activité thérapeutique ? Justifier les réponses.
4. On compare les molécules A et C.
Ont-elles la même température de fusion ? Ont-elles la même activité thérapeutique ? Justifier les réponses.
B ] Synthèse asymétrique.
Il est souvent nécessaire de disposer d'une molécule sous la forme d'un énantiomère pur. Or, lors des synthèses
organiques au laboratoire ou dans l'industrie, les chimistes obtiennent généralement deux énantiomères en proportions
égales. Cependant, lorsqu'un des réactifs est présent sous la forme d'un seul énantiomère et que l'on introduit un nouvel
atome de carbone asymétrique, on obtient généralement deux produits dont l'un est majoritaire : on parle de synthèse
asymétrique. Ainsi, pour la réaction écrite ci-dessous, les produits B et C ne sont pas obtenus en quantités égales.
1. Donner un exemple de composé pour lequel il peut être fondamental de disposer d'un énantiomère pur.
2. Comment appelle-t-on le mélange équimolaire de deux énantiomères ?
3. Quel groupe d'atomes caractéristique reconnaissez-vous dans la molécule A ? Donner le nom du réactif A.
4. Les molécules B et C sont-elles chirales ? Justifier la réponse.
5. Que peut-on dire des molécules B et C l'une par rapport à l'autre ? En déduire si l'on peut espérer séparer B et C par
distillation. Justifier les réponses.
... / ...

II ] EXERCICE 2 : sur 4,5 points.
ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DU
ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DUÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DU
ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DU MOUVEMENT D’UNE BAL
MOUVEMENT D’UNE BAL MOUVEMENT D’UNE BAL
MOUVEMENT D’UNE BALLE
LELE
LE
Une balle de masse m = 80 g lancée avec une vitesse initiale V0 effectue un rebond sur le sol.
L'enregistrement vidéo de son mouvement et le traitement informatique des données permettent de visualiser :
les positions successives de son centre d'inertie dans un repère (O, x, y) (Figure 1). L'origine des altitudes
est choisie en O au niveau du sol ;
les variations des énergies cinétique Ec, potentielle de pesanteur Epp et mécanique Em de la balle au
cours du mouvement (Figure 2).
Donnée : g = 10 m.s-2.
Aides aux calculs : 130
4 ≈ 5,7 ; 20 ≈ 4,5 ; 5 ≈ 2,25 ; 1, 2 5 ≈ 1,1.
1. 1.1. Donner les expressions littérales des énergies Ec, Epp et Em en fonction des données de l'énoncé et de la
vitesse V de la balle.
1.2. Identifier chaque courbe de la Figure 2 en justifiant les choix.
2. Déduire des courbes la valeur de la vitesse initiale V0 de la balle, de l'altitude y0 de départ de la balle et de la vitesse
maximale Vmax atteinte par la balle lorsqu'elle touche le sol.
3. De quoi résulte la variation de vitesse de la balle entre le départ et le rebond ?
4. 4.1. Commenter la courbe représentative de l'énergie mécanique à l'instant du choc et proposer une explication.
4.2. Évaluer l'énergie dissipée à cet instant.
5. 5.1. Après le rebond, quel transfert d'énergie permet à la balle d'atteindre le point culminant de sa trajectoire ?
5.2. Après le rebond, déterminer les valeurs de la vitesse V1, et de l'altitude y1 de la balle au sommet de sa
trajectoire.
6. Avant et après le rebond, les frottements dus à la résistance de l'air sont négligeables. Justifier.
III ] EXERCICE 3 : sur 6,5 points.
LANCEMENT D’UN SATEL
LANCEMENT D’UN SATELLANCEMENT D’UN SATEL
LANCEMENT D’UN SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE
LITE MÉTÉOROLOGIQUELITE MÉTÉOROLOGIQUE
LITE MÉTÉOROLOGIQUE
Le centre spatial de Kourou a lancé le 21 décembre 2005, avec une fusée Ariane 5, un satellite de météorologie de seconde
génération, baptisé « MSG-2 ». Tout comme ses prédécesseurs, il fut placé sur une orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude.
Opérationnel depuis juillet 2006, il porte le nom de « Météosat 9 ».
Les satellites de seconde génération sont actuellement les plus performants au monde dans le domaine de l'imagerie
météorologique. Ils assureront jusqu'en 2018 la fourniture de données météorologiques, climatiques et environnementales.
L'objectif de cet exercice est d'étudier plusieurs étapes de la mise en orbite de ce satellite.
Les parties 1, 2 et 3 de cet exercice sont indépendantes.
Certaines aides au calcul peuvent comporter des résultats ne correspondant pas au calcul à effectuer.
1. Décollage de la fusée Ariane 5.
Pour ce lancement, la fusée Ariane 5 a une masse totale M. Sa propulsion est assurée par des
moteurs fournissant une force de poussée verticale et constante, F
, de valeur F. Tout au long du décollage,
on admet que la valeur g du champ de pesanteur est également constante. On étudie le mouvement du
système {fusée} dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, et on choisit un repère (O, j
) dans lequel j
est un vecteur unitaire vertical dirigé vers le haut et porté par l'axe ( Oy
). À l'instant t0 = 0 s, Ariane 5 est
immobile et son centre d'inertie G est confondu avec l'origine O.
L'accélération du centre d'inertie G de la fusée sera notée : a
G = ay j
, sa vitesse : v
G = vy j
et la
position de son centre d'inertie : OG
= y j
(Voir Figure ci-contre).
Données : Masse totale de la fusée : M = 7,3.105 kg ; Force de poussée : F = 1,16.107 N ; g = 10 m.s-2.
Aides aux calculs : 1, 1 6
7,3 ≈ 1,6.10 –1 ; 7,3
1, 1 6 ≈ 6,3 ; 1,16x7,3 ≈ 8,5 ; 1,24x6,1 ≈7,6 ; 6,67x6,0 ≈ 40 ; 6,0
4,0 ≈ 1,2 ; 4,0
7,0 ≈ 0,76.
On suppose que seuls le poids P
et la force de poussée F
agissent sur la fusée.
Pendant la durée de fonctionnement, on admettra que la masse de la fusée reste constante.
.../ p. 3

Terminale S D.S.T. N° 5 Page 3
1.1. Sans faire de calcul, représenter sur un schéma les forces agissant sur G pendant le décollage.
1.2. En appliquant une des lois de Newton au système {fusée}, trouver l'expression littérale de la valeur aG de
l'accélération a
G de G dès que la fusée a quitté le sol. Faire l’application numérique.
1.3. Pendant le lancement, on suppose que la valeur de l'accélération reste constante. Déterminer l'équation horaire
numérique de la valeur vG(t) de la vitesse v
G. En déduire l'équation horaire numérique de la valeur y(t) de la
position OG
.
1.4. La trajectoire ascensionnelle de la fusée reste verticale jusqu'à la date t1 = 6,0 s. Quelle distance la fusée a-t-elle
alors parcourue depuis son décollage ?
2. Mise en orbite basse du satellite.
Dans la suite de l'exercice, on suppose que la Terre est une sphère de centre T, de masse MT, de rayon RT et qu'elle
présente une répartition de masse à symétrie sphérique. On assimile par ailleurs le satellite à son centre d'inertie S.
Données : MT = 6,0.1024 kg ; RT = 6,4.103 km ; Constante de gravitation universelle : G = 6,67.10 –11 kg-1.m3.s-2.
La mise en orbite complète du satellite MSG-2, de masse mS = 2,0.103 kg, s'accomplit en deux étapes. Dans un
premier temps, il est placé sur une orbite circulaire à vitesse constante vS à basse altitude : h = 6,0.102 km autour de la
Terre et il n'est soumis qu'à la force gravitationnelle créée par la Terre.
2.1. Donner l'expression vectorielle de la force gravitationnelle F
T/S exercée par la Terre sur le satellite S en fonction
des données.
2.2. En appliquant une loi de Newton, trouver l'expression du vecteur accélération a
S du centre d'inertie S du satellite.
2.3. Sans souci d'échelle, représenter sur un schéma, à un instant de date t quelconque, la Terre, le satellite, le
repère d’étude, ainsi que le vecteur accélération a
S.
2.4. Déterminer l'expression de la vitesse vS du centre d'inertie du satellite. Calculer sa valeur numérique sur l’orbite basse.
2.5. On note T le temps mis par le satellite pour faire un tour autour de la Terre. Comment appelle-t-on cette
grandeur ? Montrer qu'elle vérifie la relation : T 2 = 4
π
ππ
π
2 (RT + h)3 /
G
MT.
3. Transfert du satellite en orbite géostationnaire.
Une fois le satellite MSG-2 placé sur son orbite circulaire basse, on
le fait passer sur une orbite géostationnaire à l'altitude : h' = 3,6.104 km.
Ce transit s'opère sur une orbite de transfert qui est elliptique. Le
schéma de principe est représenté sur la Figure ci-contre.
Le périgée P est sur l'orbite circulaire basse et l'apogée A est sur
l'orbite géostationnaire définitive. Lorsque le satellite est au point P de
son orbite circulaire basse, on augmente sa vitesse de façon bien
précise : il décrit ainsi une orbite elliptique de transfert afin que l'apogée
A de l'ellipse soit sur l'orbite géostationnaire définitive. On utilise pour
cela un petit réacteur qui émet en P, pendant un très court instant, un
jet de gaz donnant au satellite l'impulsion nécessaire.
3.1. Énoncer la deuxième loi de Kepler, aussi nommée « loi des aires ».
3.2. Montrer, en s'aidant éventuellement d'un schéma, que la vitesse du satellite MSG-2 n'est pas constante sur son
orbite de transfert. Préciser en quels points de son orbite de transfert sa vitesse est maximale et en quels points
elle est minimale.
3.3. Exprimer la distance AP en fonction de RT, h et h'. Calculer la valeur numérique de AP.
3.4. Dans le cas de cette orbite elliptique, la durée de révolution pour faire un tour complet de l'orbite vaut : T ' = 10 h 42 min.
Déterminer la durée minimale ∆
∆∆
∆t du transfert du satellite MSG-2 du point P de son orbite basse au point A de
son orbite géostationnaire définitive.
3.5. Le satellite étant arrivé au point A, on augmente à nouveau sa vitesse pour qu'il décrive ensuite son orbite
géostationnaire définitive. Le lancement complet du satellite est alors achevé et le processus permettant de le
rendre opérationnel peut débuter.
Interpréter le rôle du petit réacteur émettant un jet de gaz en P et en A.
1
/
3
100%