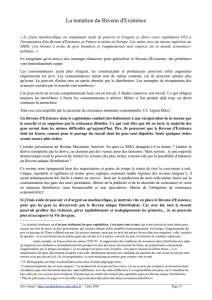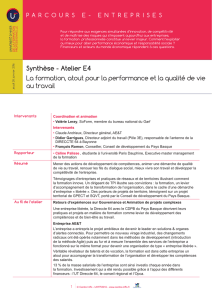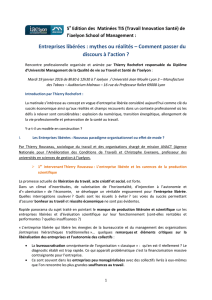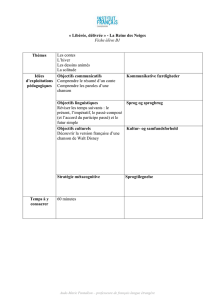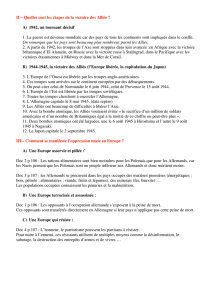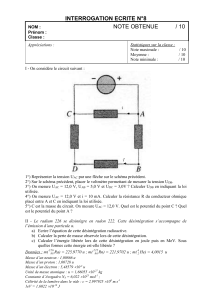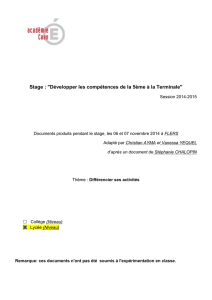Il faut libérer l`entreprise libérée

n° 163 > avril 2017 > 33
Il faut libérer
l’entreprise
libérée
Le succès du concept
d’entreprise libérée
doit beaucoup à Isaac Getz
et à quelques dirigeants qui
en ont appliqué les principes.
Il s’explique aussi par une
capacité à répondre à
une demande sociale latente
de réintroduire de l’humanisme
dans nos organisations.
Cette forme organisationnelle
est-elle vraiment à la hauteur de
toutes les promesses
qu’elle véhicule ?
Auteur
Théo Holtz
Doctorant en sciences de gestion DBA,
université Paul-Valéry – Montpellier 3, consultant et coach
Ces dernières années,
«l’entreprise libérée» a littéralement
envahi l’espace public français. Dif-
cile d’échapper à cette déferlante
qui s’est répandue en innombrables
articles de presse, reportages télévi-
sés, billets et vidéos sur internet1. Le
concept est à la mode et touche les
professionnels comme le grand public.
Il est vrai qu’il a de quoi séduire. Sur
fond de crise persistante, la fracture
entre des entreprises confrontées à
des dés inédits pour garantir leur
survie-développement et des sala-
riés démotivés, voire désengagés,
n’a jamais été aussi criante. Dans ce
contexte, l’entreprise libérée, c’est
avant tout une promesse: celle de
réconcilier performance économique
et bien-être au travail.
S’appuyant sur les résultats inso-
lents afchés par quelques entreprises
modèles surmédiatisées, les partisans
de l’entreprise libérée l’érigent au rang
de nouveau «one best way» mana-
gérial, pour reprendre l’expression de
Taylor, dont elle rejette justement les
principes. Cet enthousiasme a pro-
voqué en réponse un mouvement
de critiques, notamment de la part
de spécialistes de la fonction RH qui
dénoncent un discours fallacieux et
crient à une imposture orchestrée à
des ns commerciales. Qu’il fasse rêver
ou qu’il irrite, le phénomène de l’en-
treprise libérée ne laisse pas indiffé-
rent. À l’heure où de grands groupes,
comme Michelin ou Kiabi, déclarent
s’en inspirer pour redénir leur modèle
managérial, on ne peut ignorer le phé-
nomène si on s’interroge sur l’émer-
gence d’une nouvelle GRH.
Alors, miroir aux alouettes pour
une société en mal d’utopie ou réelle
innovation? En attendant que les
résultats des recherches académiques
en cours soient publiés, nous propo-
sons de faire le point sur ce concept.
De quoi parle-t-on exactement?
1 > Voir aussi l’article de Benoît Borrits et
Aurélien Singer, « L’entreprise libérée, est-ce
vraiment si nouveau ? », Économie et Mana-
gement, n° 162, janvier 2017.

34
Les nouveaux dés des ressources humaines
> économie & management
Existe-t-il un modèle de l’entreprise
libérée? En quoi ce concept apporte-
t-il des pistes de nouvelles approches
managériales et RH, dont on peut
s’inspirer et qui répondent aux dés
actuels de la GRH?
Qu’est-ce qu’une
entreprise libérée ?
Émergence du concept
«L’entreprise libérée» fait irrup-
tion dans le paysage médiatique de
notre pays en 2012 avec la publica-
tion de l’ouvrage de Carney et Getz
Liberté & Cie2, sorti trois ans plus tôt
aux États-Unis. Carney est journa-
liste au Wall Street Journal et Getz
professeur à l’ESCP Europe. C’est ce
dernier qui est à
l’origine de la dif-
fusion du concept
en France à tra-
vers de nombreux
articles, interviews
et conférences
auprès de publics professionnels.
Une campagne de communica-
tion efcace conduit à accroître sa
popularité de manière considérable.
Ainsi, une étude de la FNEGE datant
de 2016 classe Getz à la quatrième
place en citation spontanée des pen-
seurs, auteurs ou chercheurs vivants
ayant le plus d’inuence au monde
dans le domaine du management.
Parallèlement, quelques «dirigeants
libérateurs» charismatiques comme
Zobrist (FAVI) et Gérard (Chronoex)
participent à la diffusion du concept
par le témoignage de leur expérience
de terrain. En mars 2015, le documen-
taire de Meissonnier Le Bonheur au
travail sur Arte apporte une ampleur
supplémentaire au phénomène en
touchant un public plus large.
Une philosophie plus qu’un
modèle d’organisation
Getz étant à l’origine du concept
d’«entreprise libérée» telle que nous
l’entendons aujourd’hui, force est de
devoir compter sur la dénition qu’il
en donne: «Un environnement orga-
nisationnel dans lequel la majorité des
salariés sont complètement libres et
responsables d’entreprendre toutes
actions qu’eux-mêmes –pas leurs
supérieurs ni même les procédures–
décident comme étant les meilleures
pour réaliser la vision de leur entre-
prise» (Getz, 2016). Selon cet auteur,
il ne s’agit pas d’un business model ou
d’un mode d’organisation du travail
unique répondant à des règles prééta-
blies, mais d’une philosophie dont la
forme s’adapte au «contexte culturel
hérité pour construire un mode d’or-
ganisation unique» (Getz, 2016).
An d’expliciter cette philosophie,
Getz fait référence aux travaux sur
l’homme au travail de McGregor. Ce
dernier a proposé deux théories, dites
«X» et «Y», qui génèrent deux modes
d’organisation différents. Selon la
théorie X, «les salariés ont une aver-
sion intrinsèque pour le travail et
préfèrent être dirigés an d’échap-
per aux responsabilités» (McGregor,
1957). Suivant ce postulat, l’homme
au travail doit être nécessairement
commandé et contrôlé dans le cadre
d’une structure hiérarchique. Selon la
théorie Y, au contraire, l’homme est
par nature digne de conance, aspire
à la liberté et est désireux de s’investir
dans son travail. L’organisation doit
donc être pensée en plaçant l’homme
au centre, de manière à ce qu’il puisse
exprimer sa vraie nature. C’est la pro-
position de l’entreprise libérée.
Un autre concept théorique
mobilisé par Getz est la théorie psy-
chologique de l’autodétermination de
Deci et Ryan (1985). Selon ces auteurs
(2000), la motivation intrinsèque des
individus est déterminée par la satis-
faction de trois besoins universels:
l’autonomie, la compétence et le
besoin d’être en relation avec autrui.
L’entreprise libérée s’attache à créer
un environnement répondant à ces
besoins, que Carney et Getz (2009)
réinterprètent en auto-direction, réa-
lisation de soi et égalité intrinsèque.
Le terme «libéré» doit donc s’en-
tendre comme affranchi du joug d’une
organisation du travail, au sein de
laquelle le personnel est commandé et
contrôlé par une structure hiérarchique
qui lui dicte comment il doit faire son
travail. Les salariés passent d’un statut
d’exécutant à celui d’acteur libre et
responsable, créant de la valeur pour
l’entreprise tout en s’épanouissant.
Liberté – égalité – fraternité
Bien que l’entreprise libérée ne
constitue pas un modèle préétabli
d’organisation du travail, Carney et
Getz (2009) ont regroupé sous ce
terme générique un ensemble d’ex-
périences similaires dont la plus
ancienne, Gore, remonte à 1958. Sans
nécessairement se référer aux mêmes
sources, ces organisations de toutes
tailles et secteurs d’activité de par le
monde ont mis en place des modes de
gouvernance présentant un certain
nombre d’invariants.
Le fait de déclarer les salariés
«libres» suppose qu’on leur fait entiè
rement conance pour organiser leur
activité et leur temps de travail au sein
d’équipes autogérées. Il n’y a, en théo-
rie, plus de contrôle, que ce soit sur
les horaires, sur la manière de réaliser
le travail ou encore sur les quantités
produites. Chaque salarié a la liberté
de prendre toutes les décisions qui
lui paraissent pertinentes, à partir du
moment où elles contribuent au bien
commun. Plus aucune autorisation
hiérarchique n’est à demander pour
intervenir sur une machine, changer
de fournisseur ou organiser un dépla-
cement chez un client. De même, des
initiatives concernant des investisse-
ments peuvent être prises, moyennant
des processus d’arbitrages variables
selon les entreprises.
2 > On pourra consulter la note de lecture
consacrée à ce livre dans le n°162 d’Écono-
mie et management, également disponible
en libre accès sur www.reseau-canope.fr.
Dans l’entreprise
libérée, il n’y a,
en théorie plus,
de contrôle

n° 163 > avril 2017 > 35
Ces principes de subsidiarité et
d’autogestion ont pour corollaire la
suppression de la structure hiérar-
chique. Face à des équipes qui s’au-
togèrent, le rôle du chef qui décide et
contrôle n’est plus nécessaire. Les lignes
d’encadrement intermédiaire et de
proximité sont appelées à disparaître,
remplacées par de nouveaux statuts
managériaux dont les terminologies
sont propres à chaque organisation:
team leaders, coachs, sponsors, géné-
rateurs d’autonomie… Cooptés par leurs
pairs sur la base de leurs compétences,
ces néomanagers se consacrent à de
nouvelles activités créatrices de valeur.
Car l’entreprise libérée, c’est aussi la
chasse à toute fonction, procédure ou
tâche considérée comme inutile.
Par ailleurs, Carney et Getz
(2009) posent le principe «d’égalité
intrinsèque» comme une condition
de réussite à la mise en place d’un
environnement de type libéré. C’est
en supprimant tout signe extérieur
créant un sentiment d’inégalité que
chaque salarié peut se sentir consi-
déré comme un acteur responsable
à part entière. Ainsi, dans les entre-
prises libérées, tout symbole distinctif
ou privilège de «castes» est aboli:
plus de places de parking ou bureaux
réservés, plus de différences de stan-
ding dans les hôtels ou restaurants
lors des déplacements profession-
nels… Cette recherche d’égalité se
traduit également par une volonté
de transparence. L’information est
diffusée au même moment à tous.
Enn, aplatissement de la pyramide
oblige, l’entreprise libérée développe
des modalités de fonctionnement en
intelligence collective. Que ce soit au
sein des équipes autogérées ou dans
des groupes de travail transverses,
les décisions sont prises de manière
concertée, qu’elles concernent les
priorités d’investissement, le recru-
tement de nouveaux collaborateurs,
voire les niveaux de rémunération…
Ceci s’accompagne d’un renforcement
des liens sociaux. Pensée comme un
écosystème ouvert où les interactions
entre individus s’affranchissent de
l’ordre hiérarchique et du cloisonne-
ment des services, l’entreprise libérée
génère une uidité des échanges et
une libération de la parole. Au-delà de
la multiplication de signes de convivia-
lité, les différents témoignages font
état d’un accroissement des compor-
tements spontanés de coopération et
d’attention à l’autre. En instaurant une
véritable communauté de travail, l’en-
treprise libérée répond aux vœux de
Mintzberg (2008), «n’est-il pas temps
d’envisager nos organisations comme
des communautés de coopération?»,
et de Gomez (2013), «le problème de
l’entreprise, c’est de se penser comme
une organisation et pas comme une
communauté».
> Il faut libérer l
’
entreprise libérée

36
Les nouveaux dés des ressources humaines
> économie & management
Les raisons du succès
Rien de très nouveau
Malgré ses vertus, l’entreprise
libérée constitue-t-elle pour autant
une innovation en termes de GRH?
En réalité, ni sa philosophie, ni ses
caractéristiques ne sont réellement
nouvelles. De nombreux auteurs et
écoles de pensée ont depuis près
d’un siècle remis en cause l’organi-
sation du travail de type taylorien et
proposé des alternatives remettant
l’homme au centre. On peut citer, dès
le début du xxesiècle, Parker Follett
aux États-Unis et Dubreuil en France,
qui seront suivis par des théoriciens
du management
comme Drucker,
des psychologues
comme Herzberg
ou des instituts de
recherche appli-
quée comme le
Tavistock Institute,
le Work Research
Institute ou encore Savall et son
équipe de l’ISEOR.
Par ailleurs, l’entreprise libérée ne
fait nalement que remettre au goût
du jour des pratiques déjà connues:
l’autogestion et les équipes auto-
nomes, l’empowerment, le concept
de pyramide inversée, le servant lea-
dership… Mieux encore, des modes
de gouvernance fondés sur une phi-
losophie similaire ont été modélisés
de manière beaucoup plus précise.
D’abord la sociocratie, créée par le
dirigeant d’entreprise hollandais
Endenburg au début des années
1970, puis plus récemment, l’hola-
cratie, expérimentée par l’Américain
Robertson en 2001, au sein de son
entreprise de production de logiciels,
puis développée en tant que tech-
nologie sociale des organisations.
L’expression-même «entreprise libé-
rée» apparaît dès 1993 comme titre
français de l’ouvrage de Tom Peters
Liberation Management et passe
pourtant inaperçue…
Heureuse synchronicité
Alors pourquoi cet engouement,
dont on peut dater l’émergence sou-
daine à l’année 2012? Si on ne peut
nier l’habileté de la campagne de
communication dont elle fait l’objet,
les raisons du succès de l’entreprise
libérée se trouvent sans doute davan-
tage dans une heureuse synchroni-
cité. Un ensemble d’idées pertinentes
(à défaut d’être originales) regroupées
dans une expression idoine entre en
résonance avec un terrain d’attentes
sociales prêt à les recevoir. En tant
que symptôme fabriqué par notre
société, le phénomène «entreprise
libérée» relèverait, selon Casalegno,
d’un effet cathartique, exprimant le
désir urgent et intense d’une nouvelle
façon d’être au travail. Il a fallu la
médiatisation de la vague de suicides
chez France Telecom (2008-2009), la
réglementation sur le stress (2009),
puis le harcèlement (2011), pour que
notre société prenne acte des effets
nocifs de certaines pratiques mana-
gériales sur la santé. De nombreux
auteurs ont condamné des modes
d’organisation et de management
fondés sur des logiques exclusivement
gestionnaires. Si de Gaulejac évoquait
dès 2005 une «société malade de la
gestion», Dujarier (2015) dénonçait
récemment un «management désin-
carné» fait de «rapports sociaux
sans relation», générés par des dis-
positifs impersonnels déconnectés
du terrain. S’insurgeant contre ces
modes d’organisation qui le traitent
comme un objet, l’individu cherche à
se réapproprier son travail. Le concept
d’entreprise libérée coïncide avec ce
besoin d’affranchissement et propose
un mode d’organisation qui restaure
l’homme en tant que sujet libre.
À l’heure où il convient d’être
acteur de sa propre vie, l’entreprise
libérée se présente aussi comme un
modèle d’organisation affranchi de
toutes les règles et contraintes empê-
chant la réalisation de soi. Mieux,
depuis le documentaire diffusé sur
Arte de Meissonnier en 2015, l’entre-
prise libérée, c’est la garantie du bon-
heur au travail. Car nos contemporains
n’attendent plus seulement du travail
de ne plus souffrir, ni même un relatif
bien-être, ils en exigent le bonheur…
Bref, comme le résume avec humour
Casalegno «l’entreprise libérée» est un
mot-valise: il permet d’y mettre beau-
coup de choses et de partir en voyage.
Des réponses concrètes
à des enjeux réels
Au-delà des possibilités de rêve,
l’entreprise libérée propose aussi des
réponses concrètes à des enjeux non
moins réels. Face aux mutations d’un
environnement souvent qualié de
«VUCA» (pour «volatilité, incertitude,
complexité, ambiguïté»), les entre-
prises doivent s’adapter et rechercher
des alternatives organisationnelles de
nature à promouvoir le trio gagnant
agilité-innovation-engagement des
salariés.
Or, l’entreprise libérée semble répon-
dre aux trois. Dégagée des contraintes
de reporting et de contrôle, comme des
procédures non créatrices de valeur,
elle permet une meilleure réactivité
grâce à des décisions prises au plus
près du terrain. Grâce à la conance
qu’on leur accorde, les salariés se
sentent responsables de leur travail,
y retrouvent du sens et sont dispo-
sés à trouver leurs propres solutions
aux problèmes rencontrés. Mieux, ils
sont encouragés à la prise d’initia-
tive et à la formulation de nouvelles
idées, dans un contexte d’échanges
favorables à l’émergence de l’intel-
ligence collective. À la fois respectés
pour leurs compétences, considérés
en tant qu’individus et inspirés par
une vision qui a du sens, les salariés
mobilisent leur plein potentiel. L’en-
treprise libérée semble avoir trouvé le
cercle vertueux de l’engagement, tant
recherché par les DRH, mais aussi la
réponse à l’équation exprimée dans
l’Accord national interprofessionnel
sur la qualité de vie au travail (2013):
L’entreprise libérée
semble avoir
trouvé le cercle
vertueux
de l’engagement

n° 163 > avril 2017 > 37
comment conjuguer performance
économique et bien-être des salariés
par un contrat social renouvelé?
L’entreprise libérée
en questions
S’il suscite chez certains un
enthousiasme béat, le concept d’en-
treprise libérée a également déclen-
ché une vague de questions et de
réserves, allant parfois jusqu’à des
critiques acerbes, voire des condam-
nations sans appel. Un des principaux
reproches de ses détracteurs est que
le concept fait croire à une organisa-
tion idéale, du fait d’une insufsante
mise en lumière de ses inconvénients,
pourtant inhérents à toute organisa-
tion du travail. En effet, à l’image du
titre évocateur de l’ouvrage de Zobrist
(2014), La Belle Histoire de FAVI: l’en-
treprise qui croit que l’homme est
bon, le storytelling prend parfois des
allures de roman à l’eau de rose. On ne
nous parle pas –ou peu– du revers de
la médaille, des dérives, des dysfonc-
tionnements, des échecs…
Le côté obscur de la Force
En institutionnalisant l’autoges-
tion, l’entreprise libérée n’a pas seu-
lement fait disparaître des activités
inutiles et des pratiques toxiques de
petits chefs autocratiques. Elle s’est
également coupée de la valeur ajou-
tée de certains rôles managériaux
exercés précédemment par l’encadre-
ment. Certains de ces rôles peuvent
être parfaitement intégrés par les
collectifs de travail dans une forme
de leadership partagé ou distribué,
tel qu’il a été théorisé par Luc (2010),
Thévenet et Arnaud (2012) et Denis,
Langley et Sergi (2012). Mais parfois,
ces rôles ne sont plus assurés, entraî-
nant alors des impacts négatifs sur
la performance et le bien-être des
salariés.
Ainsi, l’abolition de tout contrôle
externe à l’équipe peut grever la qua-
lité, par des erreurs d’inattention, ou
le fait que certaines tâches considé-
rées comme rébarbatives sont laissées
de côté. De même, l’autogestion des
équipes peut se traduire par une allo-
cation non optimisée des ressources
ou une absence de priorisation des
tâches. Des décisions incohérentes
peuvent être prises par insufsance
de prise de hauteur.
Le rôle d’animation précédem-
ment exercé par les managers peut
également faire défaut. Dans le
meilleur des cas, le collectif de tra-
vail est suffisamment mature pour
mettre en place des processus d’au-
torégulation. À défaut, l’équipe peut
perdre en cohésion et devenir un ter-
rain favorable à des jeux de pouvoir,
des phénomènes de pression hori-
zontale, des conits interpersonnels
qui s’enveniment, des comportements
déviants non recadrés… L’absence de
responsable direct signie aussi pour
chaque salarié de ne plus disposer
d’un interlocuteur référent qui repré-
sente l’entreprise et qui puisse jouer
les rôles bénéques d’un management
personnalisé : donner du feedback et
des signes de reconnaissance, aider à
gérer ses priorités au quotidien, pilo-
ter son évolution de carrière…
Par ailleurs, le principe-même
de responsabilisation, à la base de la
forme organisationnelle libérée, com-
porte lui aussi des risques de dérives
avec son lot de dysfonctionnements.
Ainsi, le «tout le monde est respon-
sable de tout» peut se transformer en
«personne n’est responsable de rien».
La disparition d’un interlocuteur
unique représentant chaque unité de
travail peut rendre la collaboration
interservices beaucoup plus compli-
quée, de même que la simple diffusion
d’information. D’un autre côté, dans
quelle mesure est-on réellement prêt
à laisser les salariés prendre des déci-
sions qui pourraient porter atteinte
à la performance, voire mettre l’en-
treprise en péril? Soit la liberté est
totale, soit les périmètres de décision
sont clairement délimités. Sinon les
salariés peuvent se retrouver face à
des injonctions paradoxales du type
«tu es libre de prendre toute décision,
mais là c’est moi qui décide».
Les technologies sociales comme
la sociocratie et l’holacratie proposent
des processus très précis pour limi-
ter ces risques. L’entreprise libérée,
qui se définit comme une philoso-
phie, laisse beaucoup d’ouverture, et
donc potentiellement un flou pro-
pice à ces dérives. Il faut du temps
pour reconnaître ses propres erreurs,
se réajuster et trouver les dispositifs
permettant d’enrayer les dysfonction-
nements. Ainsi, une éventuelle corré-
lation positive entre l’adoption d’une
forme organisa-
tionnelle libérée
et la performance
et l’innovation ne
peut raisonnable-
ment s’établir que
sur la durée. Si cer-
taines entreprises
comme Gore ou
FAVI bénéficient
effectivement de plusieurs décennies
d’expérience, que penser des résultats
de celles qui se réclament «libérées»
depuis quelques années seulement?
L’entreprise du bonheur
au travail ?
Certaines critiques remettent
également en cause les effets néces-
sairement positifs sur le bien-être au
travail. Une chose est claire: l’entre-
prise libérée n’est pas faite pour les
managers accordant de l’importance
aux signes de statut et à leur évolution
de carrière. La plupart des histoires
officielles de libération s’accompa-
gnent de cas de départs d’encadrants
attachés à leur pouvoir et ne parve-
nant pas à mettre de côté leurs ambi-
tions égotiques. D’autres versions plus
ofcieuses font état d’ex-managers
confrontés à des doubles contraintes,
pris en étau entre des principes phi-
losophiques et des réalités de terrain
inniment plus complexes.
> Il faut libérer l
’
entreprise libérée
L’équipe peut
perdre en
cohésion et
devenir un terrain
favorable à des
jeux de pouvoir
 6
6
 7
7
1
/
7
100%