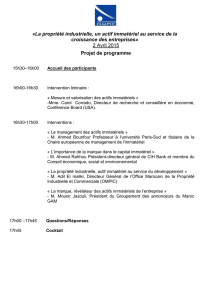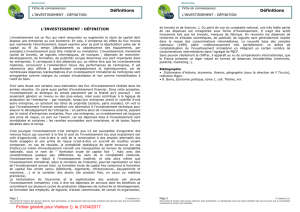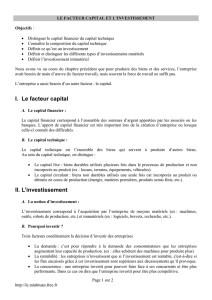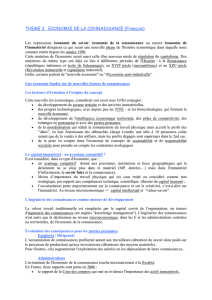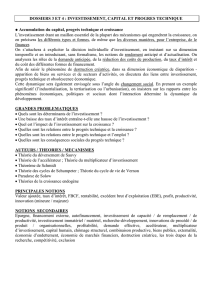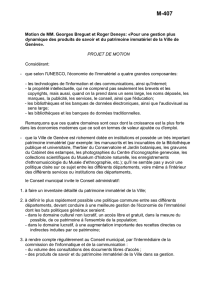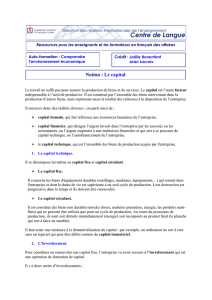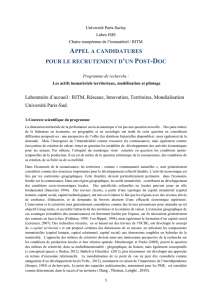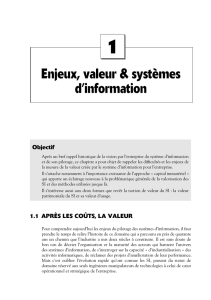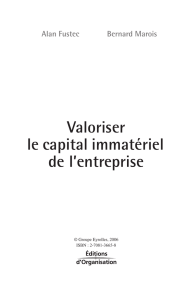L`économie de l`immatériel

L’économie de l’immatériel
’’
RAPPORT DE LA COMMISSION
SUR L’ÉCONOMIE DE L’IMMATÉRIEL
La croissance de demain
Il est une richesse inépuisable,
source de croissance et de prospérité :
le talent et l’ardeur des femmes et des hommes
’’
Maurice Lévy Jean-Pierre Jouyet
Le Ministre de l ’Économie,
des Finances et de l ’Industrie
[lettre du ministre aux futurs rapporteurs ndlc]
Paris, le 16 mars 2006
Monsieur le Président,
Vous avez accepté de présider, en liaison avec M. Jean-Pierre Jouyet, Chef du Service de
l’Inspection générale des
finances, la Commission que j’ai constituée pour réfléchir sur l’économie de l’immatériel. Je
souhaite que vous étudiez, avec
les commissaires que j’ai désignés à cette fin, les caractéristiques de l’émergence d’une économie
fondée sur la croissance
des actifs immatériels ainsi que l’impact que cette évolution peut avoir sur notre société et son
potentiel de développement.
Cette Commission devra en particulier examiner trois questions essentielles :
–Concurrence, monopole et rente dans l’économie de l’immatériel : dans un environnement
marqué parl’importance croissante de la création industrielle,
intellectuelle et artistique, il est primordial de soutenir l’effort de création,
de recherche et d’innovation dans notre pays.
Ceci suppose que l’ensemble de l’économie bénéficie de cette nouvelle source
de valeur et que le créateur soit rétribué de manière juste et équitable.
Dans cette perspective, il est important d’apprécier les conditions de concurrence,
de monopole et de rente liées à la création,
afin de s’assurer qu’elles correspondent à un
optimum économique et social.
- Création de valeur et circuits de financement :
le développement de l’économie de l’immatériel se traduit par une plus grande diversité
des modalités de création de valeur et de richesses par les entreprises. Alors que les milieux
de l’analyse financière ont affiné les concepts utilisés pour mesurer et comparer cette capacité de
création de valeur, il convient d’envisager comment notre système de prélèvements
peut l’appréhender de manière plus objective tant au niveau de
l’assiette que du mode d’imposition.
–Contours et valorisation du patrimoine public immatériel :
comme les autres acteurs économiques, l’État
détient des actifs.
L’État est peut-être plus riche encore que d’autres en actifs immatériels :
il est détenteur de licences, de brevets, de fréquences mais aussi de bases d’informations

économiques
et de savoir-faire reconnus. Or, l’État ne dispose à
ce jour ni de mécanismes ni d’une politique destinés à évaluer
et à valoriser ces actifs alors que nos partenaires ont engagé
la refonte de leur modes de gestion de leurs actifs, en particulier immatériels.
Des éléments de cadrage plus détaillés de ces réflexions sont joints en annexe. La
Commission pourra s’appuyer
autant que nécessaire sur les services du ministère et au premier chef de l’Inspection générale des
finances.
Vous voudrez bien me rendre un rapport d’étape avant le 30 juin. Les résultats définitifs des
travaux de la
Commission devront me parvenir d’ici le 30 septembre 2006.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.
Avec mes remerciements.
Thierry BRETON
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Monsieur Maurice LÉVY
Président
Groupe Publicis
Paris, le 23 novembre 2006
Monsieur le Ministre,
Vous trouverez ci-joint le rapport de la Commission sur l’économie de l’immatériel.
Nous tenons à vous exprimer
à nouveau notre reconnaissance pour la confiance que vous nous avez témoignée
en nous chargeant de cette mission.
Notrecollaboration a été réelle, profonde, et constante.
Nous voulons y voir un exemple de partenariat entre le secteur public et
le secteur privé, qui sont les deux sources indissociables de la richesse de la nation.
Nous avons commencé notre mission par la recherche d’exemples, de travaux ou de
réflexions similaires à
l’étranger, et force est de constater que rien de semblable ni d’aussi complet n’a été réalisé à ce jour.
Votre initiative est donc originale et unique, et la mission confiée à la Commission n’avait pas de
précédent.
Vous nous avez chargés d’être des
précurseurs, ce qui nous a conduits à inventer, à innover, et à apporter, à des problèmes nouveaux,
des solutions nouvelles.
L’économie de l’immatériel est une économie en formation, une économie de la
connaissance, systémique et
fonctionnant en réseau, une économie qui se joue des espaces et du temps, ce qui nous a amenés à
nous aventurer sur des
terrains que nous n’avions initialement pas prévu d’aborder. Vous trouverez donc dans le rapport de
la Commission des ana-
lyses et des recommandations sur la recherche, la formation, l’université, mais aussi sur les
réglementations économiques,
fiscales ou sociales qui peuvent être, pour l’immatériel, autant de freins ou d’accélérateurs.
Nous sommes arrivés à la conclusion que cette économie recèle un potentiel de croissance
considérable,
capable d’irriguer toute l’économie française et susceptible de générer des centaines de milliers

d’emplois, comme d’en préser-
ver d’autres qui seraient, autrement, détruits ou délocalisés. Ce sont ces objectifs qui inspirent les
recommandations que nous
avons formulées : il nous a fallu imaginer des solutions pour lever les freins et les rigidités qui font
patiner notre économie,
et imaginer des recommandations qui créent du dynamisme, qui insufflent de l’énergie et qui créent
de l’initiative, de la
croissance et des emplois.
Nous ne prétendons pas avoir couvert tous les champs d’une question qui se révélait de
plus en plus vaste à
mesure que progressait notre réflexion. Faute de temps, nous n’avons pas épuisé le sujet, ni travaillé
autant qu’il aurait fallu
sur certaines recommandations.
Il reste que le rapport que nous avons l’honneur de vous remettre est le résultat d’un travail
assidu, sérieux,
obstiné, qui nous a réunis treize fois en séance plénière, et qui a été l’occasion de plusieurs dizaines
d’échanges. Nous disons
notre gratitude aux membres de la Commission pour leur disponibilité, leur inventivité et la grande
passion montrée pour
l’intérêt de notre pays.. Et nous remercions les jeunes rapporteurs de l’Inspection générale des
finances pour la qualité de
leur travail, et pour l’intelligence avec laquelle ils ont mené leurs investigations tout en prenant
scrupuleusement en compte
les attentes de la Commission.
Nous espérons que ce rapport servira à penser et créer la croissance de demain, à puiser
dans cette richesse
infinie que sont les hommes et les femmes de notre pays pour leur offrir l’avenir dont ils sont
dignes, et à oser s’attaquer à
ces rigidités qui freinent le dynamisme latent de notre pays.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute
considération.
Maurice LÉVY Jean-Pierre JOUYET
COMMISSION SUR L’ÉCONOMIE DE L’IMMATÉRIEL
Maurice Lévy Président du directoire du Groupe Publicis
Jean-Pierre Jouyet Chef du Service de l’Inspection générale des finances
Elie Cohen Professeur d’économie, membre du CAE
Laurent Cohen-Tanugi Avocat, membre de l’académie des technologies
Jean-Pierre Denis PDG d’OSEO
Bruno Gibert Avocat, Francis Lefebvre
Laurent Heynemann Réalisateur, ancien Président de la SACD
Danièle Lajoumard Inspecteur général des finances
Philippe Lemoine Président de LaSer
Jean-Luc Lépine Inspecteur général des finances
Alain Lévy Président d’EMI
Elisabeth Lulin PDG de Paradigmes
Pascal Nègre Président d’Universal Music France
Anne-Sophie Pastel Fondatrice et Présidente d’AuFéminin.com
Joël de Rosnay Conseiller du Président de la Cité des sciences
Geoffroy Roux de Bézieux Président de Croissance Plus

Claude Rubinowicz Inspecteur général des Finances
Henri Serres Vice-Président du Conseil général des technologies de l’information
Ezra Suleiman Professeur à Princeton et à l’Institut d’Études politiques de Paris
Marc Tessier Directeur général du Pôle Netgem – Médias services
Peter Zangl DG Adjoint Société de l’information à la Commission européenne
Pierre Cunéo Inspecteur des finances
Maxime Baffert Inspecteur des finances
Arnaud Geslin Inspecteur des finances
Sébastien Proto Inspecteur des finances
Paul Bernard Groupe Publicis
Agnès Audier, Ingénieur des mines, a également participé aux travaux de la Commission et y a
apporté descontributions thématiques.
RÉSUMÉ [du rapport ndlc]
1. L’ÉCONOMIE A CHANGÉ MAIS LA FRANCE N’EN TIRE PAS
TOUTES LES CONSÉQUENCES
L’immatériel est aujourd’hui le facteur clé de succès des économies
développées
L’économie a changé. En quelques années,
une nouvelle composante s’est imposée comme un moteur détermi-
nant de la croissance des économies : l’immatériel.
Durant les Trente Glorieuses, le succès économique reposait
essentiellement sur la richesse en matières premières, sur les industries manufacturières
et sur le volume de capi-
tal matériel dont disposait chaque nation.
Cela reste vrai, naturellement. Mais de moins en moins. Aujourd’hui, la
véritable richesse n’est pas concrète, elle est abstraite.
Elle n’est pas matérielle, elle est immatérielle. C’est désor-
mais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est devenue l’avantage
compétitif essentiel.
Au capital matériel a succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital
immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir.
En fait, la vraie richesse
d’un pays, ce sont ses hommes et ses femmes.
Qu’on en juge.
Il y a trente ans, être un leader de l’industrie automobile, c’était avant tout s’imposer par des cri-
I
tères techniques, par exemple les caractéristiques de la cylindrée. Aujourd’hui, c’est la marque, le
concept, le service après-vente ou le degré de technologie intégrée dans les véhicules
qui font, dans ce secteur, la réussite
industrielle. L’organisation du travail fait l’objet d’une nouvelle division internationale : la
production se déplace
dans les pays à bas coûts de main-d’œuvre et les pays développés se spécialisent dans les
technologies de pointe,
la construction de l’offre commerciale, la création du concept ou la maîtrise du design. Tous les
secteurs indus-

triels, des semi-conducteurs au textile, des logiciels aux télécommunications, font désormais de
l’immatériel la clé
de leur avenir. La valeur des entreprises repose de plus en plus sur des éléments immatériels,
parfois quantifiables, parfois moins,
par exemple la valeur de leur portefeuille de brevets et de leurs marques ou la capacité
créative de leurs équipes.
Pour comprendre ce mouvement, il faut revenir sur trois ruptures
qui marquent l’économie mondiale depuis plus
de vingt ans. D’une part, la place croissante de l’innovation,
qui est devenue le principal moteur des économies
développées. Jusqu’aux années 70, on pouvait se contenter
d’imiter ce que trouvaient les États-Unis. Aujourd’hui,
la France n’a, comme les autres, pas d’autre choix que de trouver
ce qui n’a pas encore été découvert. D’autre
part, le développement massif des technologies de l’information et de la communication,
ouvre aux entreprises
des possibilités considérables de réorganisation de leur production
et de recentrage sur les activités à plus forte
valeur ajoutée. Enfin, la tertiarisation continue des pays développés,
qui reposent de plus en plus sur des écono-
mies de services, dans lesquelles les idées, les marques et les concepts jouent un rôle essentiel.
En toile de fond,
deux autres tendances lourdes des économies développées –
la mondialisation et la financiarisation – facilitent le
recentrage des entreprises sur les activités les plus créatrices de valeur,
c’est-à-dire les activités immatérielles.
Ces trois évolutions concernent l’ensemble des économies développées.
Dans chacune d’entre elles, les secteurs
spécialisés dans les biens et services à caractère immatériel
ont un poids économique en constante augmentation.
En France, ils représenteraient, au sens large, environ 20 % de la valeur ajoutée
et 15 % de l’emploi. Mais
au-delà de ces secteurs, c’est toute la valeur créée par l’économie française
qui se dématérialise chaque jour un
peu plus. Dans toutes les entreprises, quels que soient le produit ou le service vendus,
la création de valeur se
fonde de plus en plus sur des actifs immatériels.
Faute de prendre la mesure de ce changement et d’en tirer
les conséquences, la France aborde ce défi de l’immatériel fragilisée
Dans cette économie de l’immatériel,
le succès ira aux économies qui se montreront les plus capables d’attirer et
de valoriser les talents, c’est-à-dire concrètement de se doter du meilleur potentiel
de formation et de recherche
et de favoriser le plus largement possible l’innovation, dans la sphère privée
comme dans la sphère publique.
Il n’est pas étonnant que, dans les appréciations mondiales de la compétitivité de la France,
la perception l’em-
porte sur la réalité et, souvent, s’y substitue :
l’idée que l’on se fait des choses est souvent plus importante que la
chose elle-même. Dans ce contexte, les entreprises ont, pour beaucoup,
bien compris le rôle de l’innovation, de
la connaissance, de la marque, des images, et le capital intangible qu’elles représentent.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
1
/
233
100%