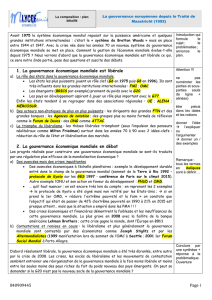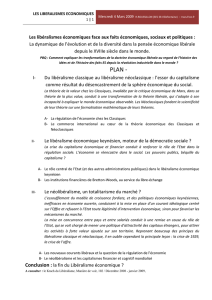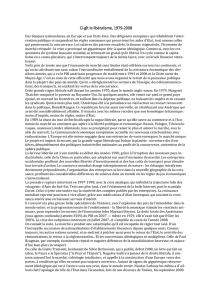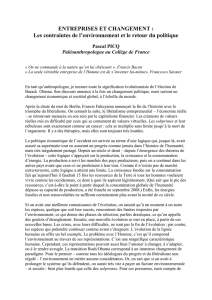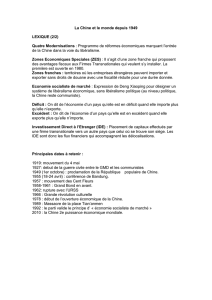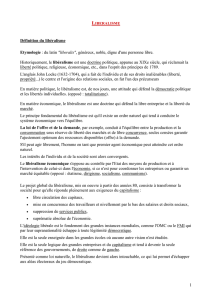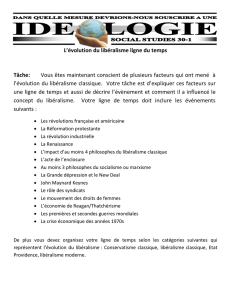Le développement durable : une utopie nécessaire

1
Majeure Alternative Management
Mémoire de recherche
Sous la direction de Pierre-Yves Gomez, professeur à l‟EM Lyon et directeur de l‟Institut
Français de Gouvernement des Entreprises (IFGE)
Le développement durable :
une utopie nécessaire ?
Libéralisme et développement durable
Yann Auger
Septembre 2009
Ce mémoire est imprimé sur du papier 100% recyclé

2
« L‟écologie est subversive car elle met en question l‟imaginaire capitaliste qui
domine la planète. Elle en récuse le motif central selon lequel notre destin est
d‟augmenter sans cesse la production et la consommation. Elle montre l‟impact
catastrophique de la logique capitaliste sur l‟environnement naturel et sur la vie
des êtres humains. Cette logique est absurde en elle-même et conduit à une
impossibilité physique à l‟échelle de la planète puisqu‟elle aboutit à détruire ses
propres présuppositions. »
Cornelius Castoriadis (2005: 237)
« Nous détruisons la beauté des campagnes parce que les splendeurs de la nature,
n‟étant la propriété de personne, n‟ont aucune valeur économique. Nous serions
capables d‟éteindre le soleil et les étoiles parce qu‟ils ne rapportent aucune
dividende. »
John Maynard Keynes (In Maris, 2003 : 95)
« L‟opposition entre deux visions différentes de l‟écologie marque un clivage
fondamental à l‟égard de la société et de l‟homme. La vision positive et
humaniste que je défends est celle d‟une société de liberté, de libre entreprise et
de progrès constant, pas de celle d‟une réglementation pesante et d‟un Etat
omniprésent décidant à la place du citoyen. C‟est surtout celle d‟une vision
optimiste de l‟homme qui sait s‟adapter à son environnement constamment
changeant, et dont le ressort du progrès est dans l‟innovation et l‟optimisme et
non la punition et la peur. »
Claude Allègre
« Un des signes les plus nets du déclin de l‟intelligence critique est l‟incapacité
d‟un nombre croissant de contemporains à imaginer une figure de l‟avenir qui soit
autre chose que la simple amplification du présent. »
Jean-Claude Michéa (2006 : 87)
« Le monde n‟est pas une nursery. »
Sigmund Freud (1989 : 221)

3
SOMMAIRE
I. Démarche de recherche ........................................................................................................ 7
1. Question de recherche ......................................................................................................... 7
2. Hypothèse a priori ............................................................................................................... 7
3. Méthodologie ...................................................................................................................... 8
II. Section théorique : le développement durable aujourd’hui, une notion liberale ? ..... 10
Prolégomènes : qu’est-ce que le développement durable ? ..................................................... 10
1. Eléments de philosophie libérale ...................................................................................... 16
A. La liberté dans la pensée libérale .......................................................................... 16
Les fondements théoriques de la liberté individuelle ............................................ 16
Le gouvernement des libertés ................................................................................ 18
Le rôle de la propriété, du travail, et de l’entrepreneur ....................................... 19
Les garde-fous de la liberté : marché et démocratie ............................................. 21
B. L‟idéal de neutralité : la technologie comme idéologie politique ......................... 23
L’indispensable neutralité ..................................................................................... 23
Les technologies du libéralisme (1) : la démocratie ............................................. 25
Les technologies du libéralisme (2) : le marché .................................................... 27
Le paradoxe de la neutralité .................................................................................. 31
C. Une relation particulière à la nature et à la science ............................................... 34
La propriété : l’accaparement dans un monde d’abondance ................................ 34
L’économie politique et la nature : une déconnexion progressive ........................ 36
Rationalisation de la nature et physique sociale ................................................... 37
D. La justification morale du libéralisme ................................................................... 39
Les fondements du progressisme libéral ............................................................... 40
Le libéralisme, doctrine sociale ............................................................................. 42
Conséquentialisme et détour de production .......................................................... 44

4
2. Le développement durable, continuité du libéralisme ...................................................... 47
A. Concilier liberté et protection de l‟environnement ? .............................................. 47
De la gouvernementalité environnementale .......................................................... 48
L’économie de l’environnement, ou comment orienter les libertés
individuelles vers la métamorphose durable ................................................................ 49
Démocratie participative et parties prenantes ...................................................... 52
B. Morale individuelle, neutralité collective ? ............................................................ 55
Le marché du développement durable et l’harmonie des intérêts ......................... 55
L’individu responsable et ses paradoxes ............................................................... 60
Le rejet de toute définition collective d’une norme du suffisant ............................ 71
C. De la domination complète de la nature à la foi aveugle dans la science ............... 74
Prise en compte de la rareté et rationalisation de la nature ................................. 74
Le scientisme, seule issue du développement durable, car seule issue du
libéralisme .................................................................................................................... 79
D. Le grand récit du développement durable et ses incohérences ............................... 82
La métamorphose durable, continuation du libéralisme ....................................... 82
Les contradictions de la métamorphose durable ................................................... 87
III. Section empirique : synthèse de l’enquête menée ......................................................... 98
1. Profil des répondants ......................................................................................................... 98
2. Analyse des résultats ......................................................................................................... 99
A. Analyses descriptives ............................................................................................. 99
Le développement durable, entre réglementation et initiatives spontanées .......... 99
Le développement durable est-il « moralisateur » ? .......................................... 106
Une vision particulière de la nature .................................................................... 107
Optimisme, croissance et technologie ................................................................. 110
B. Analyse statistique ................................................................................................ 117
Analyse des corrélations ...................................................................................... 117
Factorisation ....................................................................................................... 120

5
C. Les limites de l‟étude ............................................................................................ 126
IV. Conclusion ...................................................................................................................... 127
Annexes.. ............................................................................................................................... 130
1 – Questionnaire ................................................................................................. 130
2 – Matrice des corrélations ................................................................................. 133
Bibliographie ......................................................................................................................... 137
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
1
/
142
100%