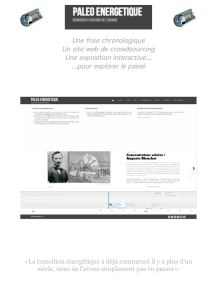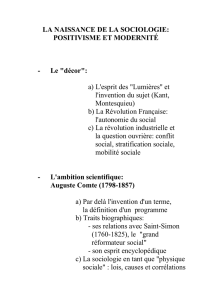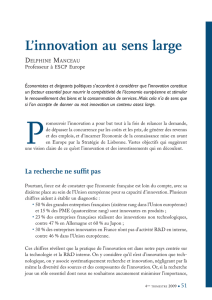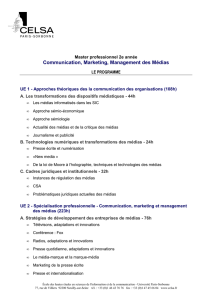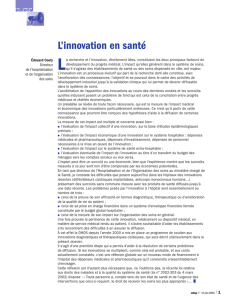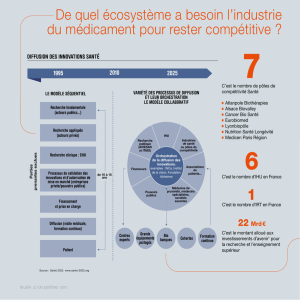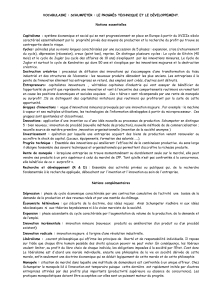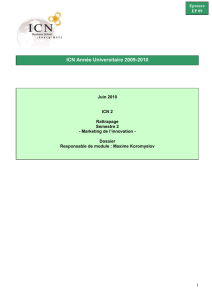Dynamique sociale et innovation

La construction des innovations
et la dynamique sociale.
I. Qu’est que l’innovation.
L’innovation n’est pas forcément liée à la
technique. Dans sa définition la plus large,
c’est l’action d’innover c’est-à-dire introduire
quelque chose de nouveau dans une autre
chose établie. Ce mot s’apparente à nouveau-
t é, découverte, création, invention.
Les sociologues définisent l’innovation
comme une transformation qui va résulter
d’un individu ou plusieurs et qui affecte selon
le cas l’économie, la société, la culture ou la
politique. L’innovation est un «phénomène
social total» (Mauss). Elle a donc bien s a
place dans la dynamique sociale.
En sociologie, on ne parle d’innovation que
lorsqu’elle est socialement acceptée, donc
s u s c e p t i b l e d ’ ê t r e diffusée et imitée. On
parle de simple amélioration à la véritable
m u t a t i o n . Le propre de l’innovation c’est
qu’elle vient boulverser les situations
acquises; c’est ce qui intéresse les sociologues.
L’innovation participe à la promotion d’autres
acteurs qui aboutit à un certain nombre de
contraintes (rapports aux valeurs, rentabilité, etc.).
La capacité d’assimiler une innovation ne va
pas de soi. Son introduction doit être com-
patible avec la distribution des pouv o i r s .
Soc. 201a
1. La production de l’innovation.
Il existe plusieurs niveaux : source off i c i e l l e
(résultat de l’analyse des pratiques sociales)
et source non-officielle (plus diffuse, provient
des pratiques sociales elles-mêmes et échap-
pe donc à tout contrôle social; c’est une
i n n o v a t ion spontanée et autonome,
subversive). Selon les objectifs, on freine ou
accélère l’innovation.
Tantôt les innovations se superposent
(e ffets cummulés), tantôt elles vont s’impo-
s e r et de ce fait elle risque de contredire un
fonctionnement habituel.
Cette innovation doit être légitimée, elle re p o-
se sur son éfficacité mais également sur
leur «employabilité». Il y a deux types de
l é g i t i m i t é s : d’une façon externe car elle
p e r met d’obtenir des résultats. Légitimité
i n t e r ne, si elle est capable de structurer un
g r oupe social (univers de lois et de
r è g l e s ) .
Il y a aussi deux types d’innovations : celle
portée par des innovateurs qui n’en font pas
usage et d’autre, inventeurs/utilisateurs.
2. Sociologie des usages sociaux des innovations.
L’individu analyse les propriétés de l’objet
en fonction des usages et avantages qu’il peut
en tire r . On parle alors de propriété sociale de
l’objet.
La validité des innovations est liée au succès
de leur application, nécéssité donc d’une per-
tinence sociale.
II. Caractéristique de l’innovation.
Page 9

III. L’innovation et le progrès.
Innover c’est intro d u i r e du changement qui
implique une modification des régles for-
melles. Mais cela implique que les individus
doivent s’adapter, ou peuvent s’y opposer et
p ro d u i re de nouvelles règles concurre n t e s .
Pour faire face à cette production le gro u p e
doit investir dans un plus grand contrôle social.
Lorsqu’une innovation est introduite, ces boul-
versements peuvent pro d u i r e des change-
ments. L’organisation va donc se préparer à
l ’ i n t roduction de l’innovation (form a t i o n s ,
reconversions, re c r u t e m e n t s , e t c . ) .
La régulation se décrit comme un compro m i s ,
définie par les limites de la négociation par les
régles imposées et acceptées.
L’innovation redéfinit les régles du jeu, modifie
les règles formelles mais aussi celles infor-
melles (ou clandestines). Cela pose le pro b l è-
me de l’efficience des règles et boulverse
l ’ o r d r e établit. L’innovation s’introduit dans
l ’ é q u i l i b r e précaire des logiques en présence.
Cela s’accompagne de négociation pour mettre
en place les anciennes règles ou de nouvelles;
c’est l’ensemble de mise en cohére n c e . .
Soc. 201a
Page 10
Tarde explique l’évolution sociale par la
combinaison de l’invention et de l’imitation.
Le changement social résulte d’inventions,
d’imitations, et d’adaptations. Les inventions
se succèdent à partir «d’inventions mère» par
p rogrès de substitution et par accumulation
d ’ i n v e n t i o n s .
Tarde explique qu’il existe deux type d’in-
ventions : besoin et désir d’innovation. Il
s’agit soit de répondre à des questions
posées (ces besoins d’inventions justifient
un progrès nécessaire), soit un besoin de
luxe, un progrès superf l u .
Schumpeter et la théorie de l’évolution
économique : le développement écono-
mique résulte de l’introduction de pro d u i t s
nouveaux, de méthodes de production nou-
velle, ou de matière pre m i è re inédite. C’est
l’invention qui crée le dynamisme écono-
mique et le profit.
La sociologie des sciences : elle s’intére s-
se à l’innovation dans le sens de la génèse
et de la diffusion des innovations.
Boudon a un mot assassin :les véritables
innovateurs ne sont pas ceux qui répondent
e fficacement aux questions que tout le
monde se pose, mais ceux qui savent poser
des questions nouvelles.
Les travaux de la sociologie des sciences
m o n t rent qu’il n’y a pas d’innovation en soi,
il n’ y a innovation qu’au regard d’un état
initial. Le système technique et le social ont
des rapports étroits, des interdépendances.
L’innovation représente toujours un enjeu.
Gille Berthand : “les techniques forment sys-
tème”. La machine transforme le monde du
travail mais par contrecoup elle transform e
aussi la position sociale de ceux qui l’utilise.
L’innovation technique n’est pas neutre, elle
i n t roduit des déséquilibres et pousse à la
re c h e rche de nouvelles cohérences. La
sociologie de l’innovation s’intéresse au
contexte qui préside à l’émergence des
innovations et aux processus de sa mise au
point. Cette sociologie est aussi celle du
changement social mais surtout celle de la
régulation sociale.
IV. L’innovation et la régulation sociale.

Soc. 201a
Page 11
On va créer des besoins et des stratégies
pour succiter de l’intérêt. Les grands acteurs
p r oduisent ces besoins. Ils vont contrôler assez
bien les marchés économiques qui créent mais
pas les conséquences sociales que l’innovation
i n d u i t .
Les inventeurs anticipent sur l’utilisation des
inventions des appareils. Ils parient sur les capa-
cités à les assimiler. Les inventeurs élaborent de
nouvelles pratiques sociales. Les innovations
mettent en cause les habitudes et pratiques aux
changements dans le domaine de la culture .
L’innovation est d’abord portée par une
conduite de distinction, puis elle se pro p a g e
en chaîne pour toucher la majorité de la popu-
lation, donc se banalise. L’invention devient
commune et plus novatrice. Sa possession
peut alors devenir le signe d’une nouvelle
distinction.
L’innovation modifie aussi le rapport au
temps (sociologie de la technique). Les tech-
niques entrent dans le domaine domestique
et impose un nouveau rapport au temps.
Autres effets : son introduction induit la
redéfinition des rôles de chacun. Les nou-
velles techniques sont porteuses de mouve-
ments qui modélent la société future. Les
innovations techniques sont en quelque sorte
des gènes d’innovations sociales.
V. Innovation et dynamique sociale (construction de pratiques sociales).
1
/
3
100%