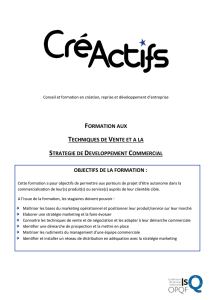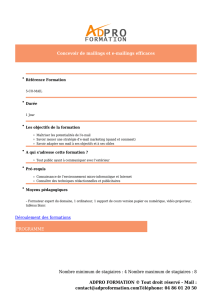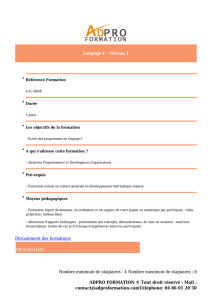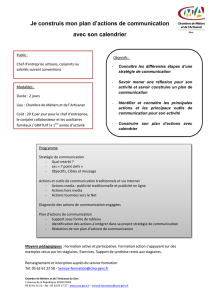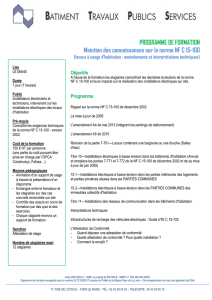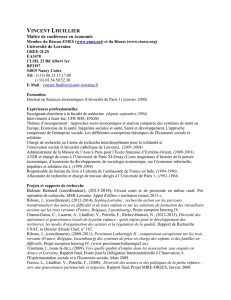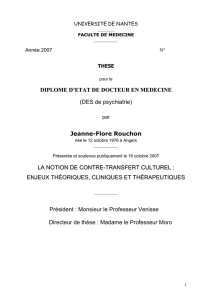Penser le cadre formatif de l`étude terrain du DEIS

Penser le cadre formatif de l’étude terrain du DEIS1
Pierre-Alain GUYOT & Véronique BAYER
2010
La formation pratique référée au domaine de formation deux du DEIS (Diplôme d'État en
Ingénierie Sociale) se déroule sous la forme d’une étude de terrain conduite par un groupe de
stagiaires. Elle semble souvent se conduire en cours de formation et non parachever un
parcours (elle se déroule la plupart du temps dans la deuxième année de formation).
La possibilité de l’engager à plusieurs, en groupe, propose ainsi une mise en commun et elle
permet donc d’expérimenter une production collective. Elle allège en cela la responsabilité
individuelle du travail réalisé dans le cadre du mémoire.
Donnant lieu à la production d’un rapport collectif, elle présente, selon nous, de nombreux
mérites, occurrences et situations qui participent à définir ce que pourrait recouvrir
l’ingénierie sociale.
Un exercice qui interroge la question du travail
L’étude implique la constitution d’un groupe composé généralement de trois à cinq personnes
en formation. Ce groupe se constitue autour des différents terrains présentés par les centres de
formation. Plusieurs critères prévalent aux choix des personnes : le sujet, l’emplacement
géographique, la connaissance des personnes. Nous notons cependant que, si certains
stagiaires ont appris à se connaître dans le cadre de la formation qu’ils suivent ensemble
depuis un an, la plupart d’entre eux se découvrent et surtout n’ont aucune expérience de
travaux réalisés en groupe. En conséquence, l’un des enjeux de l’exercice est d’appréhender la
construction d’une production collective et de ce qui est mis en commun tant au plan des
opérations cognitives que du partage des rôles et encore des sous-bassement affectifs du
travailler ensemble.
Un référant pédagogique accompagne le groupe sans pour autant se positionner comme chef
de projet. Aussi, les stagiaires sont en situation de traiter les questions relatives à la division
du travail. Elle implique d’aborder la répartition des tâches, de repérer les compétences
individuelles et collectives mais aussi de traverser les tensions relatives aux rapports sociaux
entre les membres. Une analyse plus fine à partir de plusieurs observations permettrait sans
doute d’identifier les enjeux de cette division.
Mais la division du travail c’est aussi la source de la coopération : « la coopération ne va pas
sans la division du travail. Coopérer en effet, c’est se partager une tâche commune » (E.
Durkheim, 1858-1917).
Ce travail réalisé dans les groupes pose donc les conditions de la coopération. En effet, il est
réalisé avec d’autres, pour d’autres, il est subordonné à un but collectif, organisé, coordonné,
canalisé, géré… ainsi le travail implique toujours une confrontation au réel, au réel physique,
au réel des rapports sociaux (D. Lhuillier, 2006). En conséquence, il appartient aux référents
pédagogiques de mesurer ces dimensions, de les accompagner en permettant qu’ils soient
élaborés et traités au même titre que les aspects méthodologiques et théoriques relatifs au
sujet de l’étude. Produire cette étude pour les stagiaires, c’est aussi aborder ce que travailler
1 Ce texte est issu de l'ouvrage : Dubéchot P., Rivard Th., DEIS, Tout en un, Paris Vuibert, 2010.
1

veut dire. « Le travail comprend toujours une référence à l’autre comme destinataire, comme
coauteur, comme prescripteur. » (D. Lhuillier, 2006)
Un apprentissage de la coordination
« Il faut ici – nous le remarquons souvent – que les hommes s’unissent pour savoir et pour
comprendre, pour toucher au point du mouvement d’où part le savoir… Cette socialisation
intense, clairement cohérente, sûre de ses bases, ardente dans ses différenciations, voilà
encore un fait, un fait d’une singulière actualité. N’en pas tenir compte, c’est verser dans une
utopie gnoséologique, l’utopie de l’individualisme du savoir. » (G. Bachelard, 1953).
La question la plus apparente, la plus immédiate dans la perception succincte du déroulement
de l’étude est celle qui relève de la division du travail entre les personnes. Nous la désignons
ici comme ce qui relève de la coordination. Le "qui fait quoi, comment" reste à expliciter
entre les membres du groupe qui mènent l’étude. Il est possible de repérer quelques tâches
pour illustrer le propos : prendre des contacts téléphoniques pour faciliter l’avancée des
démarches (qui le fait, est-ce en groupe ou s’agit-il d’une ou de plusieurs personnes),
interroger et négocier la commande auprès du commanditaire, la préciser avec l’organisme de
formation ou son représentant, avec le guidant, prendre des notes, servir d’intermédiaire
auprès du même guidant, rédiger des synthèses intermédiaires en fonction de l’avancée du
travail, impulser une idée de méthode, réaliser une fiche de lecture brève sur une question
jugée centrale dans la commande, servir d’intermédiaire auprès du guidant ou de la
guidante… etc.
Il y a plus que cela, la répartition des tâches devrait tendre à être clarifiée entre les membres
du groupe et non pas relever des évidences convenues et surtout silencieuses. Cette remarque
relève d’un truisme qui demande en réalité du courage intellectuel et affectif. Il n’est guère
possible d’envisager une forme de guide de la répartition des tâches, sauf à tomber dans un
modèle de prescription que par ailleurs nous avons tendance à récuser pour la simple raison
qu’il ne peut ambitionner de circonscrire la totalité des tâches inédites et peut être innovantes
des opérations liées à l’approche des terrains d’étude.
A cet égard, on ne peut ignorer qu’il existe des tâches considérées comme nobles, d’autres qui
sont minorées ou disqualifiées. Il appartient au groupe, en présence de son guidant, de
comprendre ces angles morts du travail de l’étude, ces scotomes plus ou moins admis par
chacun ou identifiés plus ou moins confusément.
En revanche, une attitude dynamique, faite d’accords et de désaccords, de conflits de
connaissances (ou de représentations) mais aussi de prérogatives ou encore d’amour propre,
est ici indispensable et nous amène sur le second versant, celui que nous désignons ici comme
relevant de la coopération entre les membres du groupe étude terrain.
La seconde question liée à ce travail de groupe est celle qui aborde le travail non plus en
termes de compétences formelles, mais en termes de vie au travail, de choix altruiste délibéré,
libre de toute obligation contractuelle (N. Alter, 2009).
S’ajoutent à l’ensemble de ces questions les représentations que chacun se fait du travail de
l’autre ou des autres. Il y a peut-être les travaux valorisés pour les uns (côtoyer les
responsables par exemple) et les travaux moins intéressants ou répétitifs et considérés comme
subalternes (recopier un entretien, entrer des données factuelles dans des tableaux, etc.). Mais
2

à ces représentations s’ajoutent également des clivages dans les images de ce qui fait sens
pour soi au travail.
A cet égard nous avons côtoyé des situations où certains se sentaient jaugés sur un registre de
plaisir pris à tel ou tel aspect du travail… alors que d’autres participaient du travail de forçat,
ou encore de soutier, exécutant les tâches considérées comme mineures ou sans attraits. Le
clivage entre ceux taxés implicitement de théoriciens, supposés opposés aux praticiens, ou
aux "pratico-pratiques" (expression répétées ad nauseam dans certaines approches, désignant
qu’il y a du "vrai" ou de "l’efficace" ailleurs que dans la théorie par essence bavarde et
volatile) culmine dans les opérations où les "petites mains" sont sollicitées.
Pour résumer, le petit tableau qui suit reprend les arguments donnés :
Coordination ; Domaine socio-opératoire Coopération ; Domaine socio-affectif
On peut parler ici de fiche de poste,
d’échanges fonctionnels liés à la réalisation
d’une tâche, de fonctions au travail, de
réaliser de manière efficace (C'est-à-dire qu’il
s’agit ici de la capacité d’atteindre des
objectifs programmés) des tâches communes.
La finalité n’est pas immédiatement
l’efficacité mais celle de produire du lien, du
collectif, ceci sur un plan socio-affectif. La
coopération est l’énergie et l’esprit de la
coordination (N. Alter, 2009)
Un exercice qui interroge l’éthique, le lien et l’implication
L’étude recourt à des tiers, le référent pédagogique, mais aussi et surtout le commanditaire ou
plus précisément le référent du site d’accueil. Comment penser et construire ce rapport au
commanditaire ? Quelles sont les conditions pour le mettre en œuvre ?
Tout d’abord, cet exercice requiert une forme d’intelligence marquée par des impuretés, la
Métis. Elle s’oppose à la force et à la violence, elle est à la fois prudence et intelligence en
même temps que ruse et calcul. (G. Herreros, 2009)
Elle nécessite de réfléchir au comment agir, à l’éthique du lien (G. Herreros, 2009) que
l’ensemble des stagiaires ont déjà appréhendée et même éprouvée dans leurs pratiques
professionnelles de travailleurs sociaux. L’intervention sociale (cœur de métier) est une
expérience solide qui les guide dans leur rapport à celui qui demande. Le lien à construire
avec le site d’accueil (en référence au texte), c’est précisément tout d’abord s’en tenir au
terme d’accueil et comprendre ses contours. Le groupe de stagiaires cherche ainsi à trouver
les gestes, les paroles à mobiliser suite à une « invitation ». Celle-ci se réalise dans un cadre et
autour d’un objet que les protagonistes en présence vont définir et élaborer.
La question du lien se joue également au sein du groupe. Elle n’implique pas l’absence de
tensions mais elle propose précisément de les traverser. « Un lien se tisse, se resserre, se
distend, se réfléchit, s’analyse, se tranche…l’éthique du lien mobilisée dans l’intervention
peut être déclinée sous bien des formes » (G. Herreros, 2009).
Passer la porte d’une institution, d’une organisation, d’un collectif et explorer une question,
une situation, un problème, c’est amener de nouveaux éclairages au site d’accueil mais c’est
aussi prendre le risque de rompre avec ses propres représentations et par conséquent de s’en
défendre. Parfois, le groupe résiste également au problème exposé par le demandeur pour lui
3

signifier que le problème est tout autre et/ou ailleurs, arguant que la position d’extériorité,
voire de hauteur, permet de reconsidérer la question. Certes, conduire une étude présente
l’avantage d’explorer point par point une situation et de proposer d’autres explications mais
pour autant elle n’implique pas une position supérieure. Elle nécessite de faire
l’apprentissage des chemins à emprunter pour formuler, pour énoncer le travail. Plus que des
préconisations, le commanditaire attend une pensée plurielle construite avec lui. Il s’agit bien
d’éthique au sens d’une orientation dans l’action qui s’éprouve en situation. L’éthique sans
pratique n’existe pas. (E. Enriquez, 1993)
Dans ce travail d’étude terrain, la question de ce qui anime chacun dans sa présence aux
"objets étudiés" semble nodale particulièrement en formation (P.-A Guyot., 2009). Cette
remarque vaut bien entendu dans n’importe quel domaine des sciences sociales, que l’on
souscrive ou non aux séparations en sciences fondamentales ou sciences métissées. (On peut
penser sur ce point à ce que formule Pierre Bourdieu lorsqu’il évoque qu’il faut "objectiver le
sujet objectivant"). Traduit dans une formule clinique, il s’agit ici d’approcher « ce que tout
être humain a tendance à reporter sur ce qu’il rencontre des traces de ce qu’il fut et de ce qu’il
est » (F. Ben Slama, 1989).
Que l’on parle d’engagement dans son matériel de recherche (G. Devereux, 1980),
d’implication ou encore de contre-transfert (peu importe ici comment on utilise les concepts),
il s’agit de comprendre et d’interroger les dimensions liées à la production de l’étude et de son
sens (cela recouvre également les questions de l’opposition expliquer vs comprendre).
L’implication (mais tout autant les termes "d’engagement" ou de "contre-transfert) en effet,
par son étymologie même, connote le fait d’une confusion dans les situations humaines entre
observateurs et observés, un brouillage dans les démarcations posées initialement au sein d’un
dispositif qui a pour fonction la captation des faits (J. Ardoino, 2000).
Dans tout travail d’étude terrain ou de recherche, l’étudiant (le groupe d’étudiants, le
chercheur également) intervient, pense, agit aussi bien avec ses parts (personnelles,
psychiques, intérieures) que contre ses mêmes parts qui identifient de l’identique là où au
contraire il faut distinguer du différent et de l’altérité. L’idée d’un "déplacement" qui est à
effectuer de la part de ceux qui conduisent l’étude terrain, déplacement tant psychique
qu’auprès de son objet, nous semble une idée importante et à mettre au travail dans la
perspective de l’étude terrain. Par exemple, ce travail consiste à modifier les représentations
spontanées à propos de tel objet, de se conduire non plus en professionnel à propos d’une
question, mais bien en personne placée en position d’étude, de recherche, de mise en
questions.
Un exercice qui propose de s’équiper et de se disputer
L’étude de terrain, construite en groupe, est aussi l’occasion de confronter des modèles de
références théoriques et d’engager des controverses entre pairs. Nous observons que les
stagiaires explorent différentes notions et tentent d’associer leurs recherches sans présupposer
que tel champ disciplinaire ou tel modèle prévaut sur l’autre. A l’instar de François Laplantine
et Alexis Nouss, qui parlent « d’une épistémologie du métissage », qui s’intéresse « à ce qui
est mêlé, mélangé, déformé, aux mouvements d’hybridation plutôt que de s’efforcer de
construire des figures idéales supposées permettre de dévoiler des entités bien délimitées »
(H. Amblard, P. Bernoux, G. Herreros, Y.-F. Livian, 2005), nous observons que cet exercice
peut produire ces dispositions.
4

Le principe du métissage théorique permet, selon nous, d’explorer un problème en s’équipant
de travaux pluriels. Il autorise aussi à mobiliser différentes disciplines, à passer de l’individu,
au groupe, à circuler entre le général et le singulier, à naviguer entre l’opératoire et l’abstrait.
Il permet de déployer une pensée complexe au service de l’action en incluant l’idée que
mettre en relation des façons de voir et de comprendre constitue déjà de l’agir. Il invite, selon
nous, les étudiants à stimuler leurs réflexions, à poser de nouvelles questions.
Dans le fond, nous pensons que ce principe constitue une référence dans le travail social qui
compose en permanence avec les frontières des disciplines et tentent d’articuler concepts et
démarches empiriques dans la perspective d’élaborer, d’interroger, de revisiter ses propres
actions.
Ces échanges peuvent aussi être la source de disputes et encourager les membres du groupe à
déployer leurs ressources argumentatives. « Dans la dispute en justice, les gens soulèvent des
critiques et apportent des justifications » (L. Boltanski, 1990). Ils constituent ainsi à la fois un
excellent exercice pédagogique et une épreuve de justification.
Mais sur quoi portent les arrangements, les compromis entre étudiants? Leurs travaux en
témoignent. Ils démontrent ainsi que le monde social n’est pas opaque à ses membres et qu’il
n’y a pas de rupture entre le savoir scientifique et le savoir ordinaire sur la société.
Une proposition autour de la politique des savoirs
Il nous semble qu’il est possible de poser, en préalable à la question des savoirs produits et
travaillés dans le cadre de l’étude terrain, celle de comprendre la nature des relations qui se
tissent entre les registres des théories et ceux des pratiques (si on accepte de poser ainsi, par
ces termes, le clivage entre ces deux instances) et de même de quelles natures sont les liens
qu’il est possible de construire, d’imaginer, de projeter entre ces deux instances, lorsqu’il est
question de « fabriquer » des ingénieurs sociaux instruits, avisés, et non désabusés ou
cyniques, ou impuissants.
Il appartient aux débats qui se nouent au sein des sciences humaines de poser cette question
avec force et modestie. Nous pouvons la traduire de la manière suivante : en quoi les discours
des sciences humaines et sociales permettent-ils de mieux appréhender, de mieux cerner, et de
mieux « maîtriser » (pour y intervenir) l'ordre des choses et des pratiques humaines? En quoi
ces discours sont-ils source d’avancées (et de quelles natures, de quelles portées sont ces
avancées) pour les individus, les groupes, les institutions dans leurs manières de s’approprier
le monde qui les entoure, dans les situations qui leur sont propres ? (J. Beillerot 1989).
Tout ceci est fort ambitieux on le voit. De manière plus précise, nous dirons que le travail de
l’étude terrain ambitionne de se positionner sur les axes politiques et épistémiques suivants :
- sur le plan politique la question est de savoir quelles sont les finalités qu’impliquent les
conceptions du travail d’étude (et de recherche) en sciences humaines.
A cet égard, il ne peut y avoir de réalité hors débats, ou encore hors conflits et donc hors des
rapports de pouvoir. En conséquence, quel modèle de concours ou de contribution (ou de
conflit encore une fois) peut-il exister entre ceux qui conduisent une étude et les personnes ou
les groupes ou encore les institutions dans lesquels ces personnes interviennent ? La question
des finalités de l’étude est ici en lien immédiat avec l’usage des savoirs, ce qui en est attendu
auprès des personnes concernées, qu’il s’agisse de professionnels ou encore des usagers d’un
secteur donné.
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%