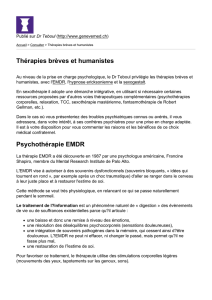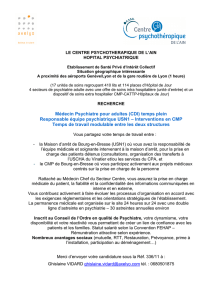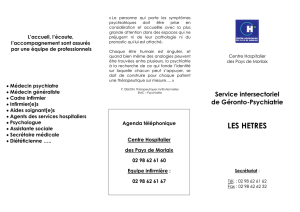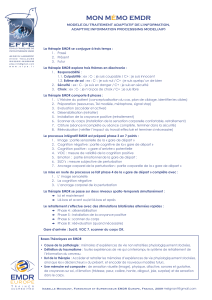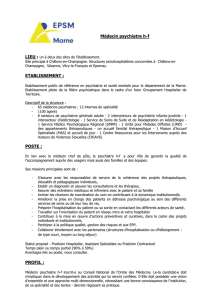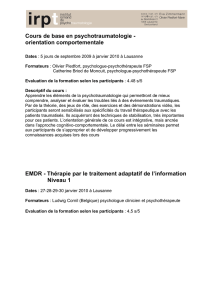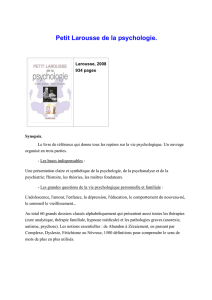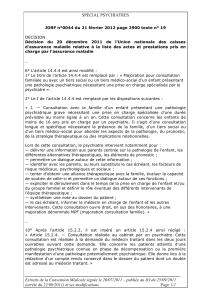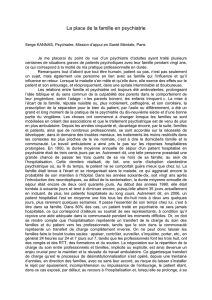P45 - Traitement anti-hormonal chez les auteurs de

POSTER BRONZE
14ème édition –Du 23 au 25 mars 2016
P45 - Traitement anti-hormonal chez les auteurs de violences
sexuelles : étude descriptives à partir de la consultation spécialisée
de Bordeaux
Auteurs
Nicolas THOUMY(*), Florent COCHEZ(**) et Jean-Philippe CANO(***)
Unité ERIOS (DISPO-33), Service de Psychiatrie et de Psychologie Légales, Pôle de Psychiatrie Générale et Universitaire, CH Charles Perrens,
Bordeaux. (*) Interne en DES de Psychiatrie (**) Psychiatre hospitalier, responsable médical (***) Psychiatre hospitalier

Adresse mail de correspondance : fcochez@ch-perrens.fr
La prise en charge des auteurs de violence sexuelle (AVS) est partagée entre justice et santé. Côté médecine, la
conférence de consensus de 2001 « Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agressions sexuelles »
formule le souhait du développement de la pharmacothérapie anti-hormonale aux côtés des prises en charge
psychothérapiques. Dans les années suivantes, le sujet vient régulièrement sur le devant de la scène, lors de vifs débats
politiques à l'occasion de faits divers dramatiques. En 2014, malgré sa recommandation cinq ans plus tôt, la commission
de transparence de la Haute autorité de santé constate l'absence de mise en place d'une étude auprès des patients traités
par triptoréline, une des deux molécules bénéficiant de l'Autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l'indication de la
paraphilie.
L'objectif de la présente étude, rétrospective et descriptive, est d'évaluer les caractéristiques socio-démographiques,
cliniques et thérapeutiques d'hommes adultes auteurs de violence sexuelle sous traitement anti-hormonal, depuis
l'ouverture en 2001 de la consultation spécialisée de Bordeaux (ERIOS-DISPO33).
Le critère d'inclusion dans l'étude est la survenue, au cours de la prise en charge, d'un traitement antihormonal, défini
comme une molécule ayant une action spécifique sur la testostérone. Sont ainsi retenus l'acétate de cyprotérone et
l'embonate de triptoréline (AMM) ainsi que les molécules agonistes de la GnRH (hors AMM) et sont exclus les
antidépresseurs sérotoninergiques (hors AMM dans cette indication). Le recueil des informations a été réalisé à partir des
dossiers médicaux, avec le consentement écrit du patient.
Après une présentation du dispositif spécialisé de Bordeaux et un rappel des molécules concernées, seront décrits le profil
des patients traités, les problématiques cliniques et judiciaires visées, les modalités de prescription, la durée du traitement
et ses conditions d'arrêt, les difficultés rencontrées (effets indésirables, bris des conditions, récidive, etc.), la prise en
charge associée, etc. Les limites de l'étude seront également abordées.
Les auteurs espèrent ainsi contribuer à alimenter la réflexion et la connaissance sur les traitements anti-hormonaux, et
inspirer de futures études à plus grande échelle afin d’optimiser leur prescription aux bénéfices des patients.

POSTER ARGENT
14ème édition –Du 23 au 25 mars 2016
P22 –Le projet RDOC : vers une révolution de la clinique
psychiatrique par les neurosciences ?
Auteurs
Gauthier LE QUANG
Psychiatre
Centre Hospitalier Sainte Marie de Privas
19 Cours du Temple, 07000 PRIVAS
Gauthier.[email protected]om
Yannis GANSEL
Psychiatre, Praticien Hospitalier
Service de psychopathologie du développement
Hôpital Femme Mère Enfant, Groupement Hospitalier Est
59 boulevard Pinel, 69677 BRON Cedex

Objectifs : Proposer une analyse épistémologique du projet Research Domain Criteria (RDoC), lancé par le National Institute of Mental
Health (NIMH) aux Etats-Unis en 2009. RDoC a été présenté par ses coordonnateurs scientifiques comme un moyen de faire advenir
une « révolution scientifique » en psychiatrie. Il a suscité des réactions contradictoires dans la littérature scientifique anglo-saxonne, mais
reste encore peu connu en France.
Méthode : Notre analyse s’appuie principalement sur la littérature scientifique disponible à propos du projet RDoC, ainsi que sur des
travaux provenant du champ des sciences humaines.
Résultats : Le projet RDoC est présenté comme un projet à long terme visant à donner un cadre aux recherches neuroscientifiques
fondamentales, fédérer ces recherches et les soutenir financièrement. Son point de départ est la promotion de recherches au niveau
physiopathologique et non clinique. Le cadre du projet est présenté comme une matrice croisant les « dimensions fonctionnelles » du
fonctionnement cérébral étudié d’une part, et sept « unités d’analyse »d’autre part, du niveau moléculaire au niveau comportemental.
L’objectif annoncé est de mettre à jour les déterminants neurobiologiques des comportements normaux et pathologiques, et de
déboucher sur la mise au point d’une classification des troubles mentaux basée sur la neurobiologie. Une telle classification pourrait
d’après les auteurs permettre de concevoir des diagnostics et des traitements spécifiques de la physiopathologie des troubles mentaux et
ainsi transformer considérablement la pratique clinique psychiatrique. RDoC est pensé comme une alternative aux classifications
actuelles des troubles mentaux (par exemple le DSM) et s’en différencie fondamentalement par sa focalisation sur les aspects
physiopathologiques et non cliniques et par son modèle dimensionnel et non catégoriel des troubles mentaux.
Discussion : La révolution scientifique ambitionnée est donc de parvenir à passer d’une pratique clinique psychiatrique essentiellement
empirique actuellement, à une pratique clinique basée sur les connaissances physiopathologiques des troubles mentaux. Cependant, la
manière dont le projet RDoC permettrait de combler le fossé entre recherche fondamentale neuroscientifique et pratique clinique
demeure peu claire et les concepteurs du projet semblent supposer que ce fossé devrait disparaître de lui-même avec l’avancée de la
science. Ce postulat sous-jacent peut être mis en lien avec la relégation de la clinique au second plan, parti pris méthodologique du
projet RDoC critiqué par plusieurs auteurs, puisque l’objectif même du projet est de transformer in fine la pratique clinique.
Conclusions : Le projet RDoC apparait comme un projet de recherche neuroscientifique ambitieux et novateur. Il reste en pleine
évolution et consiste pour l’instant essentiellement en un cadre pour des recherches fondamentales à venir. La matrice du projet RDoC
enfantera-t-elle une « révolution » de la pratique clinique psychiatrique ? L’avenir nous le dira…

POSTER OR
14ème édition –Du 23 au 25 mars 2016
P32 – L’efficacité de l’EMDR dans la diminution de l’angoisse de
performance
Auteurs
Emmanuelle DOBBELAERE(*), Philippe RENAUD(**), France HAOUR(***) et Zoï KAPOULA(****)
(*) Association EMDR France and Université Paris Descartes (**) Université Paris Descartes (***) Association EMDR, ancienne directrice de
recherche à l’INSERM (****) Paris Descartes Université, directrice de recherche au CNRS
 6
6
1
/
6
100%