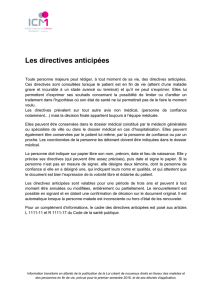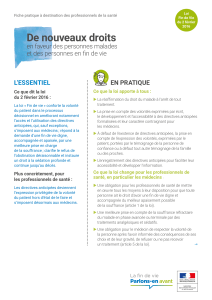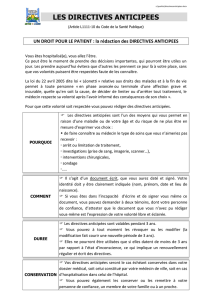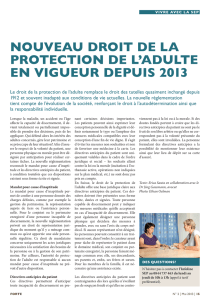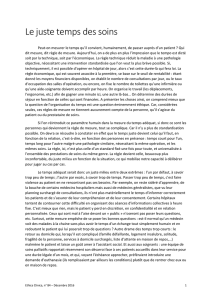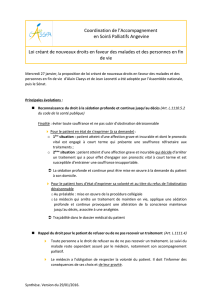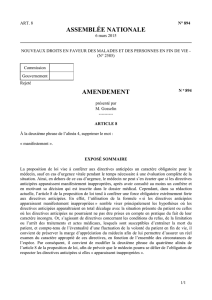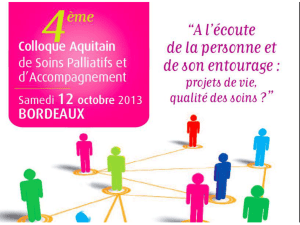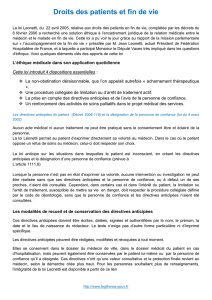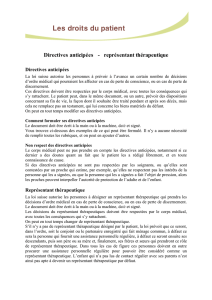Directives anticipées: un testament médical à

14 | Mercredi 7 novembre 2012 | Le Quotidien Jurassien
MAGAZINE santé } Cette page Magazine santé
est réalisée en collaboration
avec l’Hôpital du Jura et le
Service cantonal de la santé
publique.
Directives anticipées:
un testament médical à respecter
V
AUTODÉTERMINATION Le nouveau droit suisse de la protection de l’adulte (DPA) entre en vigueur
le 1er janvier 2013. Le droit civil fédéral tient compte des directives anticipées.
Elles permettent à une personne de faire connaître sa volonté en matière de soins médicaux
Rédiger des directives anticipées n’est pas un geste anodin. D’où l’importance de se faire conseiller et aider par un spécialiste.
avec une maladie, par exemple. Subjecti-
ves, les volontés présumées peuvent être
suggérées par une personne entretenant
des relations bienveillantes avec le pa-
tient en faisant fi de ses propres désirs et
intérêts objectifs. Chose qui n’est pas fa-
cile lorsqu’il s’agit de décider pour autrui
sur des enjeux de vie ou de mort.
PEGGY FREY
pectant la primauté de la volonté
d’un patient, et sans lui administrer
les actes de la vie quotidienne (AVQ)
sous la contrainte, les mesures desti-
nées à prévenir un état d’abandon ou
de manque total d’hygiène ne peu-
vent être refusées (concerne particu-
lièrement des patients en EMS). De
même, comme le précise la Commis-
sion nationale d’éthique (CNE), «un
patient ne peut exclure le traitement
de douleurs insupportables». L’éva-
luation de ces situations délicates et
subjectives se fait souvent en coordi-
nation avec le corps médical et les
proches. Les restrictions posées au
champ d’application des DA doivent
être justifiées. Les cas ou l’éthique
sociale, le souci de préserver l’intégri-
té professionnelle des soignants et
celui de prévenir des dommages à
autrui sont ceux qui peuvent être dis-
cutés.
La valeur des DA peut aussi être
mise en doute lorsqu’il est possible
de prouver qu’elles ne correspon-
dent plus à la volonté présumée du
patient. Ce cas de figure peut se
présenter lorsqu’un patient ne pen-
se pas à actualiser ses directives ou
lorsque celles-ci ne sont pas en rapport
brale, infarctus), de traitement de la
douleur, de refus ou d’acceptation
d’une alimentation artificielle (mesu-
re invasive), d’une réanimation, de
certains modes de soins (intubation,
soins intensifs, transfusions), etc.
«Ces directives dépendant beaucoup
de l’état de santé du patient au mo-
ment de la rédaction. Elles peuvent
aussi évoluer et être modifiées à tout
moment», renseigne le chef du Dé-
partement médical de l’Hôpital du
Jura. Y est aussi précisée l’identité
d’une personne de confiance. Celle-
ci, intitulée «représentant thérapeuti-
que», avec ou sans lien de parenté
avec le patient, fait valoir la volonté
de ce dernier auprès d’une équipe
soignante, lorsque le malade n’est
plus capable de le faire personnelle-
ment. Enfin, le document mention-
ne les directives particulières en cas
de décès que peuvent être le don d’or-
ganes ou l’autorisation de mener une
autopsie, par exemple.
Limites et volonté présumée
Dans les DA, ne peuvent être exi-
gées des soignants des actions punis-
sables ou des mesures thérapeuti-
ques contre-indiquées. Tout en res-
individu? Ses proches, son médecin
généraliste ou, dans des cas particu-
liers, une expertise psychiatrique.
Pour pouvoir rédiger correctement
ses directives anticipées, la personne
doit être consciente de l’implication
de cet acte, de son état de santé et, si
elle souffre d’une maladie, de l’évolu-
tion possible de son affection afin de
pouvoir l’anticiper. Le patient, libre
de prendre ses décisions, n’est nulle-
ment obligé d’expliquer ses choix,
même s’ils peuvent paraître dérai-
sonnables.
«Le contenu des directives antici-
pées dépend beaucoup de l’état de
santé, des valeurs personnelles d’un
individu, voire de ses convictions re-
ligieuses», note le Dr Michel Brüni-
sholz. La Fédération des médecins
suisses (FMH) propose un document
type à remplir avec, éventuellement,
l’aide de son médecin généraliste ou
de tout autre personnel soignant
compétent. Ce questionnaire expli-
que dans quelles situations les DA
sont applicables et quelles sont les
motivations personnelles du patient.
En terme de traitement, il mentionne
les volontés en cas d’événements
inattendus (accident, attaque céré-
Par ses directives anticipées,
une personne peut donner
des indications et instruc-
tions aux médecins et au-
tres professionnels de la santé sur le
type de traitements et soins qu’elle
accepte ou refuse. Ceci en cas où elle
ne serait plus en mesure de se déter-
miner sur ces choix après un acci-
dent, pendant un coma ou un état de
démence, par exemple.
Rédigées par un individu capable
de discernement, les directives anti-
cipées (DA) ont pour fonction d’ex-
primer de manière contraignante le
souhait médical d’une personne et
assurent la continuité de ses choix.
Elles entrent en application dès
qu’un malade n’a plus la faculté d’ex-
primer ses volontés et s’imposent
aux soignants qui sont obligés de les
respecter.
La possibilité de rédiger des direc-
tives anticipées n’est pas nouvelle.
Les DA ont même été inscrites dans
plusieurs législations cantonales ces
dix dernières années dans le but de
donner plus de liberté et d’autodéter-
mination au patient en matière de
soins. Dès le 1er janvier 2013, dans le
cadre du nouveau droit suisse de la
protection de l’adulte (DPA), les DA
entrent dans le droit civil fédéral.
L’adage: «Le professionnel propose,
le patient dispose», prendra alors
toute son importance. Même si pour
l’heure «seuls 10% de la population
suisse rédigent des directives antici-
pées», précise le Dr Michel Brüni-
sholz, chef du Département médical,
à l’Hôpital du Jura.
L’autodétermination
du patient à renforcer
Seule une personne capable de dis-
cernement – y compris les mineurs –
peut rédiger des directives anticipées
juridiquement valables. Inverse-
ment, celles-ci ne constituent une
base légitime de décision que si leur
auteur a perdu sa capacité de discer-
nement. «Cela sous-entend qu’une
personne touchée par une maladie
portant atteinte à son intégrité men-
tale (démence, Alzheimer, etc.) ou
placée sous privation de liberté à des
fins d’assistance (PLAFA), ne peut
faire part de telles directives», expli-
que Dr Michel Brünisholz. Qui juge
de la capacité de discernement d’un
Le patient a des droits
fessionnel de la santé qu’il
souhaite, ainsi que l’établis-
sement où il veut être soi-
gné. Il peut aussi accéder li-
brement à son dossier médi-
cal et se faire expliquer son
contenu. Lors d’un séjour
en établissement sanitaire,
le patient peut demander as-
sista
nce et conseil. Il peut
disposer de son corps com-
me il l’entend et faire don
de ses organes, même
contre la volonté de ses
proches.
PF
Les directives anticipées
personnelles ne sont
qu’une partie du droit du
patient, beaucoup plus lar-
ge. Ce dernier peut deman-
der à être informé de son
état
de santé, des traite-
ments envisageables et de
leurs risques, des pronos-
tics, tout cela sous couvert du
secret professionnel. Aucun
soin ne peut lui être donné
sans son consentement libre
et éclairé et il ne peut subir
aucune contrainte. Le patient
peut choisir librement le pro-
Seule une personne capable de discerne-
ment – y compris les mineurs – peut rédiger
des directives anticipées juridiquement vala-
bles.
si les rédiger individuellement et personnelle-
ment.
– Les DA se présentent sous forme écrite, da-
tées et signées. Elles sont rédigées librement
par une personne capable de discernement,
sans pression ni contrainte extérieure.
– Les DA ne sont pas définitives. Elles peuvent
évoluer et être mises à jour tout au long de la
vie. Elles peuvent être révoquées à tout mo-
ment par l’auteur capable de discernement.
Rédiger des DA n’est pas une obligation.
Il appartient à l’auteur de veiller à ce que l’exis-
tence de ses DA soit connue en cas de besoin. Il
peut les porter sur lui, les déposer chez son
médecin généraliste ou son représentant thé-
rapeutique, etc. PF
– Rédiger des directives anticipées (DA) n’est
pas un geste anodin. D’où l’importance de se
faire conseiller et aider. Pour pouvoir exercer
son autonomie en matière de soins, l’informa-
tion préalable, suffisante et compréhensible
du malade par un médecin praticien est indis-
pensable. Ce dialogue permet de comprendre
les situations de vie, les valeurs et les priorités
des patients.
– Dans les hôpitaux, les EMS, les cabinets mé-
dicaux, les services de soins à domicile, la ques-
tion des directives anticipées peut être abor-
dée avec les patients.
– Différents organismes (en particulier la FMH)
proposent des modèles de formulaires pou-
vant servir à préciser ses DA. L’auteur peut aus-
FLes directives anticipées en pratique
Le consentement
libre et éclairé
Le droit à l’information et à l’auto-
détermination est un principe fon-
damental de la relation entre patient
et médecin. A l’Hôpital du Jura, ce
principe est formalisé par un proces-
sus qui engage, d’abord le chirur-
gien puis l’anesthésiste à informer
de manière adéquate le patient sur le
diagnostic et l’opération proposée,
avec les résultats escomptés et les in-
convénients et risques possibles. Le
patient peut solliciter un deuxième
entretien. A l’issue de ce processus
d’information, le patient signe un
formulaire de consentement, ou de
refus. PETER ANKER
1
/
1
100%