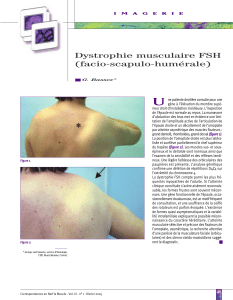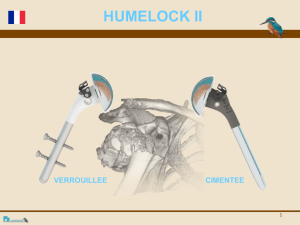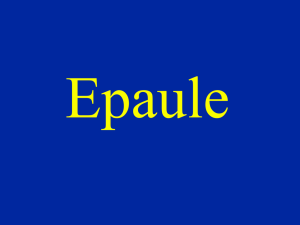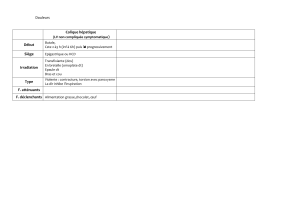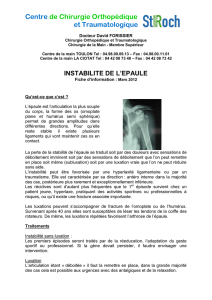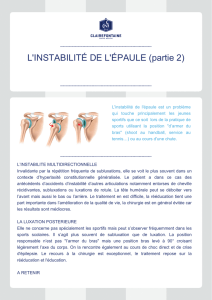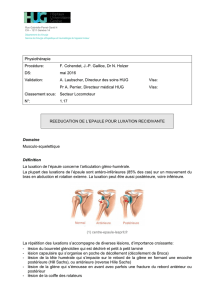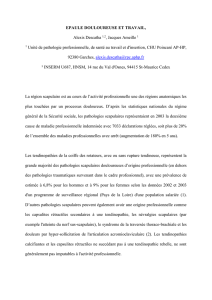Les dyskinésies scapulaires : physiopathologie

LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA SCAPULO-
THORACIQUE
LES DYSKINESIES SCAPULAIRES
Jean-Baptiste COURROY
_________________________
Les énormes progrès réalisés dans le démembrement de l'épaule douloureuse sont
incontestablement liés au développement de techniques perfectionnées d'imagerie et à l'usage
d'une sémiologie clinique plus fine. Cependant l‟identification d'une pathologie strictement
lésionnelle qui ferait correspondre une lésion donnée à un désordre précis est en échec devant
un certain nombre d‟épaules douloureuses. C'est sans doute la rançon de l'incroyable
complexité biomécanique d‟un système articulaire qui doit assurer la mobilité et la stabilité
d‟une articulation gléno-humérale sans congruence ni stabilité intrinsèques, articulée à une
base scapulaire elle-même mobile dans tous les plans de l'espace sur la convexité du gril
thoracique. Cette exigence de mobilité a pour double nécessité un centrage gléno-huméral
instantané satisfaisant et un passage sous acromial harmonieux lors de l'élévation.
L‟impossibilité de respecter ces exigences est à l'origine des deux pathologies
respectives d'instabilité et de conflits douloureux. Dans les deux cas, l'attention s'est
longtemps limitée à l‟étude de l'étage gléno-huméral : des lésions osseuses et labro-
ligamentaires pour l'instabilité, des éléments anatomiques du défilé sous acromial pour le
conflit supérieur révélé par Neer, sans s‟intéresser au maillon scapulaire.
L'omoplate tient pourtant un rôle fondamental dans la physiologie de l'épaule, à de
multiples niveaux.
- Elle donne une base stable à l'articulation gléno-humérale, essentielle pour assurer le
centrage gléno-huméral et aligner l'axe de la glène avec l'axe du bras Cela permet de
maintenir une zone de sécurité (30° en flexion et en extension de part et d‟autre de l‟axe
d‟alignement) et d'efficacité (maintien de l‟effet compressif) lors de l'élévation du bras.
- Elle assure une base stable aux muscles de la coiffe qui s‟y insèrent en leur
permettant d'optimiser leurs actions dynamiques sur le bras et compressives sur l'articulation
gléno-humérale.
- Elle permet le passage sous acromial, qui est la condition essentielle de l‟élévation
haute du bras, par le réglage de l‟orientation de la glène dans les trois plans de l‟espace.
- Elle permet enfin l'orientation du membre supérieur dans un large arc fonctionnel et
la transmission optimale des forces de la chaîne cinétique passant, depuis l‟appui au sol, par
les membres inférieurs, la bassin, le thorax jusqu‟au bras lanceur. Il a été montré que plus de
50% de l‟énergie utilisée lors du service au tennis provient de la partie proximale de la chaîne,
depuis les membres inférieurs, le bassin et le thorax. De même, on a calculé qu'une
diminution de 20 % de l'énergie délivrée au niveau de la hanche et du tronc nécessite une
augmentation de 30 % dans la vitesse de rotation de l'épaule pour obtenir la même force de
lancer.
Si la mobilité scapulaire est indispensable aux mouvements du membre supérieur,
encore faut il que cette mobilité soit harmonieuse, comme on peut l‟apprécier en voyant de

dos l‟élévation du bras chez un sujet sain. En l‟absence de raideur articulaire, cette harmonie
dépend du réglage instantané des actions réciproques de tous les muscles moteurs et/ou
insérés sur l‟omoplate. Il n‟est pas étonnant que les premières observations de dysharmonies
du jeu scapulaire (on parlera de dyskinésies) aient été constatées chez des patients souffrant
d‟une paralysie affectant ou l‟un, ou l‟autre, ou plusieurs de ces muscles : paralysies d‟origine
radiculaire, ou paralysies d‟origine tronculaire de muscles importants comme le trapèze, le
grand dentelé, ou les muscles de la coiffe des rotateurs.
Ce n‟est qu‟à partir des années 90, que différents auteurs commencèrent à s‟intéresser
aux dyskinésies scapulaires mineures, constatées sur des populations de sportifs présentant
soit un conflit sous acromial soit une instabilité fruste de l‟épaule à expression douloureuse.
Malgré le fait que de telles constatations puissent être faites au sein d‟une population saine
non sportive, la fréquence de ces dyskinésies chez les pratiquants de sports de lancer ou de
raquette a fait logiquement rechercher quelle relation établir entre ces pathologies et les
dyskinésies scapulaires constatées. Plusieurs questions se posent :
- les dyskinésies scapulaires sont-elles la cause ou la conséquence des pathologies
douloureuses, qu‟elles soient conflictuelles ou instables ?
- sont-elles en rapport avec les autres caractéristiques que présentent les épaules des
lanceurs ?
- peut-on identifier de façon fiable, par la clinique, ou par d‟autres investigations, ces
dyskinésies ?
- enfin, leur correction éventuelle peut-elle rendre ces épaules indolores dans la
pratique sportive ?
LA PHYSIOLOGIE SCAPULAIRE
Tout déplacement de l‟omoplate entraîne par l‟intermédiaire de l‟articulation acromio-
claviculaire un déplacement de la clavicule, qui entraîne ensuite les mouvements plus
modestes de l‟articulation sterno-costo-claviculaire. De plus, tout mouvement scapulaire
s‟effectue dans plusieurs plans de mobilité. La présentation des mobilités scapulaires est aussi
forcément schématique car les axes de mobilité ne correspondent pas aux plans géométriques
de référence, en raison du glissement de l‟omoplate sur la double convexité du gril thoracique.
A La mobilité scapulaire analytique
- Elévation-abaissement d‟une amplitude de 10 à 12 cm.
- Translation latérale, ou antépulsion, ou abduction–rétropulsion ou adduction
(protraction-retraction dans la littérature de langue anglaise) qui écarte le bord spinal de 10 à
12 cm par rapport à la ligne des épineuses vertébrales. Au cours de ce déplacement le plan de
l‟omoplate par rapport au plan frontal passe de 30 à 45°, faisant passer l‟angle omo-
claviculaire de 70 à 60°.
- Rotation supérieure, ou sonnette interne qui oriente la glène vers le haut-rotation
inférieure qui oriente la glène vers le bas (sonnette externe) autour d‟un axe perpendiculaire
au plan de l„omoplate, passant par un centre situé près de l‟angle scapulaire supéro-latéral.
L‟amplitude de cette rotation est de 45à 60°.
- Rotation scapulaire d‟environ 10° autour d‟un axe vertical : la rotation interne oriente
la glène vers l‟avant ; la rotation externe l‟oriente vers l‟arrière.
- Bascule antéro-postérieure autour d‟un axe transversal légèrement oblique en dehors
et en avant.

Tout mouvement scapulaire mobilise la clavicule dont la mobilité est d‟environ 12-13
cm dans ses deux axes mécaniques orthogonaux, légèrement obliques dans les deux plans,
vertical pour l‟antéposition, et horizontal pour l‟élévation. A cette mobilité s‟ajoute une
rotation de la clavicule de 30° dans chacune des articulations acromio- et sterno-costo-
claviculaire.
B Les mouvements réels de l’omoplate
Il s'agit essentiellement des mouvements d'élévation-abaissement, d'antépulsion-
rétropulsion du moignon, et du mouvement complexe effectué lors de l'élévation haute du
bras, qui nous intéresse ici.
Que ce soit dans le plan frontal (abduction), scapulaire (abduction vraie) ou sagittal
(flexion), les 60 premiers degrés d‟élévation ne s‟effectuent que dans la seule articulation
gléno-humérale, et le déplacement de l‟omoplate ne commence qu‟à partir de 60° d'élévation.
Après 150°, l‟élévation du bras impose la participation du rachis, par une inclinaison latérale
pour un mouvement d‟un seul bras, et par la mise en lordose pour un mouvement bilatéral.
Entre 60 et 150° l‟élévation du bras nécessite donc le déplacement de l'omoplate, pour
orienter la glène et faciliter le passage du trochiter sous l'acromion, qui sont les deux
conditions nécessaires à l'élévation haute du bras. Ce déplacement scapulaire se fait dans les
trois plans de l‟espace, et associe :
- une ascension de 8 à 10cm ;
- une rotation supérieure, la sonnette interne, qui augmente harmonieusement jusqu'à
une élévation de 150°. À partir de 120° la rotation scapulaire est égale à la rotation gléno-
humérale ;
- une rotation biphasique, d‟abord externe de 10° ( glène vers l‟arrière) jusqu‟à l‟angle
de 90° puis en rotation interne de 6° ensuite ;
- une bascule postérieure de plus de 20°déplaçant la partie supérieure de l‟omoplate
vers l‟arrière et un peu vers le bas.
Au niveau de la clavicule l‟élévation du bras entraîne une petite élévation et
rétropulsion de la clavicule ainsi qu‟une rotation de ses deux extrémités articulaires, rotations
qui s‟additionnent pour permettre la sonnette scapulaire de 60°.
C les muscles moteurs de l’omoplate
Trois groupes de muscles s'insèrent sur l'omoplate :
- le premier est celui des muscles intrinsèques de la coiffe (sus épineux, sous épineux,
sous scapulaire, petit rond) qui sont coapteurs et moteurs de l'articulation gléno-humérale ;
- le deuxième groupe est celui des muscles extrinsèques de l'épaule (deltoïde, biceps,
triceps, coraco-brachial) dont l'action sur l'omoplate n'est visible qu'en chaîne fermée, avec la
main comme point fixe.
- le troisième groupe est celui des six muscles moteurs vrais de l'omoplate ; ils
assurent le double rôle d'orientation dynamique de l'omoplate dans les trois plans de l'espace
et de stabilisation instantanée pour offrir une base stable à l‟action de la gléno-humérale.
Le grand dentelé. La partie supérieure a une direction presque horizontale :
elle attire l'omoplate en antépulsion et applique son bord spinal sur le gril thoracique. La
partie inférieure est oblique en bas et en avant : elle bascule l'omoplate en arrière, en orientant
la glène vers le haut. C'est le seul parmi les muscles moteurs de l'omoplate qui fait les trois
actions indispensable à l‟élévation haute du bras, la sonnette interne, la bascule postérieure et
la rotation externe scapulaires.
Le trapèze. Ses trois faisceaux ont des fonctions différentes :

- le faisceau supérieur acromio-claviculaire est oblique vers le haut ; il soulève le
moignon ;
- le faisceau moyen est presque transversal ; il attire omoplate en adduction,
légèrement en arrière en la fixant sur le gril ;
- le faisceau inférieur est oblique en bas et en dedans ; il attire l'omoplate en bas et en
adduction.
Le rhomboïde. Direction oblique en haut et en dedans. Il a donc une action
d'élévation, de rotation scapulaire externe orientant la glène vers le bas.
L'angulaire. Direction oblique en haut et en dedans. Il a à peu près la même
action que le rhomboïde mais il est plus élévateur et moins rotateur.
Le petit pectoral. Direction oblique en avant en bas et en dedans Il abaisse le
moignon et fait basculer l'omoplate vers l‟avant et en bas en orientant ma glène vers le bas. Il
attire l‟omoplate en antépulsion et fait décoller son bord spinal, action antagoniste de celle du
grand dentelé.
Le sous clavier. Direction oblique en bas et en dedans. Il abaisse le moignon
par son action d'abaissement de la clavicule.
LES ETIOLOGIES DES DYSKINESIES SCAPULAIRES
De nombreux facteurs anatomiques et fonctionnels peuvent intervenir dans la
perturbation de l'harmonie du mouvement scapulaire. Certains sont évidents, objectifs mais
beaucoup d'autres sont plus difficiles à mettre en évidence, qui font intervenir, de façon
intriquée, la douleur, la fatigue à l'effort, le type du geste sportif répété, les lésions articulaires
et les perturbations du tonus musculaire.
A Les perturbations anatomiques
- L’ankylose articulaire. Le cas le plus évident est celui de la capsulite rétractile où
l'on constate de façon évidente une augmentation de la rotation scapulaire pour gagner
quelques degrés lors de l'élévation du bras. On peut noter qu'une fois la récupération des
amplitudes obtenue et la capsulite guérie, cette dysharmonie disparaît d'elle-même.
- La raideur capsulaire postérieure. La diminution de la rotation interne scapulo-
humérale est une constatation fréquente chez les sportifs pratiquant des sports de lancer, et
l'augmentation de la rotation externe chez ces sujets ne compense généralement pas cette
limitation. On sait que la diminution globale du volant des rotations est un facteur prédictif
des pathologies conflictuelles de l'épaule. Cette raideur crée lors de l'adduction horizontale du
bras en fin de lancer une antépulsion excessive du moignon avec une rotation antérieure de la
glène et un abaissement de l'acromion favorisant l'impaction sous acromiale.
- Enfin, la cyphose dorsale haute, et les postures spontanées en enroulement d'épaule
présentées par certains sujets sont autant d'éléments modifiant les amplitudes et le jeu
d'antépulsion-rétropulsion du moignon et donc l'orientation de la glène. Il est possible aussi
qu'une raideur acquise des éléments de traction antérieure comme le petit pectoral et le
coraco-biceps puissent jouer un rôle dans la pérennisation de la dyskinésie, en altérant le jeu
normal de la sonnette et de la bascule scapulaires.
B Le déficit des muscles stabilisateurs d'omoplate
Les muscles grand dentelé et trapèze sont principalement concernés en raison de leur
rôle prépondérant dans la stabilisation scapulaire comme le montre l'importante dyskinésie

constatée en cas de parésie objective de l'un ou l'autre de ces muscles. L‟insuffisance du grand
dentelé est donc particulièrement cruciale pour la stabilité scapulaire lors de l‟élévation haute
du bras. Le problème essentiel et incontournable est de faire la preuve d'un déficit objectif par
l'électromyogramme dont la technique de réalisation et la fiabilité concernant l'étude du grand
dentelé restent bien trop aléatoires.
La baisse ou le retard d'activation du grand dentelé et du trapèze sont au centre du
problème. Différentes études ont montré une anomalie d'activation chez des nageurs
présentant un conflit douloureux, sans qu'il soit possible de déterminer si cette anomalie est la
cause ou la conséquence du problème mécanique. De même, l'influence de la fatigue sur le
niveau d'activation de ces muscles semble réelle mais se heurte à la difficulté pratique d'isoler
la seule action des muscles stabilisateurs de l'omoplate lors des exercices.
C L’effet d’une atteinte de la coiffe
Plusieurs études ont montré une augmentation de la sonnette durant l'élévation du bras
en présence d'une lésion transfixiante du sus épineux. On peut penser qu'il s'agit d'une
compensation normale pour optimiser l'amplitude du mouvement. On peut aussi remarquer
que la dyskinésie disparaît une fois la coiffe réparée et le patient indolore. L'autre argument
est donné par l'étude de patients non symptomatiques chez lesquels a été pratiqué un bloc du
nerf sus scapulaire, et qui ont tous montré ensuite une augmentation significative de la
sonnette lors de l'élévation.
LA MESURE DE LA DYSKINESIE
D‟autres études ont essayé de mesurer de façon objective le déplacement complexe de
l'omoplate lors des mouvements d'élévation. Les mesures faites à l'aide d'inclinomètres sont
simples à effectuer et ont montré une bonne fiabilité, mais dans la seule mesure de la sonnette
lors de l‟élévation, et dans le seul plan frontal d‟abduction. Les études plus récentes utilisent
des capteurs cutanés (de fiabilité critiquable) permettant de mesurer plus de paramètres
(bascule postérieure, sonnette et rotation internes, translations latérale et supérieure). Les
mesures en IRM 3D ont sans doute de l'avenir mais elles sont de réalisation laborieuse, et
n'évaluent le patient qu‟en position allongée.
Malheureusement, toutes ces études sont assez discutables car elles comparent souvent
des sujets sains à des sujets pathologiques sans que les lésions de ces derniers soient
objectivées. De plus, les mouvements analysés sont souvent effectués dans des plans
différents d'élévation, antérieure, scapulaire ou latérale. On ne s'étonne donc pas que les
résultats soient assez contradictoires ; seule la diminution de la bascule postérieure et
l'augmentation de la sonnette semblent assez fréquemment constatées. Au total, il n'existe pas
aujourd'hui de méthodes objectives indiscutables qui puissent mesurer de façon fiable la
dyskinésie scapulaire.
L’EVALUATION CLINIQUE
- Les notions classiques
Les dyskinésies scapulaires étant très largement liées à une perturbation de la fonction
du muscle grand dentelé , voire du trapèze, on retrouve naturellement ici une sémiologie
proche de celle, connue, des atteintes des nerf de Charles Bell ou du nerf spinal.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%