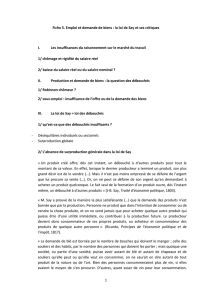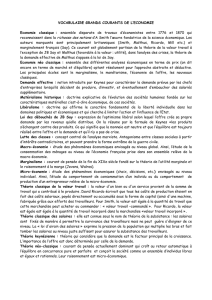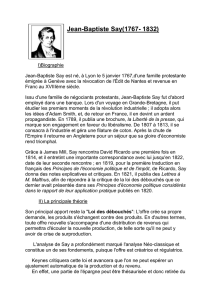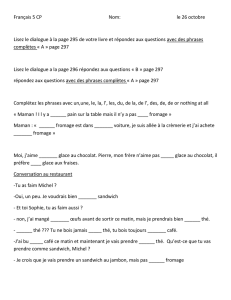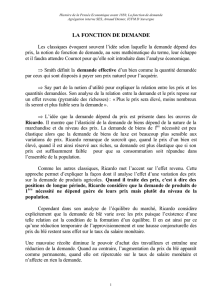Richesse et valeur€: la contribution des économistes

ALAIN BERAUD1
RICHESSE ET VALEUR : LA CONTRIBUTION DES ÉCONOMISTES
FRANÇAIS DU DÉBUT DU 19ÈME SIÈCLE
En proposant de mesurer la richesse par sa valeur, Smith a ouvert un long débat
dans lequel les économistes français ont défendu une position assez différente de celle
des classiques anglais. Alors que Ricardo rejetait l’idée même d’une mesure de la
valeur, Say, Rossi, Cournot et Dupuit ont cherché, dans des voies diverses une solution.
Ces efforts les ont conduit à remettre en cause l’opposition entre valeur d’échange et
valeur d’usage telle que Smith l’avait conçu. Ainsi, une tradition française, certes bien
hésitante, se dessine face au classicisme anglais.
While proposing to measure wealth by its value, Smith begins a long debate in
which the French economists defend a position rather different from that of English
classics. Whereas Ricardo rejects even the idea of measurement of the value, Say,
Rossi, Cournot and Dupuit, in various ways, are looking for a solution. These efforts
lead them to call in question the opposition between exchange value and use value such
as Smith had conceived it. Thus, a French tradition, certainly quite blurred, takes shape
in front of the English classicism.
1 Alain Béraud, Théma, Université de Cergy-Pontoise, 33 boulevard du Port, 95 011 Cergy-Pontoise
Cedex, berau[email protected].fr

2

3
On oppose souvent les économistes français, qui ont toujours mis l’accent sur le
rôle de l’utilité dans la formation des prix, aux classiques anglais qui soutenaient que le
prix des produits est déterminé par leurs coûts de production. Cette interprétation du
développement de la pensée économique remonte à Jevons. Il pensait que, pour fonder
la science économique sur des bases solides, il était nécessaire d’abandonner la voie
qu’avaient suivie Ricardo et John Stuart Mill : « Pour parvenir au vrai système de
l’économie, le seul espoir est d’abandonner les hypothèses embrouillées et absurdes de
l’école ricardienne. Nos économistes anglais vivaient dans un paradis pour les fous. La
vérité est du côté de l’école française et plus tôt nous reconnaîtrons ce fait, le mieux ce
sera pour tout le monde sauf peut-être pour quelques écrivains qui se sont engagés trop
loin dans les anciennes doctrines erronées pour y renoncer. » (Jevons, 1971 : 67-8).
Dans les années 1870, l’analyse de Jevons fut le plus souvent acceptée. Marshall
(1890 : 676) soutint, au contraire, que les marginalistes avaient seulement complété le
corpus traditionnel d’analyse sans que l’on puisse parler d’une rupture profonde. Il ne
fut guère écouté et les historiens opposèrent les théories classique et néo-classique des
prix en soulignant leurs différences. Les économistes français du début du 19ème siècle
qui rejetaient la valeur travail et qui voyaient dans l’utilité l’origine de la valeur
apparurent nécessairement comme les précurseurs des « modernes ».
Par une de ces ruses dont l’histoire est coutumière, la tentative de Sraffa (1960)
pour reconstruire une théorie des prix de production qu’il présentait comme une
alternative à la théorie néo-classique conduisit à une remise en cause de la thèse de
Jevons. En effet, si les sraffaiens reprenaient à leur compte l’idée d’une opposition
radicale entre prix de production et prix d’équilibre, leurs adversaires soutenaient, au
contraire, que la théorie des prix de production n’était qu’un cas particulier de la théorie
néo-walrasienne. Dès lors, les analyses ricardiennes et néo-classiques cessaient
d’apparaître comme rivales et le fondement même de la première proposition de Jevons
s’effondrait. Samuel Hollander (1982 : 586) poussait jusqu’au bout la logique de
l’argument en soutenant que « les économistes classiques britanniques étaient d’accord
avec J. B. Say sur les questions de coûts d’opportunité et d’imputation. »
Cet article essaie d’apporter à la question de la « connexion française dans le
classicisme britannique » un début de réponse. Mon sentiment est qu’il faut rechercher
un autre angle d’attaque. Traditionnellement, on oppose la théorie des prix de
production à la détermination des prix par l’offre et la demande. À partir du moment où
l’on admet que l’existence de la rente implique que les prix de production sont
fonctions de la quantité produite, l’opposition est équivoque et la thèse d’Hollander doit
être acceptée. Mais, puisque le débat porte sur le rôle de la notion d’utilité dans
l’analyse économique, il est préférable de choisir comme domaine de comparaison la
théorie du bien-être où elle intervient de façon plus fondamentale que dans la théorie
des prix.
Le débat trouve sa source dans La Richesse des Nations. Smith y suggère que la
valeur de la richesse est l’expression de l’opulence de la nation ; quand elle augmente,
la nation est plus prospère ; quand elle diminue, la nation décline. Qui plus est, la
richesse permet d’analyser l’efficacité du système. S’il n’est pas possible d’accroître,
par une réallocation des ressources, la richesse, le système est efficace. La variation de
la richesse permet enfin d’analyser les effets d’une décision : elle est souhaitable si elle
augmente la valeur du produit.

4
Si cette thèse semble séduisante, ceux qui, comme Say, voulurent l’utiliser, se
heurtèrent à bien des obstacles. En particulier, si on prend le texte de Smith dans sa
littéralité, on peut penser qu’une hausse des prix, qui laisse inchangées les quantités
produites, entraîne une augmentation de la richesse. Say chercha, sans réel succès, à
éliminer ce paradoxe. Mais, en dépit de son échec, il orienta les discussions ultérieures
en mesurant l’augmentation des richesses que provoque une innovation, par les
économies qu’elle permet aux consommateurs de réaliser.
Ricardo rejeta tant les thèses de Smith que celles de Say. Évaluer une valeur
d’usage est, selon lui, impossible car son estimation varie d’une personne à l’autre. La
richesse ne peut être mesurée. Le problème est qu’on ne peut, alors, répondre à des
questions théoriques et empiriques importantes : par exemple, estimer l’avantage qu’un
pays tire d’un échange de biens de luxe ou de la construction d’un ouvrage public.
Les économistes français suggérèrent deux solutions différentes. Celle de
Cournot est dans la logique de Smith et de Say. Il distingue la richesse nominale de la
richesse réelle. Si la valeur du revenu, évaluée à prix constants, augmente, la richesse
réelle s’accroît. Toute mesure qui accroît la richesse réelle est souhaitable. La seconde
solution est celle de Dupuit. Elle repose sur la réinterprétation que Rossi avait proposée
de l’opposition entre valeur d’échange et valeur d’usage. La valeur en échange est
l’utilité qu’a un bien pour l’homme qui veut le vendre ; la valeur en usage est la valeur
qu’a un bien pour celui qui en a besoin. C’est le prix maximum que l’agent est disposé à
payer pour acquérir la chose qui en mesure l’utilité.
1. LA CONTROVERSE ENTRE RICARDO ET SAY
« Un homme est riche ou pauvre selon les moyens dont il dispose pour se
procurer les biens nécessaires, commodes et agréables à la vie humaine » écrit Adam
Smith (1776 : 47). Il ajoute, toutefois, « il [l’homme] doit être riche ou pauvre selon la
quantité de ce travail qu’il peut commander, ou qu’il est en mesure d’acheter. La valeur
d’une marchandise, pour la personne qui la possède et qui ne souhaite pas l’utiliser ou
la consommer elle-même, mais qui veut l’échanger contre d’autres marchandises, est
donc égale à la quantité de travail qu’elle lui permet d’acheter ou de commander ». La
première proposition définit la richesse comme une collection de biens utiles, de valeurs
d’usage. La seconde propose de la mesurer par la valeur réelle des marchandises dont
elle se compose, c’est-à-dire par la quantité de travail qu’elle permet d’acheter. Si on
applique ces définitions à un homme, comme le suggère Smith, elles semblent
discutables. Si la quantité de chacun des biens que possède un homme double, ne doit-
on pas considérer qu’il est réellement plus riche même si, entre temps, le taux de salaire
monétaire a doublé ? Il ne commande pas plus de travail mais il commande plus de
biens. Peut-on mesurer de cette façon la richesse sociale ? On peut avoir un doute
puisque toute hausse du salaire monétaire, pour un niveau donné des prix des biens,
provoque une baisse de la richesse réelle alors que le sens commun suggère qu’une telle
variation modifie la répartition de la richesse sans la diminuer.
Dans le livre III de La Richesse des Nations, Smith applique les mêmes
définitions pour étudier les effets des restrictions aux importations. Il soutient que les

5
restrictions aux importations diminuent le revenu1. Si les autorités instaurent des droits
de douane, les individus sont incités à abandonner la production des biens autrefois
exportés pour produire, à la place, les produits qui étaient importés. On les détourne
ainsi de produire des biens de plus grande valeur pour fabriquer des objets que l’on
pourrait se procurer à moindre frais à l’étranger. « Il est certain qu’on diminue plus ou
moins la valeur du produit annuel [de l’industrie générale du pays]… Cette denrée
aurait pu être achetée avec une partie seulement des denrées, ou ce qui revient au même
avec une partie seulement du prix des denrées, que l’industrie employée par un capital
égal, aurait produite à l’intérieur, si on l’eût laissé suivre son cours naturel. » (Smith,
1776 : 457)
L’interprétation du texte de Smith est à l’origine du débat entre Ricardo et Say.
Ricardo n’accepte que la première idée de Smith : la richesse est un ensemble de
valeurs d’usage. Il se refuse à la mesurer. En effet, la valeur nominale du produit n’est
pas un indice de la richesse : ses variations reflètent, en partie, l’évolution du pouvoir
d’achat de la monnaie. Mesurer la richesse réelle par le travail qu’elle commande
entraîne des biais : la richesse de la nation diminue quand le taux de salaire augmente
même si le produit physique reste inchangé. Quand on utilise comme numéraire un
étalon ricardien, de nouveaux paradoxes apparaissent. En effet, un tel indice de la
richesse diminue quand les techniques de production s’améliorent. Ricardo conclut
qu’aucune mesure de la richesse n’existe car la richesse est un ensemble de valeurs
d’usage dont chaque homme fait une estimation qui lui est propre.
Say reste plus proche de la thèse défendue par Smith. Puisque pour acquérir un
bien tout homme doit en payer le prix, il suggère d’évaluer l’utilité d’un objet par son
prix. La valeur globale des biens mesure la richesse. Cette proposition ne va, cependant,
pas sans problème. On ne peut pas exclure qu’un progrès technique en augmentant la
quantité de biens produite induise une baisse de leurs prix et de la valeur globale du
produit.
1.1. La valeur des biens comme mesure de la richesse
Dans la première édition du Traité, l’idée que la richesse est un ensemble de
choses nécessaires, commodes ou agréables ne retient guère l’attention de Say. Il évite
l’expression « valeur d’usage » : il n’y a qu’une valeur, la valeur courante. Il préfère
parler d’utilité. La richesse est un ensemble de biens qui ont une valeur ; elle est
mesurée par la somme de la valeur des objets dont elle se compose. Dans la seconde
édition, il précise « la richesse est grande, quand la somme des valeurs dont elle se
compose est considérable. Elle est petite, si les valeurs le sont. » (Say, 1814, t. 1 : 2)
Si la richesse est la valeur du produit, une augmentation du prix des biens
accroît-elle la richesse ? La réponse ne peut pas être simple car la valeur est relative. Si
la valeur d’un bien augmente, celle de sa contrepartie diminue : la valeur totale des
produits reste inchangée (Say, 1803, t. 2 : 77). Mais, si on considère un homme dans ses
rapports avec les autres hommes, il faut admettre que sa fortune dépend grandement de
la valeur relative des biens. Il s’enrichit quand la valeur des biens qu’il produit ou qu’il
1 Les termes richesse et revenu sont synonymes chez Smith. Plus particulièrement, la richesse n’a pas la
dimension d’un stock que l’on opposerait au flux de revenu comme dans l’économie politique moderne.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%