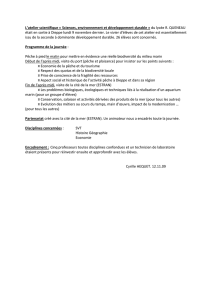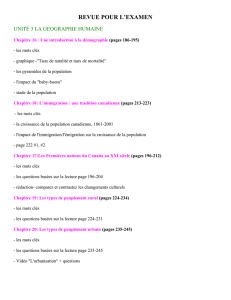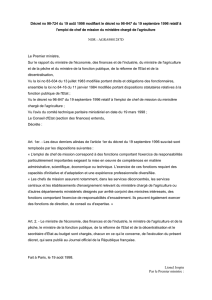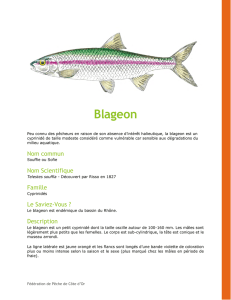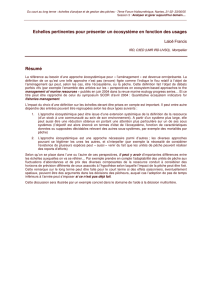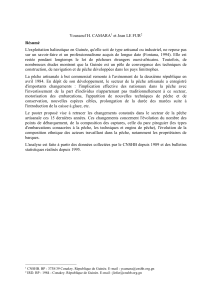Mutsamudu - Observatoire Villes Ports Océan Indien

Mutsamudu
(Comores)
OBSERVATOIRE VILLES PORTS OCEAN INDIEN
ANNEXE 06
Etude n°4
Etude de la
filière pêche
GRANDS
PÉLAGIQUES
dans les ports et les
villes portuaires de
l’océan Indien
Occidental.
2015
Etude n°4
Annexe 06

2

3

4

5
MUTSAMUDU
Les produits halieutiques constituent, avec les cultures d’exportation et les cultures vivrières,
l’essentiel de l’économie comorienne. La population est grande consommatrice de produits de la
mer qui peuvent constituer jusqu’à 90% de son apport en protéines. Les pêcheurs consacrent
entre 30% et 50% de leurs captures à l’autoconsommation, et la consommation moyenne de
poissons aux Comores est de 26kg/hab./an.
En 2011, le secteur de la pêche aux Comores a capturé 24 500 Tonnes de produits de la mer,
dont 19 500 Tonnes provenaient de la petite pêche, et 5 000 tonnes des pêcheries industrielles
étrangères (Smartfish, 2013). La pêche thonière industrielle aux Comores n’existe que dans le
cadre d’accords de pêche (APP) octroyés à des navires étrangers rattachés à l’Union européenne
et c’est moyennant des licences de pêche (estimation 735 000 US/an) que la ZEE du pays peut
être exploitée par ces flottes étrangères.
A l’exception du paiement pour des licences de pêche, le secteur de la pêche industrielle ne
procure aucun bénéfice direct à l’économie comorienne car sa production est débarquée dans
d’autres ports de la zone océan Indien sans transiter par les Comores. Cependant, une partie des
revenus des licences de pêche est redistribuée sur le territoire pour le développement du secteur
de la petite pêche à travers l’octroi de biens d’équipements.
La pêche nationale comorienne exclusivement artisanale, est pratiquée à bord de pirogues ou de
vedettes motorisées. Elle se concentre sur les espèces de thonidés autour des Dispositifs de
Concentration de Poissons (DCP) et sur les bancs libres dans un rayon de 25 miles des côtes
nationales, voire dans les eaux mozambicaines. Les 19 500 tonnes/an de captures issues de la
pêche nationale sont traitées par le mareyage local et commercialisées sur le marché national.
Les Comores (2170 km², 766.865 hab.), ou
l’Union des Comores est une république
fédérale d’Afrique australe située dans
l’archipel des Comores, au nord du canal du
Mozambique dans l’océan Indien.
L’archipel est composé de 4 îles, la Grande
Comore (Ngazidja), Anjouan (Ndzuani) Mo-
héli (Mwali) et l’île de Mayotte (Maoré), cette
dernière rattachée à la France mais
revendiquée par l’Union des Comores.
L’archipel détient un plateau continental et
une zone économique exclusive d’une surface
de 900km², où sont concentrés des stocks im-
portants de poissons de fond et pélagiques.
L’archipel des Comores a connu depuis 1975
de nombreux coups d’Etat et sécessions au
sein des différentes îles. Ce n’est que depuis
2008 que l’Union des Comores connaît une
stabilité politique et économique qui s’est
renforcée avec l’élection présidentielle en
2011. Ceci va favoriser le développement de
l’Union des Comores via différents projets
tels que la création de la Société Nationale de
Pêche (SNP) (CIA, 2013).
La croissance du PIB de l’Union des Comores
était de 3% en 2013. Elle est générée par les
investissements publics, les soutiens
financiers et les apports monétaires de la
diaspora comorienne, qui s’élèvent à environ
70 millions €/an, soit 15% du PIB national
pour 2011 (Smartfish, 2013). En outre les
Comores reçoivent des aides financières des
pays du Golfe et du Fonds Monétaire
International (FMI) pour soutenir l’économie
et assurer la stabilité du pays.
Plus de 80% de la population des Comores
dépend directement ou indirectement de
l’agriculture et de la pêche. En effet le secteur
primaire occupait 43.9% de la population en
2010 et le sous-secteur de la pêche 10%, soit
un total de 8 500 emplois fixes et environ
24000 emplois saisonniers (Smartfish, 2013).
!"# !
PIB
(2013 est.) 910 millions US$
PIB
per capita 1 300 US $
Chômage 13,5%
Revenu
na&onal 770 US $
Exporta&ons 19,7 millions US$
(CIA, WB 2013,BAD)
% du PIB (PPP) 4,3 %
% Emploi 6 %
SECTEUR
HALIEUTIQUE
PARTICIPATION DES
DIFFÉRENTS SECTEURS AU
PIB COMORIEN
DISTRIBUTION DES
PRODUITS HALIEUTIQUES
PAR FLOTTILLE
« La population est grande consommatrice de produits de la mer qui
peuvent constituer jusqu’à 90% de son apport en protéines.
Les pêcheurs consacrent entre 30% et 50% de leurs captures à
l’autoconsommation. »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%