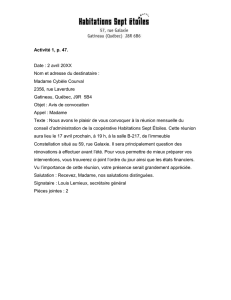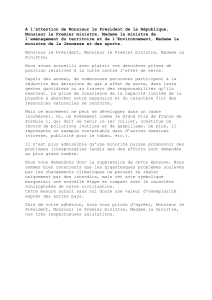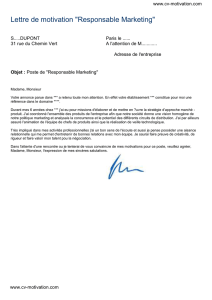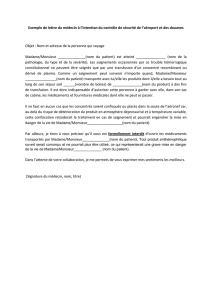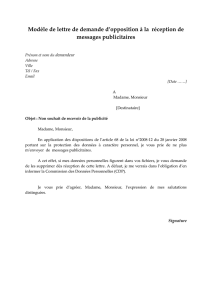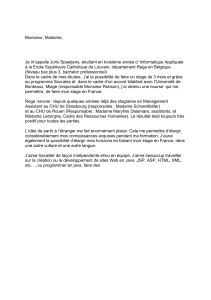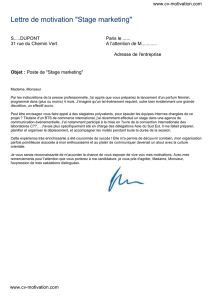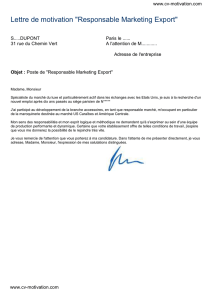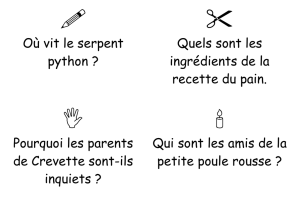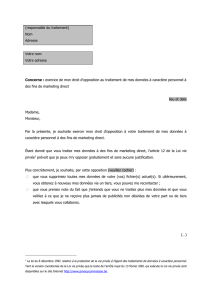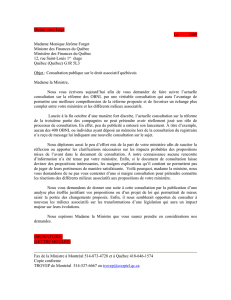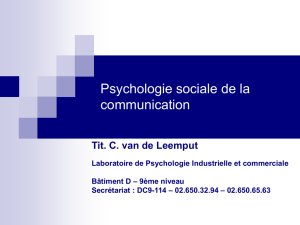LES ActEurS DE bonnE foi

’ÉD CAT OL U I NMAISON DE
Maison
de l'Éducation
des Yvelines
Dossier
pédagogique
LES ACTEURS DE BONNE FOI
de Marivaux
Mise en scène
Jean-Pierre Vincent
Lumières
Alain Poisson
Costumes
Patrice Cauchetier
Décor
Jean-Paul Chambas
Dramaturgie
Bernard Chartreux

CRDP
Académie de Versailles
Ce dossier pédagogique
destiné aux professeurs a été réalisé par
Caroline Jouffre,
professeur de lettres
relais de l’Inspection académique des Yvelines
auprès de la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Mars 2011. 2
Mise en scène
Jean-Pierre Vincent
Dramaturgie
Bernard Chartreux
Assistante mise en scène
et dramaturgie
Frédérique Plain
Décor
Jean-Paul Chambas
Assisté de Carole Metzner
Costumes
Patrice Cauchetier
Lumières
Alain Poisson
Madame Argante
Annie Mercier
Madame Hamelin
Laurence Roy
Araminte
Anne Guégan
Lisette
Claire Théodoly
LES ACTEURS DE BONNE FOI
Générique des Acteurs de bonne foi
Les premiers échos
Les caractéristiques de la pièce
Le contexte historique et littéraire
Composition de la pièce de Marivaux
Synopsis
Analyse des personnages
Analyse des principaux thèmes
La digression de Jean-Pierre Vincent
Analyse de la mise en scène
Scénographie
Costumes
Lumières
Son
Jeu des acteurs
Ressources
Les citations de l’œuvre sont extraites de
l’édition Classiques et cie, Hatier poche, n°75
Production – Studio Libre, Théâtre Nanterre-
Amandiers, Théâtre national de
Strasbourg.
Avec la participation du Jeune Théâtre National
et du FIJAD.

3
CRDP
Académie de Versailles
Générique des
Acteurs de bonne foi
Les premiers échos
On trouve la première trace des Acteurs
de bonne foi le salon de Mlle Quinault,
dite Quinault Cadette, en 1748. Françoise
Quinault du Frêne, dite Quinault cadette
(1701-1783), était une femme de théâtre
et excellente comédienne, très consultée
par les auteurs. Elle était la fille de Jean
Quinault, de la Comédie-Française, donc
enfant de la balle. Ses soupers étaient cé-
lèbres pour leur gaieté et leur esprit. Elle
traitait sur un même pied la noblesse et
les poètes crottés.
Elle possédait à 21 ans une grande ré-
putation de savoir et d’esprit et recevait
deux fois par semaine à dîner chez elle les
personnages les plus cultivés de Paris.
On peut citer parmi eux madame d’Épi-
nay, Marivaux, d’Alembert, Rousseau, Di-
derot ou encore Claude Crébillon.
On sait qu’en 1731-1732, elle prit l’ha-
bitude de réunir sept amis pour des sou-
pers fins agrémentés de représentations
théâtrales sous toutes ses formes (lanter-
ne magique, marionnettes, chiens savants,
satire personnelle …).
Il est donc possible que Les acteurs de
bonne foi ait été lu ou joué dans ce cercle
intimiste de lettrés.
On sait que Marivaux serait parvenu à
faire jouer sa pièce en 1755 au Théâtre
Français.
Or les registres de l’établissement in-
diquent que le Français faisait relâche ce
jour-là. Si Marivaux a pu donner sa pièce,
elle n’a obtenu que peu de succès car cette
éventuelle représentation n’a pas connu
de suite.
Enfin, Marivaux fait publier son texte
en novembre 1757 dans Le Conservateur.
Nous évoquerons plus loin le contexte lit-
téraire de 1757.
Pistes de travail
Comprendre le rôle des salons au
XVIIIe siècle. On demandera aux élèves de
chercher qui était Mademoiselle Quinault,
puis quels étaient les autres salons en
vogue à la même époque, tenus par des
« dames » (Madame Geoffrin, madame
du Deffand,mademoiselle de Lespinasse,
madame de Tencin par exemple). On leur
demandera qui était reçu dans ces salons, ce
qu’on y faisait et leur rôle social et littéraire.
Les caractéristiques de la pièce
Il s’agit d’une pièce en prose et en un
acte. C’est une œuvre tardive si on la situe
dans la vie et l’œuvre de Marivaux (1688-
1763).
Marivaux est assez familier des piè-
ces courtes en un acte. On peut citer Le
père prudent et équitable (1706), Arlequin
poli par l’amour (1720), Le Dénouement
imprévu (1724), L’île des esclaves (1725),
L’Héritier du village (1725), La Nouvelle Co-
lonie (1729), perdue puis réécrite sous le
titre de la Colonie (1750), La réunion des
Amours (1730), L’École des mères (1732),
La méprise (1734), Le legs (1736), La joie
imprévue (1738), Les Sincères (1739),
L’épreuve (1740), La commère (1741), La
Dispute (1744), Le préjugé vaincu (1746),
La femme fidèle (1755), Félicie (1757)
et La Provinciale (1761). Ces pièces sont
toutes écrites en prose à l’exception de la
première.
Pistes de travail
Découvrir d’autres pièces courtes de
Marivaux. On demandera aux élèves de
choisir, parmi les titres indiqués en rouge
(choisis car ce sont les plus joués et les
plus connus), une autre pièce de Marivaux.
Après une lecture personnelle de l’œuvre,
ils en proposeront une analyse qui résumera
l’intrigue, présentera les personnages et les
thèmes principaux et enfin établira les points
communs avec Les acteurs de bonne foi.

4
CRDP
Académie de Versailles
Le contexte historique
et littéraire
Contexte historique
Louis XV, au pouvoir depuis 1723, n’est
plus Louis le Bien-aimé. En 1757, il vient
d’échapper à un attentat fomenté par le
domestique Robert François Damiens qui
lui reproche d’oublier ses devoirs et de
mener une politique trop réformiste. Ces
reproches révèlent le climat de tension en
France dû aux difficultés financières et aux
incessants conflits (guerres de succession
et guerre de Sept ans). Le parlement s’op-
pose à la fiscalité royale et veut plus de
libertés, influencé par les idées des philo-
sophes des Lumières.
À cela, s’ajoute des conflits religieux
(les jésuites sont sur la sellette et l’on se
querelle encore à propos du jansénisme).
Contexte littéraire
Marivaux fait publier son texte en 1757,
en plein cœur de la querelle à propos du
théâtre, entre Rousseau et d’Alembert.
Dans son article « Genève » de l’En-
cyclopédie, d’Alembert proposait aux
austères protestants genevois d’intro-
duire dans leur cité un peu de fantai-
sie en y implantant un théâtre.Il faisait
tout son possible pour donner ses lettres
de noblesse (ou plutôt de morale) à ce
divertissement.
Rousseau, dans sa longue Lettre à
d’Alembert sur les spectacles, souligne les
dangers des spectacles dans les villes qui
ont encore des mœurs.
D’Alembert répondra à son tour à Rous-
seau dans une « Lettre à Rousseau ».
Pistes de travail
Comprendre l’esprit des Lumières. On
peut donner ce tableau aux élèves comme
point de départ. Outre les noms des princi-
paux philosophes, il leur fournira quelques
œuvres clés. Les élèves pourront par groupe
réaliser des exposés sur chacune de ces œu-
vres : leur contenu et leur portée.
Comprendre la querelle sur le théâtre.
On peut placer en parallèle les différentes
querelles littéraires (querelle des modernes
et des anciens au XVIIe siècle et querelle
au sujet du drame romantique par exemple
au XIXe siècle) et constater à quel point
elles ont marqué des ruptures dans la créa-
tion littéraire. On demandera aux élèves de
compléter les informations sur la querelle
autour du théâtre en lisant des extraits des
lettres de Rousseau et d’Alembert. L’objectif
est de leur faire prendre conscience des
idées philosophiques et politiques qui
sont derrière cet échange épistolaire.
Réaliser un travail d’écriture. Un jour-
naliste observe la querelle entre Rous-
seau et d’Alembert et rédige après coup un
pamphlet sur leurs relations épistolaires.
Composition de la pièce
écrite par Marivaux
Synopsis
La pièce se décompose en 13 scènes. La
didascalie initiale évoque « une maison
de campagne de madame Argante ». Mer-
lin donnera sa comédie dans « une salle »
qu’il faudra mettre en état et qui sera le
lieu unique de toute l’intrigue. Le divertis-
sement est prévu pour « trois heures après
midi », la pièce commence donc dans la
matinée.
Le siècle des Lumières, des philosophes
Montesquieu, Lettres Persanes, 1721
Voltaire, Zadig, 1747
Voltaire, Candide, 1759
1750 à 1765 publication de l’Encyclopédie
Rousseau, Discours sur l’origine de
l’inégalité, 1755
Rousseau, Le Contrat Social, 1762

5
CRDP
Académie de Versailles
Scène 1 : lors de la scène d’exposition, as-
sez traditionnelle, Merlin s’entretient avec
Éraste. Deux informations essentielles sont
données : Éraste va épouser Angélique,
fille de madame Argante. C’est un mariage
d’amour ; Éraste bénéficie des grâces de
sa tante madame Hamelin, il s’unit à une
jeune fille riche.
Ils mettent au point le divertissement
donné à l’occasion du mariage pour plai-
re à madame Hamelin ; madame Argante
ignore tout de ce projet. Les acteurs se-
ront Merlin lui-même et des gens de ma-
dame Argante. Par ailleurs, il s’agit d’un
impromptu, seul le canevas sera fourni aux
comédiens qui inventeront.
Scène 2 : Merlin accueille ses comédiens,
donne des conseils à chacun sur son rôle.
Le canevas proposé consiste à ce que Co-
lette, une coquette promise à Blaise, se
laisse conter fleurette par Merlin, lui-
même promis à Lisette. On devine déjà
des réticences chez les uns et les autres à
jouer les dupés.
Scène 3 : la répétition commence avec
Lisette et Merlin tandis que Blaise et Co-
lette y assistent en tant que spectateurs.
Le ton monte : Lisette frotterait bien la
joue de l’impertinente qui fait de l’œil à
son promis.
Scène 4 : dans la scène suivante, Merlin
se trouve face à Colette qui se montre trop
vite entreprenante au grand désespoir de
Blaise et sous le regard courroucé de Li-
sette.
Scène 5 : Blaise ne comprend plus rien et
confond théâtre et réalité. Il prend pour
argent comptant ce qui se joue sur scène.
Colette, complice de Merlin, assure qu’elle
est prête à rompre ses fiançailles pour par-
tir avec Merlin. S’en suit force dispute.
Scène 6 : madame Argante, alarmée par le
bruit, vient aux nouvelles. Merlin et Éraste
sont bien obligés de lui avouer leur « pe-
tit dessein …. Une bagatelle … Une petite
pièce … Une comédie ». Mais madame Ar-
gante s’oppose vivement à ce projet « chez
une femme de son âge ». Elle est persua-
dée que madame Hamelin se rangera à son
avis.
Scène 7 : madame Hamelin revendique la
paternité de cette idée mais plie cepen-
dant devant madame Argante, contrariée.
Scène 8 : madame Hamelin expose son
nouveau dessein à son amie Araminte :
« c’est qu’au lieu de la lui donner, il faudra
qu’elle me la donne ». Elle feindra de re-
fuser Éraste à Angélique et de lui préférer
Araminte, riche et encore jeune. Nul, en
dehors d’Araminte, ne saura le rôle qu’il
joue. Le metteur en scène a changé, le ca-
nevas aussi mais nous assistons toujours
à un impromptu joué par des acteurs de
« bonne foi ».
Scène 9 : Éraste rejoint sa tante et Ara-
minte. On lui apprend qu’il épousera Ara-
minte et ses trente mille livres de rentes.
Il est désespéré.
Scène 10 : madame Argante est à son tour
informée des nouveaux projets de madame
Hamelin. La situation lui échappe : elle est
prête à faire donner cette comédie, à jouer
dedans …. Mais que ce mariage ait lieu !
Scène 11 : dans la confusion la plus to-
tale, madame Argante tente de faire jouer
l’impromptu de Merlin. Elle dispute même
Araminte de son peu de raison et de sa
courtoisie : elle vole le fiancé d’une autre
en affichant le double de son âge.
Scène 12 : madame Argante attend la co-
médie de Merlin. Les comédiens reviennent
sur scène mais Blaise ne veut plus jouer,
sa mère le lui ayant défendu. Il n’apprécie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%