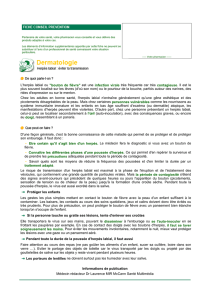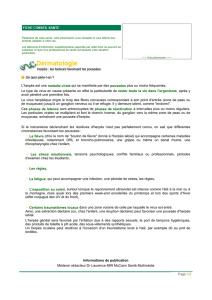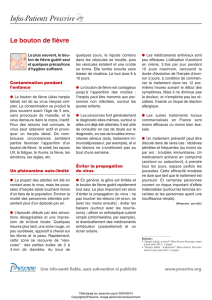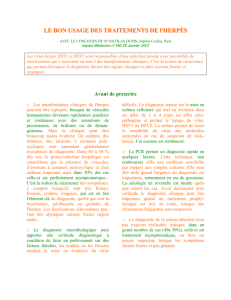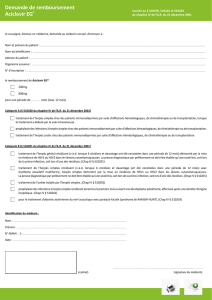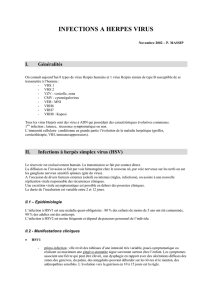Compte-rendu de la première réunion de la requête

Requête primaire – Plainte d’un adulte pour herpès labial
23, rue de Paris – 92 110 Clichy
en collaboration avec le
avec le soutien du laboratoire
RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE OFFICINALE
REQUETE PRIMAIRE
Prise en charge d’un patient adulte se plaignant d’un
herpès labial ou « bouton de fièvre »
ARGUMENTAIRE
Juin 2010

Requête primaire – Plainte d’un adulte pour herpès labial
- 2 -
23, rue de Paris – 92 110 Clichy
Correspondance : Comité pour la Valorisation de l’Acte Officinal
JenWin
23, rue de Paris
92 110 Clichy
© JenWin SA. Tous droits réservés.
Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour
tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit
du présent ouvrage, faite sans l'autorisation de JenWin est illicite et constitue une
contrefaçon. Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seules
sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les courtes citations
justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont
incorporées.
Ce document a été finalisé en juin 2010 ; le protocole et la fiche de comptoir
correspondants destinés à la pratique officinale peuvent être demandés auprès du
laboratoire ratiopharm.

Requête primaire – Plainte d’un adulte pour herpès labial
- 3 -
23, rue de Paris – 92 110 Clichy
Sommaire
Rationnel de la recommandation…………………………………………………..……………4
Position du Groupe de travail
Contexte…………….……………………………………………………………………………….5
Contexte épidémiologique et clinique de la requête
Virus de l’herpès
Prévalence de l’herpès labial
Les différentes formes d’herpès labial et son évolution
Enjeux sanitaires
Facteurs déclenchants
Conclusions du Groupe de travail
Traitement de l’herpès labial.…………………..………………………………………….…9
Efficacité des traitements disponibles en médication officinale
Médication à déconseiller
Traitement préventif des récurrences
Conclusions du Groupe de travail
Eléments d’orientation concernant la requête……...….…………………..………………10
Principes de la recommandation……………………………………..…………….…..……..11
Objectifs sanitaires
Critères de qualité de la dispensation
Erreurs évitables et critères de qualité de la dispensation correspondants
Indicateurs de pratique
Recommandation « Prise en charge d’un patient adulte se plaignant d’un herpès
labial ou « bouton de fièvre »…………………………….…………………………………….16
Avant la dispensation
La dispensation
Les suites de la dispensation
Les outils complémentaires visant à améliorer la démarche
Bibliographie………………………………………………………………………………………20
Annexes…………………………………………………………………………………………….21
Groupe de travail…………………………..…………………………...………………………..24

Requête primaire – Plainte d’un adulte pour herpès labial
- 4 -
23, rue de Paris – 92 110 Clichy
Rationnel de la recommandation
L’herpès labial est une pathologie bénigne récurrente. Les signes cliniques en sont souvent
connus du client de l’officine qui fait une demande de conseil ou de spécialité.
Néanmoins cette demande fréquente comporte deux risques potentiels :
- une première poussée révélatrice d’une pathologie sous-jacente
- une erreur dans l’autodiagnostic du client.
L’équipe officinale se doit d’éviter ces deux risques dans le temps qui lui est imparti pour un
conseil de cet ordre. Il lui incombe également de limiter le risque de récidive.
Position du Groupe de travail
Le pharmacien et son équipe ne doivent pas établir eux-mêmes un diagnostic.
En revanche, ils sont dans l’obligation de valider l’autodiagnostic du client pour
permettre l’automédication.
Ils s’abstiendront donc de délivrer une médication spécifique si l’autodiagnostic du
client n’est pas sûr.

Requête primaire – Plainte d’un adulte pour herpès labial
- 5 -
23, rue de Paris – 92 110 Clichy
Contexte
Contexte épidémiologique et clinique de la requête
Virus de l’herpès
Les herpès simplex virus (HSV) sont des virus à ADN appartenant à la famille des
herpesviridae. L'espèce humaine en est le seul réservoir ; la transmission est interhumaine.
Il en existe 2 types : HSV1 et HSV2.
HSV1 et HSV2 peuvent infecter toute région cutanéomuqueuse. L'épidémiologie des
infections à HSV1 se modifie, car elles surviennent plus tardivement et concernent de plus
en plus souvent la région génitale1.
L’herpès est une pathologie récurrente : le virus n’est pas éradiqué et persiste toute la vie
dans les noyaux de cellules des ganglions sensitifs. Cette infection latente peut évoluer
périodiquement vers une réactivation1.
Prévalence de l’herpès labial
La séroprévalence HSV1 est estimée aujourd’hui à moins de 20 % chez les enfants de 5
ans et de 40 à 60 % entre 20 et 40 ans dans les pays développés. La primo-infection
survient donc plus souvent dans une population d'adultes jeunes1.
Les récurrences de lésions dues au HSV-1 sont courantes ; 20 à 40 % environ des
personnes infectées par le HSV1 connaîtront des épisodes récurrents d’herpès labial après
une primo-infection buccale3.
Les différentes formes d’herpès labial et son évolution
L’herpès orofacial récurrent siège avec prédilection sur le bord externe d’une lèvre.
D’autres localisations sont décrites : vestibule narinaire, menton, joue. Il existe des formes
atypiques : gingivostomatite diffuse, ulcération orale unique, glossite1.
La primo-infection
Le premier contact a souvent lieu dans la petite enfance. Il passe inaperçu dans 90 % des
cas. La sévérité des formes symptomatiques est variable. La primo infection peut causer de
la fièvre, une gingivostomatite (érosions des gencives et de l'intérieur des joues) ou une
pharyngite qui peut être confondue avec une angine bactérienne. La durée moyenne des
signes fonctionnels (douleurs, gêne à l’alimentation) est de 7 jours, celle des lésions de 10
jours. Dans les formes pharyngées du nourrisson, une dysphagie sévère peut exposer à
une déshydratation.
La première poussée symptomatique
Une première poussée peut être une primo-infection, mais c’est le plus souvent une
première récurrence symptomatique. Elle doit bénéficier d’un diagnostic médical, afin d’en
cerner la nature exacte. Elle peut être l’événement révélateur d’une immunodépression,
auquel cas, en l’absence de prise en charge médicale, le retard de diagnostic entraînera
une perte de chance.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%