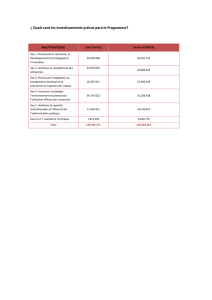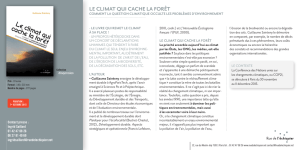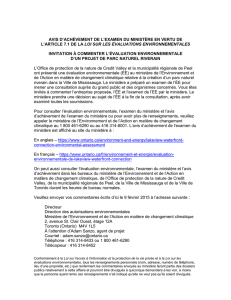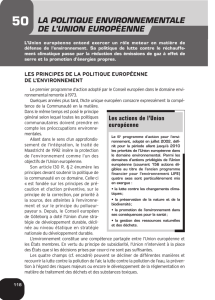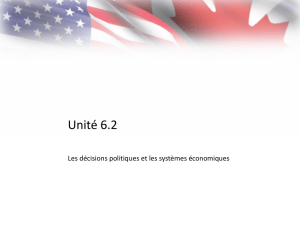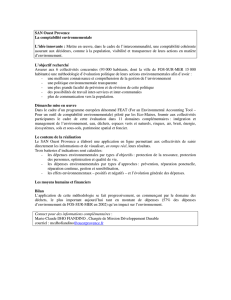Environnement et Compétitivité : une stratégie globale pour l`Europe

Études
environnement et compétitivité : une stratégie globale pour l’europe
Sous la direction d’Elvire Fabry
et de Damien Tresallet
ENVIRONNEMENT ET COMPÉTITIVITÉ
une stratégie globale pour l’europe
fondation pour l’innovation politique

ENVIRONNEMENT ET COMPÉTITIVITÉ
une stratégie globale pour l’europe
Sous la direction d’Elvire Fabry et de Damien Tresallet
fondation pour l’innovation politique

fondation pour l’innovation politique
137, rue de l’Université | 75007 Paris – France
Tél. : 33 (0)1 47 53 67 00 | Fax : 33 (0)1 44 18 37 65
E-mail : contact@fondapol.org | Site Internet : www.fondapol.org
2008 – ISBN 978-2-917613-21-4

sommaire
Présentation. Quel rôle l’Union européenne peut-elle jouer dans la régulation de la mondialisation ?
Elvire Fabry ........................................................................................................................................................................7
En guise d’introduction. Quel cadre de gouvernance mondiale pour la stratégie européenne ?
Damien Tresallet ..............................................................................................................................................................9
partie i
environnement ou compétitivité :
un dilemme encore irrésolu en europe .........................................................................................19
L’Union européenne et l’environnement : une force normative dans la mondialisation
R. Daniel Kelemen ........................................................................................................................................................21
La préférence environnementale européenne : un « patchwork » de modèles nationaux
Frédéric Allemand ....................................................................................................................................................... 34
Pour une stratégie environnementale innovante : analyse et perspectives
Åsa Persson ..................................................................................................................................................................... 46
Les éco-innovations, un levier pour la compétitivité des entreprises
Sylvie Faucheux ............................................................................................................................................................ 59
partie ii
analyse des politiques environnementales et perspectives
aux états-unis, en chine et en inde ....................................................................................................73
Les États-Unis et l’environnement : quelles perspectives pour la coopération internationale ?
Paul G. Harris ................................................................................................................................................................ 75
Un modèle de croissance en réexamen : vers une Chine plus verte ?
Benoît Vermander ........................................................................................................................................................ 88
L’approche indienne face au changement climatique : légitime mais peu avisée ?
Lavanya Rajamani ......................................................................................................................................................101
Conclusion. Pour une stratégie environnementale européenne pragmatique
Elvire Fabry, Damien Tresallet ..............................................................................................................................114
Les auteurs ..................................................................................................................................................................... 127

présentation
quel rôle l’union européenne peut-elle jouer
dans la régulation de la mondialisation ?
Au printemps 2007, la Fondation pour l’innovation politique a entrepris d’analyser la percep-
tion que les opinions publiques européennes ont de la mondialisation. Son étude Les Européens
face à la mondialisation, réalisée à partir d’un sondage effectué dans huit États membres de l’UE,
aux États-Unis, au Japon et en Russie et d’une étude qualitative menée dans chacun des huit États
européens concernés, a révélé de grands contrastes entre les pays qui regardent la mondialisation
comme une opportunité et ceux qui y voient davantage une force de contrainte et qui la craignent.
La majorité des citoyens des États membres étudiés exprimaient néanmoins une forte demande
de régulation de la mondialisation et une attente spécique à l’égard de l’Union européenne pour
qu’elle favorise et encadre cette régulation. Les citoyens ont de plus en plus conscience que la mon-
dialisation d’un certain nombre d’enjeux exige, en contrepartie, une réponse européenne.
La Fondation pour l’innovation politique a entrepris de poursuivre en 2008 sa réexion sur
la capacité de l’UE à faire émerger une régulation progressive de la mondialisation en s’attachant
à l’enjeu spécique de la protection de l’environnement et de la lutte contre le changement clima-
tique, qui fait l’objet d’un fort consensus chez les citoyens européens : l’enquête Eurobaromètre de
mars 2008 indique en effet que 80 % d’entre eux souhaitent que l’UE aide les États tiers à améliorer
leurs normes environnementales. Ils attendent de l’UE qu’elle joue un rôle moteur à l’échelle inter-
nationale dans ce domaine.
Alors que le protocole de Kyoto arrive à échéance en 2012 et que deux conférences des Nations
unies, à Poznań en décembre 2008 et à Copenhague en décembre 2009, visent à permettre aux
partenaires commerciaux de préparer un nouvel accord international, l’attention des experts mobi-
lisés dans cet ouvrage s’est portée sur les enjeux de compétitivité qui sont liés à une politique
environnementale ambitieuse. Celle-ci suppose plus que jamais que l’UE renforce le dialogue avec
les pays émergents pour qu’une redistribution de la puissance sur la scène internationale s’accom-
pagne d’un partage des responsabilités. L’étude examine ainsi les instruments mis en place par les
Européens et les réactions des partenaires commerciaux de l’UE à ses exigences de régulation, pour
esquisser les bases d’une stratégie environnementale pragmatique qui soit un levier de compétiti-
vité pour les entreprises européennes.
Elvire Fabry
Directeur Europe-International, Fondation pour l’innovation politique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
1
/
124
100%