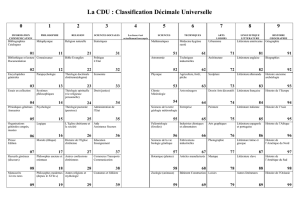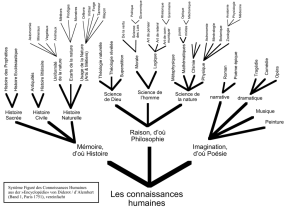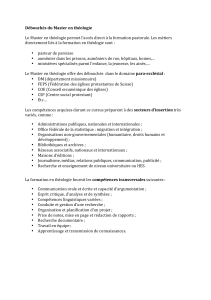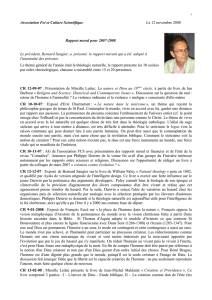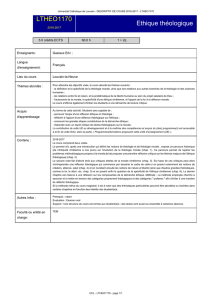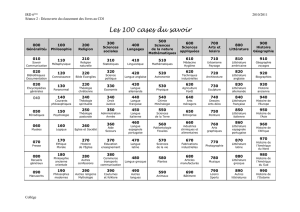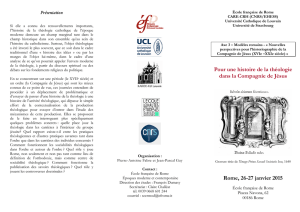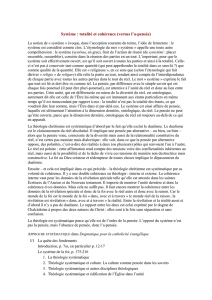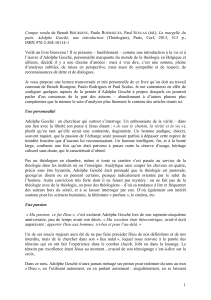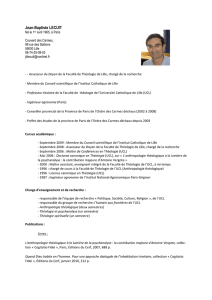Benoît BOURGINE, Paulo RODRIGUES, Paul SCOLAS (dir)

Benoît BOURGINE, Paulo RODRIGUES, Paul SCOLAS (dir), La margelle du puits. Adolphe Gesché, une
introduction, (Coll Théologies), Paris, Cerf, 2013, 510 p. 21,3 x 13,5, ISBN 978-2-204-10114-1, 35€.
Cet ouvrage collectif d’une douzaine d’auteurs présente l’œuvre magistrale d’un théologien
parmi les plus éminents du XXème siècle, Adophe Gesché, professeur à la Faculté de Théologie de
Louvain à Louvain-la-Neuve. Adolphe Gesché est né à Uccle (Bruxelles) en 1928. Il obtint une licence
en Philosophie et Lettres avec spécialisation en philologie classique à l’Université Catholique de
Louvain. Ordonné prêtre en 1955, docteur et maître en théologie, il fut professeur de théologie au
grand séminaire de Malines puis à l’Université Catholique de Louvain. Il mourut en 2003. Son œuvre
théologique majeure Dieu pour penser se compose de 7 volumes (Le mal, L’homme, Dieu, Le cosmos,
La destinée, le Christ, Le sens) dont la publication aux éditions du Cerf (Paris) s’étale de 1993 à 2003.
Dans une deuxième partie, après ces éléments de biographie, l’ouvrage présente le projet
théologique de Gesché, son style, sa manière de le conduire dans le champ des questions du monde
d’aujourd’hui. Le projet théologique de Gesché est non seulement de rendre Dieu pensable en cette
période de postmodernité mais de montrer que le Dieu de la foi chrétienne peut même aider à
penser l’homme, le mal, l’histoire, le cosmos. L’ambition de l’œuvre de Gesché est que la foi
chrétienne, après avoir écouté le monde, puisse en être écoutée : « Le monde peut écouter la foi
parce que la foi lui dit ce qu’il est, en vérité. Toute l’œuvre de M. Gesché est le témoignage de cette
vérité » (J. Ladrière, p.91). Gesché reconnaît la puissance de la raison humaine et l’honore autant
qu’il peut, mais il souligne avec insistance le fait que la raison humaine a ses limites et ne pourrait
donc s’enfermer sur elle-même dans une suffisance qui la rendrait incapable d’écoute, de révélation
et de visitation. Pour Gesché, « le mot et aussi l’idée de Dieu existent et gardent précisément parmi
les hommes une ouverture sur l’excès » (P.Scolas, p.118). La révélation de Dieu, singulièrement en
son Témoin incomparable, Jésus qui aima jusqu’à l’extrême, auquel toute l’Ecriture rend témoignage,
appartient à cet excès et constitue le « lieu natal » de la théologie. Celle-ci tient ses droits et sa
spécificité de ce lieu natal. Elle ne pourrait être colonisée par la philosophie bien qu’elle ne puisse
s’en passer comme « servante » et aussi comme « gouvernante » au sens où la philosophie demeure
dans le champ théologique une instance critique qui « assure sa cohérence parmi les discours
humains ». « La raison voit mieux et plus clair lorsqu’elle consent à recourir aux ressources de la
religion, qui lui fournit le recul de la transcendance » (B.Bourgine, p.140).
A l’instar de la révélation elle-même, la posture du théologien, pour Gesché, doit être
dialogale. Gesché entend jusqu’au bout le monde. Il cite volontiers les philosophes, écrivains ou
psychanalystes. En retour, il espère que « la foi et la théologie aient part aussi et de plein droit à
l’invention culturelle » (Gesché, p.153). Le langage théologique ne peut être différent du langage de
l’homme auquel il s’adresse. Gesché entend défendre et justifier l’intuition chrétienne en la rendant
intelligible, lisible pour l’homme contemporain. Son projet, en ce sens, est apologétique, non point
qu’il veuille rendre la foi chrétienne nécessaire pour l’homme - l’humanité, en effet, peut se tenir
sans Dieu – mais, au moins, la faire entendre et éprouver comme salutaire dans l’ordre d’une grâce
qui advient par excès.
Ainsi, la foi et la théologie proposent-elles à l’homme un chemin de bonheur : « un bonheur
fondé qu’il reçoit d’un Autre comme don et comme un accomplissement de sa vie, et qui s’exprime
par le mot salut » (P.Rodrigues, p.311). La théologie est au service du salut de l’homme. La foi, en ce
sens, ne peut être reçue et entendue que si elle éveille le goût de vivre, le goût de croire en soi, en la
vie, en Dieu. La question de Dieu et la question de l’être humain s’intersignifient. La théologie se doit
de montrer combien la foi chrétienne peut être bonne, éclairante, salutaire pour l’homme ; sinon
celle-ci sera vouée à l’insignifiance et à l’oubli. « Je suis né théologiquement, écrit Gesché, en une
période où Dieu était proclamé comme un danger pour l’homme (Sartre). J’aurai montré qu’il était
au contraire une chance pour l’homme : une preuve de l’homme » (p.93). Retrouver Dieu comme
une bonne nouvelle, tel est son projet théologique.
Ainsi, par exemple, les théologies de la mort de Dieu sont pour Gesché l’occasion d’une
redécouverte du Dieu vivant, au-delà des images idolâtriques que l’on peut s’en faire. Un des aspects
déterminants de son œuvre consiste précisément à dénoncer les fausses représentations de Dieu

qui faussent l’homme. La vérité du message chrétien et du discours théologique s’éprouve dans
l’excellence de l’humain qu’ils promeuvent. Les théologies de la libération sont précisément à situer
dans la perspective d’une humanisation intégrale ou, en d’autres termes, du salut ; celui-ci étant
entendu non point seulement comme ce qui est à la portée de l’homme, mais aussi comme ce qui est
toujours donné en excès, gratuitement, de manière inattendue, au-delà de ce que nous pouvons
imaginer.
Dans une troisième partie, l’ouvrage décline plus en détail un ensemble de thèmes qui ont
particulièrement retenu la réflexion du théologien : l’homme, Dieu, le mal, le cosmos, le Christ. La
quatrième partie reproduit un article significatif d’Adolphe Gesché « Éloge de la théologie » ainsi
qu’un texte « Théologie et modernité » de Jean Ladrière, philosophe réputé, son contemporain et
collègue à l’Université Catholique de Louvain.
Toute l’œuvre théologique d’Adolphe Gesché est d’avoir montré que l’homme est un être
« visité » par Dieu qui se révèle à lui par grâce et lui ouvre une destinée incomparable, au-delà de ce
qu’il pouvait imaginer par lui-même. L’œuvre de Gesché fera date dans l’histoire de la théologie.
Parmi ses limites, on pointe le plus souvent l’absence de considérations ecclésiales et son silence sur
l’émergence de la pluralité des croyances dans la société occidentale. Notons que le fichier personnel
de travail d’Adophe Gesché rassemblant quelque 55.000 fiches sur quelque 1.500 thèmes est
disponible sur internet à l’adresse http://www.uclouvain.be/355397.html. On trouvera aussi, à la fin
de l’ouvrage, une bibliographie exhaustive du théologien.
Ont collaboré à l’ouvrage, outre les trois directeurs de publication, Bérangère DEPREZ, Jean-
François GOSSELIN, Olivier RIAUDEL, Jean LECLERCQ, Benoît LOBET, Jean-Michel MALDAME, Martin
LEINER, François EUVE et Jean LADRIERE.
André Fossion s.j.
Professeur au Centre International d’Etudes de la Formation religieuse LUMEN VITAE,
Bruxelles, Belgique.
1
/
2
100%