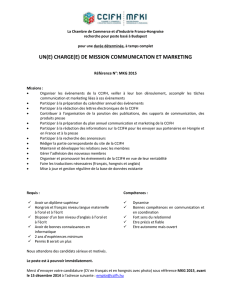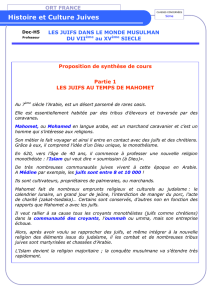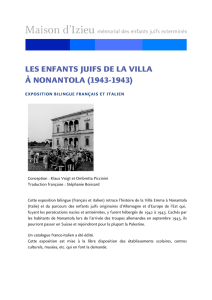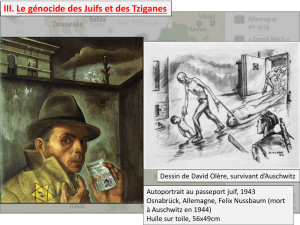La Hongrie et les Juifs. De l`âge d`or à la destruction

Published on Encyclopédie des violences de masse (http://ww
w.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance)
La Hongrie et les Juifs. De l’âge d’or à la destruction,
1895-1945
Cet article a été traduit par Odile Demange, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah [1]
La persécution des Juifs de Hongrie, qui a culminé avec la tentative de destruction de l’intégralité de
la communauté juive du temps de la Seconde Guerre mondiale, s’est caractérisée par sa rapidité et
son intensité au cours des derniers mois du conflit. L’Holocauste des Juifs de Hongrie a été une «
joint-venture » qui a opéré pendant la période d’occupation de ce pays par les Allemands, sous la
conduite de ces derniers, mais avec une participation non négligeable de citoyens hongrois.
Entre le milieu du XIXe siècle et la fin de l’Holocauste, la place des Juifs dans la société de la Hongrie
moderne en gestation a fait l’objet de débats extrêmement sérieux parmi les Hongrois eux-mêmes.
Les désaccords sur les possibilités d’intégration des Juifs dans l’État-nation émergent étaient
nombreux. On distinguait pour l’essentiel trois conceptions rivales de leur rôle dans la société
hongroise : 1) la revendication inconditionnelle d’égalité des droits pour les Juifs ; 2) la volonté de
subordonner l’émancipation des Juifs à leur assimilation au sein de la nation hongroise ; 3) le refus
pure et simple de leur accorder l’égalité sous prétexte que leurs traits de caractère invétérés
interdisaient toute assimilation.
Lors du compromis de 1867 qui fonda la double monarchie austro-hongroise, l’élément libéral de
l’élite hongroise l’emporta et les Juifs de Hongrie obtinrent, à titre individuel, l’intégralité des droits
juridiques. Le judaïsme en tant que religion était « toléré », sans être pour autant sur un pied
d’égalité avec le christianisme : les chrétiens ne pouvaient pas s’y convertir, les Juifs ne pouvaient
pas légalement épouser des chrétiens, sauf en se convertissant au christianisme. Ce n’est qu’en
1895, au terme de trois années d’intenses débats parlementaires, que le judaïsme devint une «
religion reçue », obtenant ainsi d’être traité d’égal à égal avec le christianisme. Lorsque le projet de
loi à cet effet fut enfin mis aux voix, il fut adopté à l’unanimité. 1 En outre, durant la période qui
précéda le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les magnats juifs de la banque, du
commerce et de l’industrie commencèrent à avoir leurs entrées dans les plus hautes sphères,
surtout s’ils se convertissaient au christianisme. Dans les annales de la communauté juive hongroise,
cette période est considérée comme un âge d’or au cours duquel les Juifs purent prospérer.
Néanmoins, un groupe non négligeable de Hongrois continuaient à estimer qu’il restait aux Juifs à
prouver qu’ils étaient de bons Hongrois en rejetant tous les vestiges de leur judéité, tandis que
d’autres demeuraient convaincus qu’aucune assimilation n’était possible. Sans être dominant,
l’antisémitisme n’avait donc pas disparu.
Le scepticisme quant à l’aptitude des Juifs à se fondre entièrement dans le tissu national hongrois
était particulièrement fort parmi ceux qui faisaient l’apologie du passé et rejetaient le monde libéral
émergent. De fait, ceux qui s’opposaient à ce dernier considéraient les Juifs comme ses agents
privilégiés. Le Katolikus Néppárt (parti catholique populaire) était peut-être la formation politique la
plus importante à professer ce point de vue. Ce phénomène n’était pas réservé à la Hongrie et
trouvait des équivalents dans d’autres pays européens, à l’image de l’Allemagne et de la France.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale et du démembrement de l’empire austro-hongrois, la
Hongrie ressurgit sous forme d’État-nation, à l’intérieur de frontières extrêmement resserrées
officialisées par le traité de Trianon, qui fut signé le 4 juin 1920. La perte des deux tiers de sa
population et de plus des deux tiers de son territoire représentait un grave coup dont les
répercussions se feraient sentir dans le discours hongrois durant de longues années. Au cours de sa
première année tumultueuse d’existence en tant qu’État autonome, la Hongrie fut en proie à une
grande instabilité. Comme en Allemagne, l’inflation monta en flèche et la gauche radicale
Page 1 of 15

Published on Encyclopédie des violences de masse (http://ww
w.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance)
bolchevique chercha à prendre le pouvoir. Le 21 mars 1919, avant même la signature du traité de
Trianon, elle réussit à établir à Budapest une République hongroise des soviets, qui se maintint au
pouvoir pendant plus de six mois. Ses membres se livrèrent à des actes de violence contre ceux
qu’elle percevait comme ses adversaires, parmi lesquels des Juifs hongrois. Béla Kun, ministre des
Affaires étrangères, était la figure majeure de la République. De père juif, Kun représentait aux yeux
de bien des Hongrois l’incarnation même du judéo-bolchevisme. L’idée que, si tous les bolcheviks
(communistes) n’étaient pas juifs, tous les Juifs étaient bolcheviques et que le bolchevisme
s’inscrivait dans un complot juif visant à l’hégémonie, fut très répandue dans une grande partie de
l’Europe centrale et orientale après la révolution bolchevique de Russie en 1917.
Durant l’été 1919, avec l’encouragement des Alliés occidentaux vainqueurs, les Roumains et, dans
une moindre mesure, les Tchèques lancèrent une offensive contre le régime des soviets. En
novembre, les forces étrangères contrôlaient l’essentiel de la Hongrie. Cependant, aux yeux de
l’opinion publique, le mérite d’avoir mis fin à la République des soviets revenait moins aux forces
étrangères qu’aux contrerévolutionnaires hongrois de droite.
Ces contrerévolutionnaires étaient connus comme « les hommes de Szeged » et leur idéologie
politique réactionnaire présentée comme l’« idée de Szeged ». L’amiral Miklos Horthy s’affirma
bientôt comme le commandant et le chef des forces armées contrerévolutionnaires. Tandis que la
République hongroise des soviets s’effondrait, les hommes de Horthy se livrèrent à des actes de
terreur contre ceux que l’on accusait d’être liés au régime bolchevique abhorré, ce qui hâta encore
la chute de celui-ci. Des milliers d’individus furent victimes de ce qu’on appelle aujourd’hui la Terreur
blanche.
Dans la mesure où Béla Kun et plusieurs autres éminentes personnalités de son cercle étaient juifs
ou d’origine juive, la Terreur blanche s’accompagna d’un puissant déferlement d’antisémitisme. De
nombreux Juifs furent purement et simplement assassinés, tandis que d’autres étaient victimes de
passages à tabac. Bien que la plupart des Hongrois aient considéré la République des soviets comme
juive et aient continué à défendre cette idée plusieurs dizaines d’années après sa chute, l’écrasante
majorité des Juifs ne s’identifiait pas avec le régime des soviets, et ne le soutenait pas. Par ailleurs,
de nombreux Juifs étaient de fervents patriotes hongrois, convaincus en tant que tels que les Juifs et
les élites gouvernantes de Hongrie partageaient des intérêts communs. Certains Juifs restèrent
fidèles à cette idée pendant toute la période de l’entre-deux-guerres et au-delà.
Le 1er mars 1920, Horthy devint régent du royaume (chef d’État), remplaçant ainsi le roi de Hongrie
qui ne fut pas rappelé sur le trône par l’Assemblée nationale hongroise. De toute évidence, Horthy
n’eut jamais la moindre intention de rendre les rênes du pouvoir au monarque déposé, pas plus qu’à
un nouveau souverain, quel qu’il fût. Le traité de Trianon, qui privait la Hongrie d’une grande partie
de son territoire ancestral, fut signé le 4 juin 1920 et ratifié le 13 novembre de la même année.
Désormais, la droite fit de la révision de ce traité et de la reconquête du territoire hongrois perdu un
de ses chevaux de bataille, un programme rapidement adopté par le courant d’opinion dominant.
Dans la Hongrie tronquée de l’entre-deux-guerres, dépouillée de l’essentiel de ses nationalités
d’autrefois, les Juifs devinrent la minorité la plus vulnérable. En 1920, la Hongrie abritait un tout petit
moins d’un demi-million de Juifs, qui composaient approximativement six pour cent de la population.
C’était la deuxième communauté juive la plus importante d’Europe après celle de la Pologne. Les
Juifs hongrois constituaient probablement la fraction la plus instruite de la société hongroise. Bien
que la plupart d’entre eux aient appartenu à la classe moyenne et aient exercé une activité dans le
commerce, les petites entreprises, l’artisanat et les professions libérales, certains Juifs occupaient
également une position éminente dans la vie artistique et intellectuelle ; on trouvait même un
groupe restreint mais non négligeable de propriétaires fonciers. Les deux tiers des Juifs se
réclamaient du judaïsme néologue (plus ou moins équivalent du judaïsme conservateur américain),
un peu moins de 30 % étaient orthodoxes, les autres appartenant à une tendance dite « du statu
quo ante » regroupant des communautés juives qui ne se sentaient liées ni aux néologues, ni aux
orthodoxes. Les Juifs de Hongrie étaient magyarophones et la plupart s’identifiaient fortement avec
la nation hongroise. Le nationalisme juif, le sionisme, était plutôt marginal à l’époque et ne gagnerait
du terrain que pendant les années de guerre. Bien que les Juifs n’aient représenté que 6 % de la
population et se soient profondément identifiés avec la Hongrie, la « question juive » occupait une
large place dans le discours public, en même temps que la lutte pour recouvrer les territoires
Page 2 of 15

Published on Encyclopédie des violences de masse (http://ww
w.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance)
perdus. Dans l’esprit populaire, les Juifs passaient fréquemment pour être la cause de la chute de la
Hongrie. 2
La législation antijuive dans l’entre-deux-guerres
En septembre 1920, le gouvernement Horthy adopta un numerus clausus qui plafonnait les effectifs
d’étudiants juifs pouvant être admis dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce plafond
était fixé à 6 % du nombre total d’étudiants, soit le pourcentage de Juifs au sein de la population de
la Hongrie réduite de l’entre-deux-guerres. Cette mesure reflétait la « voie chrétienne » adoptée par
l’administration, qui cherchait à limiter la place des Juifs dans la vie publique sans nuire
excessivement à l’économie du pays. Cette mesure blessa la fierté de nombreux Juifs hongrois, et
incita un grand nombre de jeunes Juifs à partir faire leurs études à l’étranger. 3
En avril 1921, le comte István Bethlen devint Premier ministre et il resta en fonction jusqu’en 1931.
Au cours de cette période, les autorités n’appliquèrent pas la loi antijuive avec une grande rigueur.
Bethlen était plus soucieux de conserver le soutien des responsables juifs de l’industrie et de la
banque dans ses efforts pour revitaliser l’économie hongroise que d’exécuter cette loi restrictive à la
lettre. Le comte Gyula Károlyi, qui succéda à Bethlen au poste de Premier ministre, suivit son
exemple dans ce domaine.
En octobre 1932, Guyla Gömbös, un ancien officier qui avait fait partie des hommes de Szeged,
devint Premier ministre. Il nourrissait des idées farouchement antisémites. Pourtant, pendant son
mandat qui dura jusqu’à sa mort en 1936, il réfréna souvent sa rhétorique antisémite en public, car
en ces temps de grave dépression mondiale, il avait besoin de l’aide de la communauté juive pour
faire face à la situation économique du pays. Gömbös n’en prépara pas moins en coulisse le terrain à
de nouvelles lois antijuives. Non content d’espérer restreindre encore les droits des Juifs, il avait
l’ambition d’établir un État fasciste en Hongrie. Il mourut avant d’avoir pu réaliser cet objectif.
Gömbös réussit cependant à favoriser une politique étrangère plus favorable à l’Allemagne. Les
tendances germanophiles des gouvernements hongrois entre le début des années 1930 et la fin de
la Seconde Guerre mondiale jouèrent un rôle majeur dans l’évolution des persécutions subies par les
Juifs hongrois. Les dirigeants hongrois souhaitaient coopérer avec Hitler, sans pourtant tomber
entièrement dans l’orbite de l’Allemagne. Nombre d’entre eux espéraient qu’en collaborant avec
l’Allemagne, ils obtiendraient la restitution des territoires arrachés à la Hongrie après la Première
Guerre mondiale ; d’autres en revanche continuaient à se méfier de l’hégémonie allemande,
craignaient d’être entraînés dans une guerre coûteuse ou se sentaient politiquement et
culturellement bien plus proches de la Grande-Bretagne que de l’Allemagne. Avant l’adoption de la
Solution Finale, la persécution des Juifs telle que la pratiquait le régime de Horthy contentait Hitler et
servait plus ou moins de soupape de sécurité dans les relations germano-hongroises ainsi qu’à
l’égard des éléments les plus à droite de Hongrie. En revanche, quand l’extermination massive et
systématique des Juifs fut érigée en politique officielle de l’État nazi, le gouvernement hongrois n’en
fit pas suffisamment aux yeux d’Hitler et de ses cohortes, pas plus qu’à ceux des extrémistes
hongrois. Ils n’obtiendraient satisfaction qu’en 1944 avec l’occupation de la Hongrie par les
Allemands lesquels, avec la coopération des Hongrois, envoyèrent les Juifs à la mort. 4
Après le décès de Gömbös en 1936, son successeur, Kálmán Darányi, imposa une législation contre
les Juifs inspirée du travail préparatoire de Gömbös. Darányi démissionna en mai 1938 avant
l’adoption du projet de loi, adopté sous son successeur, Béla Imredy, le 29 mai 1938. Ce qu’on
appelle la première loi antijuive limitait à 20 % la place des Juifs dans l’économie et dans les
professions libérales de la Hongrie.
La deuxième loi antijuive fut adoptée le 4 mai 1939 sous le gouvernement du Premier ministre Pál
Teleki et appliquée le lendemain. Elle réduisait encore la place des Juifs dans la vie économique
hongroise, fixant un plafond à 6 %. La loi définissait comme Juifs ceux qui se déclaraient comme tels
ou qui avaient un parent ou deux grands-parents membres de la communauté juive à cette date. La
loi ne s’appliquait cependant pas à ceux qui étaient nés chrétiens, dont les parents étaient chrétiens
au moment de leur mariage ou qui s’étaient convertis avant le 1er janvier 1939. Cette dérogation
concernait également les soldats blessés sur le front, ou ceux qui avaient obtenu une ou plusieurs
Page 3 of 15

Published on Encyclopédie des violences de masse (http://ww
w.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance)
médailles pour acte de bravoure, les veuves et les enfants des soldats morts à la guerre, les
participants à la contrerévolution et ceux qui travaillaient comme conseillers de la cour, professeurs,
prêtres, ecclésiastiques ou qui étaient champions olympiques. La classe moyenne inférieure, les
artisans, les employés de bureau et la plupart des membres des professions libérales furent en
revanche touchés de plein fouet par les effets de cette loi. Celle-ci élargit le fossé entre riches et
pauvres et accéléra l’appauvrissement de la communauté juive dans son ensemble. 5
La troisième loi antijuive, adoptée le 23 juillet 1941 sous le gouvernement de Lászlo Bárdossy et
promulguée le 8 août de la même année, se rapprochait davantage des lois nazies de Nuremberg
dans son ton et dans sa définition raciale des Juifs. Comme la loi de Nuremberg initiale, elle
interdisait le mariage entre Juifs et non Juifs, ce qui lui valut d’être couramment surnommée loi de
protection raciale. Selon Nathaniel Katzburg, elle devint une des clés de voûte du processus
d’exclusion et d’élimination des Juifs de la société hongroise. 6
D’autres restrictions législatives imposées aux Juifs hongrois avant l’occupation nazie en mars 1944
supprimèrent les derniers vestiges de l’émancipation qui leur avait été accordée au siècle précédent.
Un projet de loi voté le 19 juillet 1942 abolissait ainsi le statut de « religion reçue » dont avait joui le
judaïsme en Hongrie, tandis qu’une loi promulguée le 6 septembre 1942 interdisait aux Juifs
d’acquérir des propriétés agricoles et exigeait le transfert des biens juifs à des non Juifs. 7
L’alliance avec l’Allemagne nazie et la guerre
Durant la période où furent adoptés les projets de lois antijuives, la Hongrie commençait à voir se
réaliser ses vœux de restitution des territoires perdus à Trianon grâce à ses liens plus étroits avec
l’Allemagne nazie. La partie méridionale de la Slovaquie fut transférée à la Hongrie le 2 novembre
1938 peu après les accords de Munich, en vertu de ce qu’on a appelé le premier arbitrage de Vienne.
La Ruthénie subcarpathique 8, qui appartenait la République tchécoslovaque depuis la Première
Guerre mondiale, fut rendue à la Hongrie le 15 mars 1939, quand les Allemands réalisèrent le
démembrement de la Tchécoslovaquie. Finalement, grâce à un accord signé par le ministre allemand
des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop et par son homologue italien, le comte Galeazzo
Ciano, et avec l’accord réticent de la Roumanie, la Transylvanie du Nord fut placée sous domination
hongroise en vertu du deuxième arbitrage de Vienne, le 30 août 1940. Alors que l’Allemagne d’Hitler
inspirait une profonde aversion et une vive méfiance à certains membres des classes dirigeantes,
ceux-ci acceptèrent, par reconnaissance pour la restitution de ces territoires et par crainte de l’Union
soviétique, que la Hongrie se range de plus en plus clairement dans le camp allemand.
Bien que la Hongrie ait été le premier pays à rejoindre le pacte tripartite entre l’Allemagne, l’Italie et
le Japon le 20 novembre 1940, l’armée hongroise ne s’engagea pas aux côtés de l’Allemagne nazie
durant les dix-huit premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que lorsque Hitler fit
miroiter à ses responsables la possibilité de reconquérir une autre partie de leur ancien territoire
désormais placé sous le joug de leur allié formel, la Yougoslavie – la région de Délvidék, formée de
Bácska et de Baranya, aujourd’hui respectivement en Serbie et en Croatie – que la Hongrie entra en
guerre. Pour le Premier ministre Teleki, qui éprouvait un fort sentiment d’échec sur de nombreux
fronts, la trahison de la Yougoslavie, ancienne alliée de son pays, fut probablement le coup fatal qui
le poussa au suicide. 9 Le nouveau Premier ministre, László Bárdossy, fit franchir la frontière
yougoslave aux forces hongroises le 11 avril 1941, cinq jours avant le début de l’invasion allemande
de la Yougoslavie, pour s’emparer d’un territoire abritant plus d’un million d’habitants, dont plus du
tiers étaient des Hongrois de souche. 10
En 1941, après ces gains territoriaux, le recensement révélait que la Grande Hongrie abritait 725
000 habitants de confession juive. Au moment de l’entrée en vigueur de la Troisième loi juive
définissant comme Juifs ceux qui avaient trois ou quatre grands-parents juifs quelle que fût la
religion qu’ils pratiquaient, les autorités hongroises répertoriaient 786 555 personnes comme juives.
Selon Tamás Stark, qui a effectué les recherches les plus approfondies à cette date sur les données
démographiques juives en Hongrie, il y avait peut-être jusqu’à 820 000 individus concernés par cette
définition raciale des Juifs à la veille de l’entrée en guerre de la Hongrie contre l’Union soviétique,
dans le courant de l’été 1941. 11
Le 27 juin 1941, invoquant le bombardement de Kosice (Kassa) et Mukachevo (Munkács) qu’ils
Page 4 of 15

Published on Encyclopédie des violences de masse (http://ww
w.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance)
reprochaient à l’aviation soviétique, les Hongrois envoyèrent pour la première fois des troupes
au-delà de la frontière avec l’Union soviétique, rejoignant ainsi l’armée d’invasion allemande qui
était intervenue une semaine auparavant. Comptant pour finir 90 000 hommes, cette force servit
essentiellement en Ukraine et dans une partie de l’actuelle Biélorussie. En raison de pertes
relativement lourdes, d’un équipement obsolète et d’un manque évident d’enthousiasme, les
Hongrois comme les Allemands acceptèrent de retirer l’essentiel des troupes hongroises à la fin de
l’automne 1941. 12
Au début de 1942, Hitler réclamant plus de troupes, la Seconde Armée hongroise fut envoyée au feu.
13 Dans le courant de l’année, le nombre de membres du personnel militaire hongrois dans la zone
de guerre atteignit plus de 200 000 hommes, parmi lesquels entre 32 000 et 39 000 travailleurs
forcés juifs. 14 En juin 1942, les troupes allemandes marchèrent sur le Don dans l’espoir que
l’essentiel des forces allemandes réussirait finalement une percée dans le Caucase. L’avancée des
Allemands sur Belgorod créa une brèche de plus de 700 km. Les alliés de l’Allemagne – Hongrois,
Roumains et Italiens – furent chargés de s’accrocher à ce territoire. On interposa les Italiens entre les
soldats hongrois et roumains pour éviter les querelles, voire les conflits ouverts, entre ces groupes
rivaux. 15Le secteur hongrois de la ligne de front dessinait un contour très mince au nord de
Stalingrad sur 180 km, avec la ville de Voronej au centre. 16
D’autres forces hongroises étaient stationnées derrière les lignes de front, dans le cadre de l’armée
d’occupation. Elles étaient essentiellement chargées de maintenir l’ordre et de préserver l’ouverture
des voies de ravitaillement des troupes de l’avant. Les activités des partisans, surtout dans les forêts
situées au sud de Briansk, ne leur facilitaient cependant pas la tâche. Lorsque arriva l’été 1942, les
Hongrois collaboraient étroitement avec le secret militaire allemand pour venir à bout des activités
de résistance. 17
L’offensive soviétique à Stalingrad commença le 19 novembre 1942. Pris dans une poche, les
Allemands furent littéralement réduits à la famine durant des combats qui comptèrent parmi les plus
violents de toute la guerre, et prirent essentiellement la forme d’une guérilla urbaine maison par
maison, dans le froid indescriptible de l’hiver russe. La bataille s’acheva par la défaite allemande, le
2 février 1943. 18
Dans le contexte des combats sur le front de Stalingrad, les troupes soviétiques se livrèrent à une
attaque contre Voronej les 12 et 30 janvier 1943, infligeant de lourdes pertes aux forces hongroises.
Au deuxième jour de l’offensive, l’Armée Rouge creusa dans les lignes hongroises une brèche de 10
km de large sur 12 km de profondeur. Par un froid de – 45°C, les armes s’enrayaient et les troupes
étaient transies. Se repliant dans la plus grande confusion, les soldats en fuite prirent la direction
générale de Kiev, où l’armée hongroise anéantie se réorganisa au mois de mars. 19
Les pertes hongroises lors de la débâcle de Voronej et de ses répercussions immédiates sont
estimées à quelque 80 000 hommes. 20 Environ 5 000 chevaux (principal moyen de transport pour
rejoindre le front) trouvèrent la mort et l’intégralité des armes lourdes de l’infanterie, l’essentiel des
pièces d’artillerie et du matériel technique lourd, des camions et des chars, furent perdus en même
temps que d’importantes quantités de nourriture, d’uniformes, de brodequins et de munitions. 21
Entre le mois d’août 1943 et l’été 1944, les Soviétiques repoussèrent les Hongrois en direction des
Carpates. Le 22 juin 1944, trois ans jour pour jour après l’invasion allemande de l’Union soviétique,
l’Armée Rouge mena une offensive de grande envergure, l’Opération Bagration, et à la fin août
1944, les Soviétiques se battaient en territoire hongrois. 22 Le 17 janvier 1945, toute la partie de la
capitale hongroise appartenant à Pest tomba aux mains des Soviétiques, et les quartiers de Buda
subirent le même sort le 12 février.
Le système du Service du travail
Le système du Service du travail, mis sur pied sous l’égide de l’armée hongroise, regroupa
finalement plusieurs dizaines de milliers d’hommes que les autorités jugeaient « peu fiables » et
indignes de porter des armes. Il s’agissait notamment des représentants de nombreuses minorités,
de socialistes, de communistes et d’autres adversaires du régime de droite. Les Juifs étant,
Page 5 of 15
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%