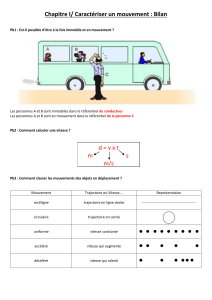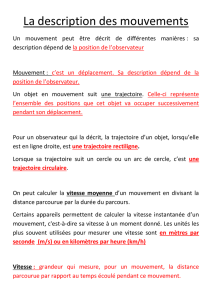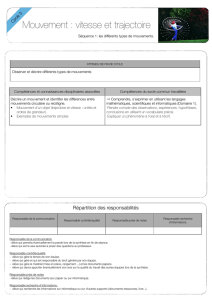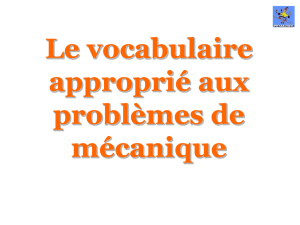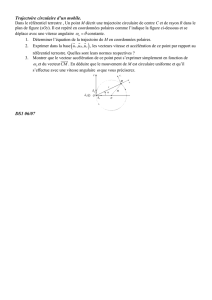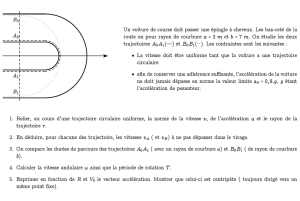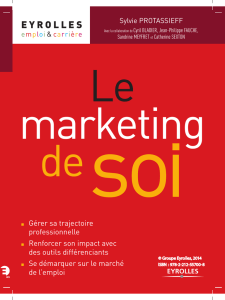Postface. L`individualité – entre logique et historicité. Philippe

Postface. L’individualité – entre logique et historicité.
Philippe Huneman et Guillaume Lecointre
Comme le notent d'entrée de jeu Julie Henry et Barthélémy Durrive, « individu » est moins un
concept philosophique qu’un « jeton » dans ce qu’il est convenu de nommer depuis
Wittgenstein un jeu de langage. Autrement dit, autant il est clair que le mot « individu » est
convoqué dans de nombreuses problématiques et controverses philosophiques –
individualisme méthodologique versus holisme en théorie sociale, individualisme versus
culturalisme en anthropologie, individualisme en économie et en philosophie morale, etc. -,
autant il semble évident qu’il n’existe pas de conception de l’individu qui soit univoque ou
unanime. Surtout, une telle conception n’est jamais nécessaire pour que les thématiques et les
débats qu’on vient d’évoquer puissent se déployer, le terme « individu » y faisant ainsi figure
de boîte noire, de signifié embrouillé et opaque qu’on utilise mais qu’on va s’abstenir
d’expliciter, peut-être même parce qu’on en est incapable... L’individu, ainsi, est pour la
pensée davantage un « philosophème » qu’un concept (au sens où l’Etat, le corps, la loi, etc.,
seraient, eux, des concepts philosophiques, qui donnent lieu à des théories parfois rivales,
mais qui ne sauraient fonctionner dans des élaborations conceptuelles sans qu’une
explicitation minimale en soit fournie). Reste que de nombreuses philosophies ont voulu en
produire une ; il serait même fastidieux ou impossible d’être exhaustif, et ce n’est pas le
propos1.
Le livre qu’on vient de lire s’est, lui, placé sous l’évident patronage de Spinoza et de
Bourdieu : deux pensées pour lesquelles l’individu – l’individu quel qu’il soit, pour l’un,
l’individu social pour l’autre – existe au croisement des rencontres qu’il est amené à faire,
dans un univers dont la contingence relève simplement, en général, de l’ignorance des causes
en action. Deux pensées, donc, dans lesquelles il s’agit l’individu humain ne trouve sa seule
liberté qu’en apprenant à connaître les déterminismes qui sous-tendent ces rencontres : pour
quel parti voterai-je ?, à quels partenaires vais-je choisir de m’unir ?, quelle carrière vais-je
embrasser ?, etc.
Dans la perspective spinoziste qu’en un sens Bourdieu aura importée dans les sciences
sociales, l’individu humain est indissociablement l’objet d’une ontologie et d’une éthique :
une ontologie qui décline les modalités sous lesquelles l’unique substance du monde est une,
univoque et sans faille ; une éthique qui consiste à réfléchir la meilleure manière de vivre les
rencontres que l’individu est conduit à faire, et dans lesquelles sa nature l’amène à réagir
d’une façon spécifique. En ce sens, plusieurs auteurs du présent livre en viennent à souligner
qu’on est bien moins un individu qu’on ne le devient, si l’individu au sens plein est bien celui
qui non seulement reste lui-même en chacune de ses rencontres, mais davantage encore, se
construit selon ces rencontres, selon un impératif que Barthélémy Durrive trouve mieux
encore affirmé, à l’époque contemporaine, par Canguilhem dans le champ de la philosophie
de la médecine que par Bourdieu dans celui des sciences sociales. Dans cette perspective
l’éthique consiste, pour reprendre les termes du présent ouvrage, à renverser l’attitude passive
initiale en une attitude active vis-à-vis de sa trajectoire.
Notre postface pourrait alors être l’occasion d’interroger dans son entier cette perspective
spinoziste de l’individualité, telle qu’elle s’énonce aussi bien dans l’éthique des relations
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dans la philosophie analytique récente on mentionnera le livre majeur de Strawson, Individuals, 1959 et,
l’ouvrage de Wiggins, Sameness and substance – parce que les individus peuvent métaphysiquement être
considérés comme des substances individuelles.

soignant-soigné, dans l’analyse de l’amitié que dans l’ontologie du hasard et de la nécessité
revisitée par la théorie de l’ontophylogénèse développée par Jean-Jacques Kupiec, et qui
s’avère centrale dans ce livre.
Pour ce faire, on peut aussi bien demeurer dans le monde des philosophies classiques pour
faire un petit pas de côté par rapport à Spinoza et s’inspirer de la pensée de cet autre grand
cartésien que fut Leibniz. On sait que le système leibnizien, pour lequel Parallélisme et
Expression sont des catégories ontologiques majeures, identiques à celles qui gouvernent
l’Ethique de Spinoza (l’expression de la substance par ses attributs, le parallélisme entre
modes, etc.), n’a eu de cesse de trouver des moyens de se démarquer de cet encombrant
double – le spinozisme – dont la mauvaise réputation durant un siècle ou deux était bien
suffisante pour gâcher la carrière sinon la vie d’un penseur. On sait aussi qu’une des
rencontres les plus célèbres de l'histoire de la pensée occidentale, entre Leibniz et son aîné
Spinoza, semble avoir essentiellement porté sur des questions d’optique plutôt que de
métaphysique, et illustrerait ainsi, curieusement, l’idée qu’on peut se faire de ce qu’est une
rencontre ratée (Le livre ancien de George Friedman, Leibiz et Spinoza rapporte en détail ces
faits, et les relations qu’en fit bien plus tard Leibniz, soucieux de se préserver de tout
rapprochement avec Spinoza).
Malgré cette proximité avec la perspective spinoziste, Leibniz semble nous offrir une pensée
alternative de l’individu dans son rapport avec ses rencontres. On peut s’y référer pour
comprendre ce que serait une approche logique de l’individu, avec laquelle l’insistance sur
l’histoire et la trajectoire pourrait faire un intéressant contraste.
Que dit en effet Leibniz ? Tout part de la doctrine dite de l’inesse, l’inhérence du sujet au
prédicat. Si un jugement est vrai, c’est parce que le prédicat est contenu dans le concept du
sujet. Par exemple, « Adam est un homme » est vrai parce que dans le concept d’Adam est
donné qu’il n’est pas un chat ou un castor mais bien un homo sapiens sapiens. Autrement dit,
un prédicat nommant une propriété, et une substance étant toujours dans la phrase en position
de sujet, la doctrine leibnizienne de la vérité signifie que les propriétés sont toujours en
quelque sorte contenues dans le concept de la substance qui a ces propriétés (Discours de
Métaphysique). En d’autres termes, si l’on prend une substance individuelle, c’est-à-dire un
individu – cette étoile, moi-même, un ours polaire – ce qui lui arrive (et est nommé par ses
prédicats) est toujours contenu dans son concept. Cela seul fait la différence entre un énoncé
vrai sur cet individu, et un énoncé faux (qui lui attribuerait alors des propriétés situées en
dehors de son concept). Ainsi, il appartient à la « notion » de César – ainsi que Leibniz
nomme le concept dans les Lettres à Arnaud, où ces idées sont exposées avec soin -, que
César ait franchi le Rubicond. La connexion entre l’individu et ce qui lui arrive, ce qu’on
appelle ici ses rencontres, est logique.
Notons qu’il s’agit bien ici de logique et d’ontologie – non pas de physique, autrement dit,
Leibniz se place sur un plan différent de celui auquel on situe généralement la question du
déterminisme : il ne veut pas dire que de toute éternité il était inscrit dans l’histoire du monde,
en vertu de ses lois naturelles et de ses conditions initiales, que César franchirait le Rubicon –
mais il dit simplement que le concept de « Jules César » comprend le concept de « franchir le
Rubicond », donc qu’on peut déduire ce dernier d’une connaissance totale du concept de
« Jules César ».
Dans cette perspective, la trajectoire de l’individu n’est jamais une suite de contingences qui
l’affecteraient – elle est au contraire l’expression de sa « notion complète ». La thèse logique

de Leibniz sur la vérité – l’inesse - implique en quelque sorte sur le plan métaphysique
l’internalisation de la trajectoire de l’individu dans la notion même de cet individu. Saisies
comme interactions d’individus, les rencontres doivent alors être conçues comme le fait que
deux (ou davantage) individus partagent un même monde puisque chacun est inscrit dans
l’essence de l’autre ; une thèse qui se prolonge dans la vision expressivité de Leibniz, selon
laquelle chaque individu authentique exprime le monde et tous les autres individus à sa
manière, thèse appelée encore monadologie2.
Vision certes difficile à saisir, peu intuitive, mais qui a l’immense avantage théorique
d’éliminer le problème consistant à comprendre pourquoi certaines rencontres semblent
toucher intimement l’individu tandis que d’autres lui seraient indifférentes, et ainsi de tracer
une ligne qui séparerait ce qui est vraiment l’individu et sa vraie trajectoire, de ce qui n’est
qu’accidentellement lui. Les rencontres ne sont pas un hasard qui tomberait sur un individu
complètement défini indépendamment d’elles; et elles ne sont pas non plus les effets d’un
déterminisme dans lequel l’individu est simplement affecté du dehors par des contraintes
irrémissibles. A l’inverse de ces deux figures théoriques de l’extériorité de l’individu et de sa
trajectoire (vue comme déclinaison de ses rencontres), Leibniz nous offre donc la vision d’une
complète intériorisation de la trajectoire dans l’individu.
En termes contemporains, cette métaphysique pourrait évoquer une notion de « trajectoire »
banale en sciences de la nature, mais peu présente dans l’ouvrage qu'on vient de lire – à savoir
l’idée qu’un système décrit une trajectoire dans l’espace des phases, descriptible comme
l’ensemble des variations de chacun des paramètres qui le décrivent. Ainsi pour un système en
mécanique trois coordonnées de vitesses et trois coordonnées spatiales définissent ainsi un
espace de phase, et chaque état du système pouvant être représenté par un point de cet espace,
la trajectoire du système est en déplacement dans cet espace. Ici, puisque tous les paramètres
qui définissent le système sont des coordonnées de cet espace, si bien que le système lui-
même n’a aucune définition en dehors de celui-ci, l’essence du système se confond avec sa
trajectoire, – de même que chez Leibniz ce qui arrive à l’individu n’est jamais que
l’expression de sa notion complète.
L’analogie a sans doute ses limites. Autant la trajectoire dans l’espace des phases est-elle un
outil majeur pour comprendre non seulement la mécanique classique, mais aussi la mécanique
statistique (où le système se déplace a priori dans un hyper espace très grand, des états les
moins probables vers les états les plus probables qui par définition ont une entropie plus
haute), l’écologie ou même certains aspects de l’économie tels que l’éconophysique3, autant
elle ne présuppose pas les engagements théoriques propres à la Monadologie leibnizienne, et
qu‘il nous faut expliciter maintenant.
En premier lieu, l’individu leibnizien, emportant dans son essence ou sa notion l’idée de tout
ce qui lui arrive, ne saurait être intégralement connu par notre propre appareil cognitif.
Leibniz distingue ainsi la « notion complète » d’Adam, qui comporte tout ce qui arrive à
Adam – Eve, le péché, l’expulsion du jardin, etc., et tous les détails qui entourent cela -, de
« l’Adam vague », soit une idée assez générale d’Adam qui nous permet entre autres de le
reconnaître et de le distinguer d’autres individus. La première n’est connue que par Dieu car
elle enveloppe une infinité indénombrable de prédicats. De fait – et c’est là une connexion
cruciale entre ontologie de l’individu et doctrine modale leibnizienne du possible et de la
contingence – la notion complète d’Adam exclut un certain nombre de mondes possibles qui
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Entre de nombreux commentaires voire par exemple Belaval (1976).
3 Voir par exemple Sornette (2004).

auraient pu héberger cet Adam : ceux où, par exemple, il fauta un autre jour, ceux où Eve
s’appelait Evania, etc. Finalement, si l'Adam vague – ou, de manière générale, un individu tel
que connu par nous, donc pour lequel seul un sous-ensemble des propriétés sont déterminées
– pourrait habiter plusieurs mondes possibles pourvu que chacun d’eux ne contredise aucun
de ses prédicats, il semble que l’Adam réel soit une espèce de passage à la limite : la
détermination de chacun de ses prédicats exclut qu’il habite un des quelques mondes
possibles, de sorte qu’ in fine il n’en existe qu’un seul où il puisse exister, qui est justement le
monde actuel.
Certes, seul un entendement infini peut voir cette notion complète, et ainsi voir la nécessité
qui fait qu’Adam lui-même, ou Jules César, ou n’importe quel individu actuel et non possible
ou fictionnel, devait nécessairement être une partie de ce monde-ci et non d’un autre. Cette
conséquence métaphysique expose un point essentiel, à savoir que le système leibnizien, celui
d’individus qui expriment tous le même monde actuel et qui sont exprimés par leur trajectoire
– d’individus dont toutefois l’image que nous nous faisons ne saurait déchiffrer la nécessaire
appartenance à ce monde-ci plutôt qu’à un autre – implique de poser l’existence d’un
entendement divin, dans lequel existent d’une certaine manière les notions complètes de tous
les individus. Dans cette mesure, Leibniz fournira plusieurs « preuves » de l’entendement
infini – donc de Dieu ) à partir des réquisits de la logique des propositions vraies (par
exemple, comme socle des « vérités éternelles », dans les Nouveaux Essais).
Bien sûr, cela emporte des conséquences majeures pour la question de la contingence ou de la
liberté, puisqu’il faut concilier celles-ci avec l’inscription des prédicats (donc de la trajectoire
de l’individu) dans l’entendement divin. La spécificité de la solution leibnizienne diffère alors
de la solution éthique spinoziste dans la mesure même où sa métaphysique monadologique
diffère du monisme de Spinoza ; il fera ainsi appel à des considérations mathématiques
sophistiquées sur le calcul infinitésimal et l’infini, pour rendre compte de la différence entre la
série des prédicats telle que nous la connaissons, et qui peut être incompréhensible – d’où
l’apparence d’événements qui échoient à des individus sans avoir de lien à leur être propre –
et la raison de la série, que seul Dieu connaît. Des Lettres à Arnauld à la Théodicée Lebinz se
débattra avec cette question, en accumulant des concepts tels que « incliner sans nécessiter »,
censés saisir l’unité de la contingence propres aux événements et aux actes, et de la nécessité
qui découle de l’essence de l’individu.
Ce long excursus ne vise pas à faire acte d’histoire de la philosophie. Il indique simplement
qu’à côté de la perspective spinoziste, la perspective de Leibniz offre une fascinante tentative
de fonder le lien entre l’individu et sa trajectoire – donc aussi, ce qui fait qu’on peut attribuer
telle trajectoire à tel individu plutôt qu’à tel autre - sur la doctrine logique de la vérité.
Fascinante, cette tentative l’est d’autant plus qu’elle nous montre le coût d’une telle tentative,
soit, la nécessité de poser un entendement divin, pour rendre compte de la différence entre
« notion complète » d’Adam et notion ordinaire d’un individu comme Adam, la seule à
laquelle nous avons accès et qui bien entendu ne saurait adéquatement représenter la raison
d’être de tous les prédicats de l’individu Adam auquel réfère cette notion.
Or pour un certain nombre de raisons il nous semble aujourd’hui difficile, après deux siècles
de philosophie qui passèrent essentiellement pat Kant, Hume, Hegel ou Nietzsche, de payer ce
coût métaphysique pour se garantir in fine une cohérence métaphysique entre les individus et
ce qui leur arrive.

Voilà qui a contrario étaye peut-être le choix fait par les auteurs de notre ouvrage
d’emprunter une voie spinoziste – même si dans ce cas le coût consiste à rénover le
déterminisme spinoziste d’une manière qui puisse être en accord avec aussi bien nos intuitions
métaphysiques contemporaines que l’enseignement des sciences du XXème siècle. Si la
logique ne peut nous garantir l’adhérence de l’individu à ses trajectoires, il est possible que ce
soit bien dans l’autre sens qu’il faille prendre le concept d’individu – à savoir, se demander
comment d’un ensemble de rencontres pourrait surgir un individu susceptible de revendiquer
ses rencontres comme ce qui le fait être ce qu’il est. Il est fascinant de voir que cette question,
qu’on pense à première vue concerner essentiellement l’individu humain, puisse se poser pour
les être microscopiques que sont les bactéries, ainsi que le montre Livio Riboli-Sasco dans
son chapitre.
Autrement dit, l’abandon de la voie logiciste, leibnizienne, pour penser l’individu à partir de
ses rencontres, nous engage encore davantage à nous rapprocher des pratiques et des sciences
en acte, pour saisir comment en chacune peut se construire cette connexion d’un individu et
d’une trajectoire. Sur cet horizon, le projet de l’ouvrage qu’on referme pourra sembler encore
davantage légitime métaphysiquement.
Une première remarque serait ici à faire : refuser cette conception logiciste de l’individualité,
c’est aussi abandonner l’idée que les individus puissent être en quelque sorte
métaphysiquement constitués avant et indépendamment de l’appréhension que nous pourrions
en avoir au travers du compte rendu des rencontres qu’ils font, des évènements qui les
impliquent ou des expériences qu’ils vivent. Voilà qui rend bien plus aventureux la question
de déterminer ce qui est, ou n’est pas, un individu. Si l’intuition nous dit que la Belgique,
moi-même ou l’âne Martin sont des individus, qu’en est-il des colonies de fourmis, de
l’Everest – est-il un individu, ou bien une partie de l’Himalaya ? – ou de chacune des
bactéries qui composent mon microbiome ? Qu’en est il aussi de l’espèce Apis mellifera ou
Drosophila melanogaster, qui sont clairement des classes d'individus mais que certains
philosophes, soucieux de coller à la démarche des biologistes évolutionnistes, considèrent
comme un individu distinct ?4 S’il n’existe pas un locus métaphysique qui contiendrait les
notions complètes de ces individus (sans inclure aucune notion complète pour ceux qui n’en
sont pas) et nous permettrait ainsi, sinon de décider de ces questions, du moins de compter sur
le fait qu’une solution existe quelque part pour un esprit infini, comment trancher avec
certitude sur qui est un individu et qui n’en est pas ?
Autrement dit, refuser la voie leibnizienne exige de s’interdire de supposer qu’un ensemble
mathématiquement normé d’individus, avec leurs propriétés et leurs relations essentielles,
préexisterait à ce que nous en pouvons saisir par nos sciences et au travers de nos pratiques, si
bien que pour les appréhender il faudra justement se pencher sur la manière dont, dans chaque
champ, se fait l’individualisation des objets de science. A partir d’un examen de la pratique
scientifique, et par contraste avec l’idée d’un concept métaphysique d’individu qui serait
universel et définissable en termes logique par la philosophie on pourrait alors penser que les
modèles des interactions et des dynamiques du monde élaborées par les sciences permettent,
selon des procédures réglées, de distinguer ce qui est véritablement un individu dans leur
champ spécifique d’étude. On s’appuierait ensuite sur l’idée de quasi-indépendance selon
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Hull (1980). Sur les être collectifs qui sont des individus, parce que l’évolution tends à faire d’eux des
individus, comme les colonies d’insectes hyménoptères, ou bien les eucaryotes qui ne sont tells qu’à la suite d’un
évènement de fusion entre une bactérie et une cellule procaryote selon certains, voir Bouchard et Huneman
(2013). Sur les cas individualité qui défient nos intuitions, voir Pradeu (2011).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%