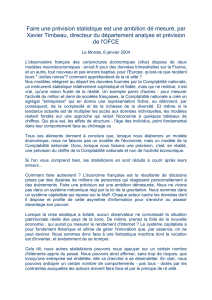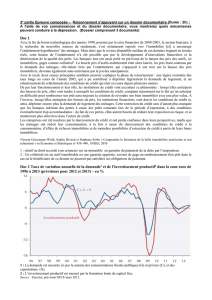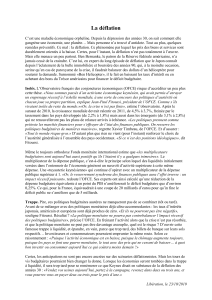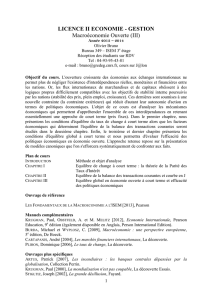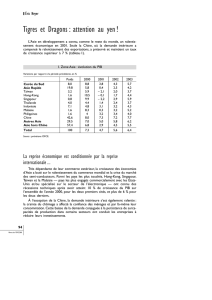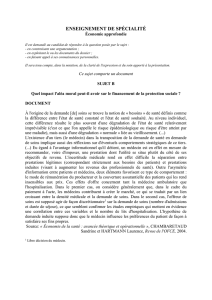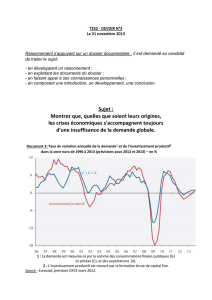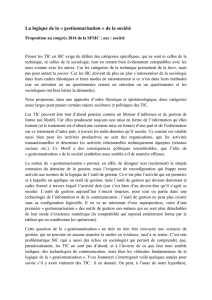peut-on recourir à la politique budgétaire ? est-ce souhaitable

Au cours des dernières années, plusieurs arguments ont été avancés pour
remettre en cause le recours aux politiques budgétaires dans une optique de stabi-
lisation conjoncturelle. Les modèles inspirés de la théorie du cycle réel, qui postulent
que l’économie est toujours dans une situation d’équilibre global, concluent certes
à l’inutilité de la politique budgétaire ; mais, bien que dominant le paysage de la
macroéconomie théorique, ils ne sont guère fondés empiriquement. De même,
l’hypothèse d’équivalence ricardienne, qui nie tout effet des choix de financement
public sur l’épargne nationale ne semble pas pertinente en pratique. Les arguments
en termes d’économie politique, qui mettent en doute les capacités des élus à
décider promptement et efficacement des modifications budgétaires souhaitables,
sont sans doute beaucoup plus recevables. Ils conduisent à penser que les stabili-
sateurs automatiques budgétaires sont préférables aux politiques discrétionnaires.
Mais la puissance de ces stabilisateurs automatiques dépend de la structure des
systèmes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques. Or ceux-ci ont
été, notamment aux États-Unis, profondément modifiés depuis une vingtaine
d’années, dans un sens qui a atténué la stabilisation automatique. Il apparaît souhai-
table et possible d’en restaurer la puissance, par exemple en rendant les taux
d’imposition et, éventuellement, certains transferts aux ménages variables en
fonction de l’activité économique, selon des formules préétablies.
PEUT-ON RECOURIR
À LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE ?
EST-CE SOUHAITABLE ? *
Robert M. Solow
Professeur, Massachusetts Institute of Technology
Octobre 2002
Revue de l’OFCE 83
* Conférence présidentielle prononcée au XIIIeCongrès mondial de l’Association interna-
tionale des sciences économiques, Lisbonne, Portugal, septembre 2002. Traduction française de
Jacques Le Cacheux.

Après l’euphorie de l’année 2000 et l’exubérance de la bulle technologique, la
croissance de l’économie mondiale a nettement ralenti en 2001, entraînée par une
correction de l’investissement, après trop d’investissements insuffisamment rentables
et l’accumulation de surcapacités. Bien que la correction de la bulle et des surca-
pacités semble aujourd’hui presque achevée, les indices boursiers continuent de
s’effondrer en raison de l’incertitude et de la défiance généralisées. Cette chute,
l’aversion au risque qui en résulte et la dégradation des notations des entreprises
pèsent sur le financement de l’investissement. Dans ce contexte morose, le policy
mix contra-cyclique américain n’a pas eu les effets escomptés sur l’investissement,
mais il a soutenu la consommation des ménages. En revanche, dans la zone euro,
les agents n’ont pu compter sur un policy mix aussi favorable. La reprise observée
au premier semestre 2002 dans les grands pays industrialisés a manqué de vigueur.
2003 serait une année de croissance molle (1,8 % dans la zone euro et 2 % aux
États-Unis), en deçà de la croissance potentielle. La défiance envers les entreprises,
la difficulté de la politique monétaire américaine à relancer l’investissement et le
manque de réactivité de la politique économique en Europe inhiberaient des antici-
pations de croissance plus fortes. Il n’y aurait par conséquent pas de motif pour
les entreprises à investir vigoureusement.
Le retournement de l’activité au deuxième trimestre 2001 a amené un
ajustement de l’emploi qui, compte tenu de délais différents dans les pays, s’est
généralisé au début 2002. Dans un contexte où les salaires individuels sont restés
maîtrisés, la masse salariale distribuée a ralenti au cours de 2001. La consom-
mation a cependant soutenu la croissance aux États-Unis au premier semestre
2002, portée par le policy mix. En Europe, l’essentiel de la croissance au premier
semestre 2002 a été imputable à un ralentissement ou à un arrêt du déstockage.
Le policy mix n’a pas été un soutien de l’activité. Par ailleurs, aux États-Unis comme
en Europe, on a assisté à une baisse de l’investissement depuis 2001, due à des
difficultés de financement des entreprises. Celles-ci s’expliquent par plusieurs
L’ÉTÉ MEURTRIER
Perspectives 2002-2003
pour l’économie mondiale *
Octobre 2002
Revue de l’OFCE 83
* Cette étude a été réalisée au sein du département analyse et prévision de l’OFCE, par
une équipe dirigée par Xavier Timbeau et Eric Heyer et comprenant Hélène Baudchon, Odile
Chagny, Valérie Chauvin, Gaël Dupont, Amel Falah, Thierry Latreille, Sabine Le Bayon, Matthieu
Lemoine, Catherine Mathieu, Hervé Péléraux, Florian Pelgrin, Mathieu Plane, Christine Rifflart et
Paola Veroni. A également contribué à l’étude Françoise Charpin.

facteurs. Premièrement, le recul du prix des actifs a augmenté l’aversion pour le
risque des investisseurs et des épargnants, qui ont accru la part des actifs liquides
dans leur portefeuille au détriment des placements en actions. Deuxièmement, les
banques ont été contaminées par cette aversion au risque et, face à l’augmen-
tation du risque de défaut des entreprises, elles ont été plus réticentes à prêter
aux entreprises qu’aux ménages.
Face à l’effondrement des marchés boursiers, l’immobilier est apparu comme
une valeur refuge. Le dynamisme des prix de l’immobilier est une bonne nouvelle
dans la tourmente que connaissent aujourd’hui les prix des actifs. Il a limité la
baisse de la richesse nette des ménages aux États-Unis et au Royaume-Uni, et
empêché celle-ci en Europe, où le patrimoine financier des ménages est encore
peu important.
En Amérique latine, la croissance souffre particulièrement des craintes face au
risque financier depuis la crise argentine, qui se doublent aujourd’hui d’une crainte
face au risque politique, notamment au Brésil. Au niveau mondial, seuls la zone
asiatique et les pays d’Europe de l’Est ont et tireront jusqu’en 2003 leur épingle
du jeu. L’Asie du Sud-Est a bénéficié du rebond du marché des semi-conducteurs
et de la croissance chinoise, qui attire massivement les investissements directs
étrangers. Le Japon, toujours pris dans une spirale déflationniste, voit ses exporta-
tions tirées par le dynamisme de ses partenaires, qui constituent son seul moteur
de croissance. Les pays d’Europe de l’Est se distinguent aussi dans l’économie
mondiale par leur dynamisme. La perspective de l’intégration dans l’Union
européenne des pays d’Europe de l’Est leur permet en effet d’attirer des investis-
sements étrangers dans un contexte de forte contraction de ceux-ci au niveau
mondial.
Division économie internationale
30
Revue de l’OFCE 83

Après trois années de forte croissance (3,6 % en moyenne de 1998 à 2000),
la France a connu un premier ralentissement en 2001 (1,8 %) qui se prolongerait
en 2002 (0,9 %). Pour 2003, l’économie française progressera de manière
modérée, à des rythmes très proches de ceux anticipés dans la zone euro. La
croissance pour l’année 2003 s’établirait à 1,8 % en moyenne annuelle. Elle
resterait inférieure à la croissance potentielle, même en fin d’année. L’année 2003
verrait ainsi le retour à une croissance molle, conséquence directe de la purge
sur les capacités de production, des incertitudes sur la politique monétaire, des
contraintes sur la politique budgétaire et d’un environnement extérieur morose.
FRANCE : FIN DE L’ÉCHAPPÉE
Perspectives 2002-2003
pour l’économie française *
Octobre 2002
Revue de l’OFCE 83
* Cette prévision a été réalisée à l’aide du modèle trimestriel de l’économie française,
e-mod.fr, par une équipe composée de Valérie Chauvin, Gaël Dupont, Éric Heyer et Mathieu
Plane. L’indicateur avancé est réalisé par Éric Heyer et Hervé Péléraux. La prévision tient compte
des informations disponibles à la fin septembre 2002 et intègre les comptes nationaux trimes-
triels de septembre 2002, à savoir le compte emplois-ressources jusqu’au deuxième trimestre
2002 et les comptes d’agents jusqu’au premier trimestre 2002. La prévision et le modèle reposent
sur les données et les concepts de la comptabilité nationale base 95 dans le cadre du SEC95.
Le modèle est estimé sur la période 1978-2000.

Octobre 2002
Revue de l’OFCE 83
DÉBAT SUR LES PERSPECTIVES
Jean-Paul Fitoussi
Les prévisions occupent une place particulière dans le débat public en
économie. Elles sont généralement considérées comme des prédictions,
qualifiées fréquemment d’optimistes ou de pessimistes, comme si elles dépen-
daient de l’humeur des équipes qui les réalisent. Certes, en un sens, la prévision est
un art tant elle dépend des signes précurseurs que nous livre le présent, de l’inter-
prétation des évolutions en cours, de la capacité des économistes de sélectionner les
informations pertinentes parmi celles, multiples, dont l’intérêt n’est qu’anecdotique.
Mais elle est surtout une science puisqu’elle consiste à déduire des informations dont
on dispose sur le présent une vision de l’avenir. Elle ne peut être formulée en dehors
d’un cadre général d’interprétation, c’est-à-dire d’une théorie qui met en relation les
informations que l’on privilégie et les variables que l’on cherche à prévoir.
Parmi ces informations, certaines, cruciales, ne sont pas vraiment disponibles car,
pour l’essentiel, elles dépendent de décisions à venir et qu’il n’existe pas vraiment
de théorie permettant de déduire des données existantes ce que seront ces décisions.
Il faut donc formuler des hypothèses alternatives et retenir celles qui nous paraissent
les plus vraisemblables. Dès lors, les erreurs de prévision peuvent avoir au moins
trois origines : une insuffisance d’information sur le présent, une mauvaise spécifi-
cation théorique, la non réalisation de certaines hypothèses. De surcroît, il existe une
incertitude irréductible au sens ou certains événements sont imprévisibles, alors même
que leur conséquence sur l’activité économique est déterminante. Voilà pourquoi les
chiffres associés à une prévision sont éminemment fragiles, qu’ils doivent être consi-
dérés comme conditionnels aux hypothèses que l’on formule, aux données dont on
dispose et au cadre théorique dans lequel on raisonne.
Il m’a donc semblé nécessaire que les prévisions réalisées par l’OFCE soient
publiées en même temps qu’un débat autour de ces prévisions. Cela offre le double
avantage de rendre explicite le doute inhérent à tout exercice de prévision pour les
raisons déjà exposées, et de participer au pluralisme nécessaire à l’indépendance et
au sérieux des études économiques. Une prévision, pour rigoureuse qu’elle soit, n’est
pas un exercice mécanique au terme duquel la vérité serait révélée, mais une
« histoire » raisonnée du futur délivrant des résultats incertains. Il est utile d’en
comprendre d’emblée les limites, pour ne point s’en servir comme d’un argument
d’autorité, à l’instar de ce qui est trop fréquemment le cas.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%