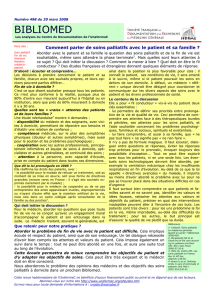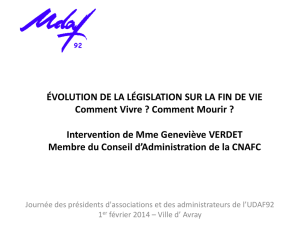Les questions à envisager quand on prend soin d`enfants

Paediatr Child Health Vol 20 No 3 April 2015126
Les questions à envisager quand on prend soin
d’enfants présentant un risque élevé de mourir
avant l’âge adulte
France Gauvin MD MSc1, Claude Cyr MD2
1Département de pédiatrie, CHU Sainte-Justine, Université de Montréal, Montréal; 2Département de pédiatrie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke
Correspondance : Docteure France Gauvin, département de pédiatrie, CHU Sainte-Justine, 3175, ch. Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec)
H3T 1C5. Téléphone 514-345-4931, poste 6812, télécopieur 514-345-7739, courriel [email protected]
Nous présentons ici un scénario fictif, qui met en exemple un
patient nécessitant des soins palliatifs pédiatriques. Martin,
qui a maintenant trois ans, est atteint d’une maladie neurodégéné-
rative progressive à issue fatale. Martin vit avec ses deux parents et
une sœur de cinq ans. La maladie a été diagnostiquée à l’âge de
deux ans lors d’une investigation pour régression du développe-
ment psychomoteur et trouble d’équilibre. Depuis, l’état de Martin
se détériore, et il présente une hypotonie progressive, de la spasti-
cité aux membres inférieurs et une perte importante de ses acquis.
De plus, il a de plus en plus de problèmes d’étouffement alimen-
taire. Il a été hospitalisé récemment pour une pneumonie
d’aspiration avec détresse respiratoire sévère. Il a reçu des antibio-
tiques intraveineux et une gastrostomie a été mise en place. La
convalescence a été longue, mais Martin est enfin revenu à la
maison. Avant son congé, une équipe de soins palliatifs pédiatriques
l’a rencontré. L’équipe communique avec le pédiatre commu-
nautaire afin que Martin soit suivi dans sa région et que des res-
sources soient offertes à domicile.
Une rencontre avec un patient présentant une maladie progres-
sive non curable peut amener beaucoup de discussions et
d’émotions. Au fil des rencontres, un lien de confiance se crée et
un contact privilégié avec le patient et sa famille s’établit. Les
premières entrevues sont souvent difficiles, car les contacts sont
encore fragiles et on ne veut pas briser des liens fraîchement tissés.
Un groupe d’experts en soins palliatifs pédiatriques a élaboré par
consensus une liste de questions à envisager afin de permettre au
clinicien de mieux se préparer à ces rencontres (tableau 1). L’ordre
ou la priorité des questions peut changer selon le moment où la
rencontre a lieu dans l’évolution de la maladie (moment du
diagnostic, état stable, complication, fin de vie). Il sera important
d’en connaître tous les aspects pour bien soigner et accompagner le
patient et sa famille. Lors des rencontres avec le patient et sa
famille, il y a plusieurs sujets à évaluer. Il n’est pas toujours possible
de tous les aborder lors de la même entrevue. De plus, le clinicien
jugera, avec les parents, si l’enfant peut ou doit participer à toutes
les discussions, selon sa maturité. Il est important de savoir que
plusieurs enfants, même mineurs, veulent faire partie des discus-
sions concernant leurs soins et ont la capacité d’y prendre part (1).
En début de rencontre, il est intéressant de poser des questions
ouvertes aux parents sur leur enfant en général et sa condition médi-
cale. Ceci permet de mieux connaître leur enfant avant de les
entendre parler plus spécifiquement de leur vision de sa maladie et
du pronostic. Ces questions ouvertes permettent aussi d’établir une
relation avec la famille, de colliger de l’information à propos du
patient et, surtout, de laisser la possibilité et le temps aux parents de
parler de façon ininterrompue de ce qu’ils vivent. Pendant que les
parents (ou le patient) parlent, le clinicien en profite pour écouter
ce qui est dit, entendre les mots qui sont choisis et réfléchir à ce qui
n’est pas dit afin de poser les bonnes questions par la suite et de
s’adapter au style de communication de la famille.
Ensuite, il est important d’explorer la meilleure façon de com-
muniquer avec la famille (p. ex., de façon directe ou indirecte). En
explorant cette question, le clinicien envoie aussi le message
(même s’il ne le formule pas) qu’il veut prendre soin du patient et
de sa famille de la façon la plus appropriée possible.
La question sur les espoirs et les objectifs ouvre sur un sujet qui
peut être difficile pour les parents, qui peuvent ressentir « qu’il n’y
a plus aucun espoir ». C’est un bon moment pour revoir les espoirs
et objectifs à court terme, qui sont plus facilement réalisables
(p. ex., être à la maison le plus souvent possible). Bien que le
patient et sa famille connaissent l’issue de la maladie et que le
pronostic soit très clair pour eux, l’espoir demeure souvent jusqu’au
bout. Mais l’espoir se transforme au cours de la maladie : l’espoir
d’une guérison devient l’espoir d’une période sans complication,
puis d’une fin de vie paisible. Plus la fin de vie approche et plus les
objectifs à court terme deviennent importants : passer une journée
sans douleur, passer une bonne nuit de sommeil, avoir un moment
de répit dans la journée.
La revue des symptômes physiques ramène la conversation à un
niveau plus émotionnellement neutre. À chaque rencontre, il est
essentiel de revoir tous les symptômes ressentis par le patient, selon
la liste énumérée dans le tableau. Il est parfois difficile d’évaluer les
symptômes chez le jeune enfant. En fait, la douleur est le seul
symptôme pour lequel des échelles d’évaluation validées existent
dans ce groupe d’âge. Il est encore plus difficile d’évaluer des
symptômes telle la dyspnée.
La question sur la peur et les craintes permet d’approfondir la
discussion. Cette question est posée à mi-chemin de la rencontre,
afin d’avoir le temps de bâtir un lien, mais pas trop tard, pour que
les parents aient le temps de parler de leurs inquiétudes. Il n’est
pas rare que les parents pleurent ou cessent de parler à cette étape
de l’entrevue. Les pleurs ne doivent pas être perçus comme un
mauvais dénouement, mais comme une occasion de démontrer
de la tristesse.
Ce qui se passe avec la fratrie doit aussi être abordé. Il faut dis-
cuter de la réalité des frères et sœurs non rencontrés, de leurs
besoins et de leurs réactions, et vérifier s’ils sont pris en charge
lorsque la situation l’exige.
Il faut également parler des problèmes financiers ainsi que des
ressources à domicile à la disposition de la famille. Au besoin, un
commentAire
©2015 Pulsus Group Inc. All rights reserved

Commentaire
Paediatr Child Health Vol 20 No 3 April 2015 127
travailleur social doit être affecté à la famille pour lui apporter les
ressources nécessaires.
Les professionnels de la santé oublient souvent la religion, la
culture et les croyances spirituelles. Pourtant, aborder ce sujet
envoie un message essentiel : « Ce qui est important pour vous est
important pour moi en tant que médecin traitant. »
La discussion concernant la planification préalable des soins et
les options de soins de fin de vie est certainement la plus difficile
et ne peut pas toujours avoir lieu lors de la première entrevue.
Toutefois, le fait de ne pas discuter de ces sujets primordiaux peut
avoir des répercussions majeures. Une façon d’aborder ces sujets est
d’expliquer pourquoi il est important d’en discuter : « Bien qu’il
soit difficile de discuter de ce qui pourrait se passer si l’état de votre
enfant se détériore, il est important de le faire afin que je sache
quels sont vos souhaits. Si nous ne prenons pas des décisions
ensemble, il est possible qu’en cas d’urgence, des traitements soient
administrés ou non administrés à votre enfant, sans tenir compte
de sa situation médicale. » En plus de discuter de la non-
réanimation et des soins dits invasifs (intubation, ventilation
mécanique, amines), c’est un bon moment pour discuter de tous les
soins qui pourraient être prodigués si l’état du patient se détériore
(antibiotiques, transfusions, etc.) et des soins de confort. Cette
discussion permet de faire une planification préalable des soins
complète (2). Elle permet aussi une ouverture sur des questions
plus délicates que les parents n’osent pas souvent aborder : les scé-
narios de fin de vie. Comment cela va-t-il se passer? Souffrira-t-il?
Que pourrai-je faire pour l’aider? Les parents peuvent avoir un
protocole de détresse à domicile. Cela permet aussi de savoir si la
famille souhaite rester à domicile le plus longtemps possible ou si
elle préfère retourner à l’hôpital (ou en maison de soins palliatifs,
le cas échéant) lors d’une détérioration. Les parents savent-ils qui
appeler en cas de détérioration? Ont-ils les formulaires appropriés
(ordonnance de non-réanimation et planification préalable des
soins) pour les services d’urgence?
Avant de terminer une entrevue, il est important de demander
s’il y a des sujets qui n’ont pas été abordés ou d’autres questions que
le patient ou la famille aimeraient poser. Ceux-ci peuvent ainsi
exprimer d’autres craintes ou aborder d’autres sujets difficiles.
Vous connaissez maintenant Martin et sa famille depuis un an.
Son état s’est détérioré rapidement ces derniers mois, et les parents
TABLE 1
Liste de questions à envisager quand on prend soin d’enfants* présentant un risque élevé de mourir avant l’âge adulte
*Selon la maturité de l’enfant, l’entrevue peut avoir lieu en sa présence, et certaines questions peuvent lui être posées à lui aussi.
1. Pouvez-vous me parler de votre enfant?
a. Qu’est-ce qu’il aime, qu’est-ce qui lui fait plaisir?
b. Qu’est-ce qu’il n’aime pas?
2. Quelle est votre compréhension (et celle de votre enfant) de ce qui ce passe actuellement dans sa condition médicale?
3. Quels sont les éléments importants que nous devons connaître pour parler avec vous, votre enfant ou les autres membres de votre famille? (p. e.x,
comment vous et votre famille communiquez-vous le mieux?)
4. Quels sont vos espoirs et objectifs :
a. à court terme (aujourd’hui et dans les prochains jours?)
b. à moyen terme (dans les prochaines semaines?)
c. à long terme?
5. Est-ce que votre enfant présente de la douleur ou des symptômes qui le dérangent tout particulièrement : douleur, céphalée, nausée, vomissements,
diarrhée, constipation, perte d’appétit, difficulté à s’alimenter, problèmes de sommeil, prurit, fatigue ou difficulté respiratoire?
6. Quelle est votre plus grande inquiétude ou peur actuellement (ou pour l’avenir immédiat)?
7. Qu’est-ce que vos autres enfants comprennent de la situation médicale de « nom du patient » et de ce qui se passe actuellement? Avez-vous des questions
ou des inquiétudes à propos de leurs comportements (p. ex., pleurs, réactions, trouble du sommeil) ou de leurs interactions (p. ex., refus d’aller à l’école)?
Il est possible d’ajouter : désirez-vous connaître comment faire participer la fratrie de façon adaptée à leur âge tout au long des étapes de la maladie de leur
frère ou sœur?
8. Avez-vous des problèmes financiers que nous devrions connaître et pour lesquels nous pourrions peut-être vous aider?
Il est possible d’ajouter : connaissez-vous les prestations de compassion de l’assurance-emploi?
9. Quelle aide avez-vous à domicile? P. ex., soins à domicile, aide domestique, infirmière à domicile, accès à une pharmacie, accès à du répit familial
10. Y-a-t-il des éléments importants de votre religion, de votre culture ou de vos croyances spirituelles que nous devrions connaître?
11. Étant donné vos inquiétudes et vos espoirs, il est important pour nous de connaître vos préférences quant aux soins médicaux et traitements à prodiguer à
votre enfant si son état de santé se détériore (même si nous espérons tous le contraire). Il est important d’aborder les éléments suivants :
a. Type de réanimation en cas de détérioration soudaine (réanimation cardiorespiratoire, ventilation mécanique, intubation) et soins qui devraient être
prodigués à l’enfant (soins de confort, analgésie, anticonvulsivants, antibiotiques, transfusions, etc.)
i. Il peut être approprié ou non de discuter de la planification préalable de soins à ce moment de la rencontre selon la situation, le patient, la famille et
l’évolution de la maladie.
b. Vous êtes-vous demandé si vous préférez que l’on soigne votre enfant à la maison ou à l’hôpital (ou dans une maison de soins palliatifs s’il y en a dans
la région) lorsqu’il deviendra beaucoup plus malade (et peut-être plus près de mourir)?
c. Avez-vous des questions à propos de la fin de vie et comment votre enfant pourrait décéder?
d. Pouvons-nous trouver ensemble le meilleur professionnel à qui demander de l’aide ou des conseils si vous n’êtes pas à l’hôpital? Pouvons-nous discuter
dans quelle situation appeler le 911 et quoi dire lorsque vous appelez le 911?
12. Y a-t-il des sujets que nous n’avons pas abordés au sujet de vous, de votre enfant et de votre famille dont vous aimeriez discuter?
Cette liste de questions a été élaborée par des cliniciens canadiens en soins palliatifs de Vancouver à Halifax en réponse à la question que le docteur Andrew Lynk
(président sortant de la SCP) a posée au docteur Stephen Liben (soins palliatifs pédiatriques) lors d’un congrès : « Existe-t-il une liste des dix questions les plus
importantes qu’un médecin doit envisager ou soulever lorsqu’il rencontre la famille d’un enfant dont le risque de décès est élevé? » Nous remercions particulièrement
le docteur Lynk et les cliniciens canadiens en soins palliatifs qui ont collaboré à la création de cette liste.

Commentaire
Paediatr Child Health Vol 20 No 3 April 2015128
ont décidé de ne plus retourner à l’hôpital. Avec vous, ils ont préparé
la planification préalable des soins et établi qu’en cas de détériora-
tion, Martin recevrait des soins de confort, mais pas de réanimation
cardiorespiratoire. Ils ont cette ordonnance en leur possession. Une
infirmière à domicile vient les voir régulièrement. Martin reçoit de
la morphine par stomie lorsqu’il a de la douleur ou de la dyspnée. Les
parents ont un protocole de détresse à domicile, au besoin. Ils savent
qui appeler en cas de détérioration sévère. Ils espèrent accompagner
leur enfant et rester à la maison jusqu’à son décès, mais savent que
l’hôpital les accueillera en tout temps. La sœur de Martin a été
accompagnée par ses parents et l’équipe soignante et évolue bien
pour l’instant. Les parents savent qu’après le décès, l’équipe
soignante sera encore là pour assurer le suivi de deuil.
RéFéREnCES
1. Hinds PS, Drew D, Oakes LL et coll. End-of-life care preferences of
pediatric patients with cancer. J Clin Oncol 2005;23:9146-54.
2. Tsai E. La planification préalable des soins pour les patients en
pédiatrie. Paediatr Child Health 2008;13:799-805.
1
/
3
100%