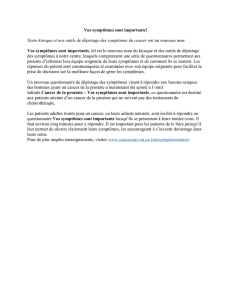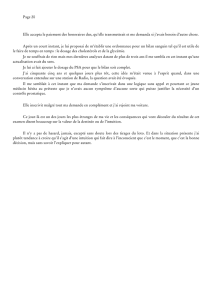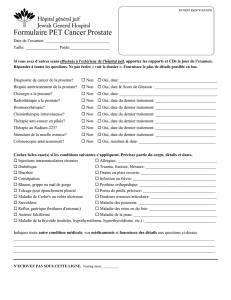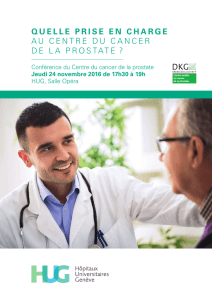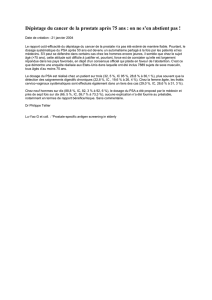le cancer de la prostate

//
FORMATION CONTINUE
LE CANCER DE LA PROSTATE
DÉPISTAGE ENCORE PERTINENT EN 2014 ?
Lors de sa visite habituelle, Monsieur Provencher, 66 ans, vous informe que son voisin vient
de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate métastatique. Il a effectué quelques recherches
sur Internet et vous demande aujourd’hui un dosage d’APS. Allez-vous le lui prescrire ?
Catherine Sperlich et Trung Nghia Nguyen
Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme,
en atteignant un sur sept. Au cours des dernières années,
le US Preventive Services Task Force, le Collège des
médecins du Québec ainsi que plusieurs autres agences
gouvernementales ont émis des recommandations remet-
tant en question la pertinence du dépistage du cancer de
la prostate, du moins sur une base populationnelle systé-
matique1-4. Nous vous offrons un point de vue oncologique
sur ce débat.
DOCTEUR, MON VOISIN A LE CANCER
DE LA PROSTATE, DOIS-JE M’INQUIÉTER ?
Le dépistage du cancer de la prostate au moyen du dosage
sanguin de l’antigène prostatique spécifique (APS) sert à
déterminer le degré de risque et ainsi à repérer les hommes
qui ont besoin d’une évaluation plus approfondie. La recher-
che à ce sujet a regroupé principalement des hommes de
55 à 70 ans dont l’espérance de vie était d’au moins dix à
quinze ans. Les données longitudinales de plus grandes
études à répartition aléatoire (ERSPC, PLCO, Göteberg)
montrent un effet bénéfique, mais modeste du dépistage sur
la mortalité propre à ce cancer. Toutefois, elles ne révèlent
aucun effet sur la survie globale. Plus spécifiquement,
l’étude European Randomised Study of Screening for Pros-
tate Cancer (ERSPC) a observé une baisse de la mortalité
liée au cancer de la prostate de 21 % sur un suivi de onze
ans, sans accroissement de la survie globale5,6. L’étude de
Göteberg, menée en Suède et incluse dans l’étude ERSPC, a
quant à elle noté une diminution de la mortalité attribuable
au cancer de la prostate de 44 % après quatorze ans7. À l’op-
posé de ces résultats, l’étude Prostate, Lung, Colorectal
and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO), réalisée aux
États-Unis, n’a pas révélé de réduction de la mortalité par
cancer de la prostate après treize ans par suite d’un dépis-
tage annuel8. Les données modélisées de l’étude ERSPC
suggèrent à long terme un accroissement plus important
de la survie6,9 (tableau I2).
Puisqu’un dépistage à large échelle du cancer de la pros-
tate ne comporte qu’un avantage modeste, une stratégie
individualisée en visant la détection précoce paraîtrait
plus souhaitable. En plus de cibler les hommes de 55 à
70 ans, dont l’espérance de vie dépasse dix ans, on pourrait
aussi l’envisager à partir de 45 ans dans certains groupes
de patients dont le risque est plus élevé : hommes comp-
tant un parent du premier degré ayant un cancer de la
prostate, particulièrement s’il est survenu avant 65 ans ;
hommes de race noire et hommes porteurs de mutation
des gènes BRCA1 ou BRCA2. Le scénario inverse s’ap-
plique aux patients atteints de maladies concomitantes
limitant à la fois leur qualité de vie et leur longévité et dont
la survie probable est inférieure à dix ans comme ceux
souffrant d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale
grave nécessitant une dialyse ou d’un cancer métastatique
autre. On devrait ainsi s’abstenir de leur proposer le dépis-
tage. À titre de référence, les lignes directrices 2013 du
Collège des médecins du Québec ne recommandent pas
le dépistage du cancer de la prostate chez les patients de
plus de 70 ans, ni chez ceux dont l’espérance de vie est
estimée à moins de dix ans2.
//
FORMATION CONTINUE
La Dre Catherine Sperlich et le
Dr Trung Nghia Nguyen, hémato-oncologues,
exercent au Centre intégré de cancérologie
de la Montérégie de l’Hôpital Charles-Le Moyne
et sont professeurs d’enseignement clinique
à l’Université de Sherbrooke.
TABLEAU I
NOMBRE DE DÉPISTAGES*
ET DE DIAGNOSTICS† NÉCESSAIRES
POUR ÉVITER UN DÉCÈS PAR CANCER
DE LA PROSTATE
11 ans de suivi médian Extrapolation à vie
NNS 1055 100
NND 37 7
*Number needed to screen (NNS) ; †Number needed to diagnose (NND)
Source : Collège des médecins du Québec. Le dépistage du cancer de la
prostate – Mise à jour 2013. Lignes directrices du Collège des médecins
du Québec. Montréal : Le Collège : 2013. Site Internet : www.cmq.org/fr/
Public/Profil/Commun/Nouvelles/2013/~/media/Files/Lignes/Lignes-
depistage-cancer-prostate-2013.pdf?51429. Reproduction autorisée.
33
lemedecinduquebec.org

Évidemment, en présence de symptômes urinaires (dif-
ficulté mictionnelle, pollakiurie, rétention d’urine ou
métastases osseuses), la notion de dépistage n’est plus de
mise. Ces éléments cliniques devraient déclencher plutôt
un bilan diagnostique incluant le dosage de l’APS et tout
autre test approprié.
QUELS TESTS DOIS-JE SUBIR ?
Parmi les tests de dépistage du cancer de la prostate, on
trouve le toucher rectal et le dosage de l’APS dans le sang.
Le toucher rectal permet de repérer des nodules supé-
rieurs à 0,2 ml dans la zone périphérique de la prostate.
Jusqu’à 18 % des cancers de la prostate seraient découverts
sur la base d’un toucher rectal anormal seul. En association
avec un taux d’APS de 2 ng/ml, le toucher rectal anormal
aurait une valeur prédictive positive de 5 % à 30 %. Il existe
également un lien entre la découverte d’un nodule et la
possibilité d’un cancer de la prostate dont le grade de Glea-
son est plus élevé. Ainsi, un nodule palpable au toucher
rectal indiquerait un cancer de la prostate déjà de stade T2
selon le système TNM (Tumors, Lymph Node, Metastasis).
Lorsque le taux d’APS est élevé, mais que le toucher rectal
est normal, le cancer serait alors de stade T1.
L’APS constitue un marqueur spécifique à la prostate, mais
non au cancer. En effet, l’augmentation du taux d’APS peut
être le signe d’une hypertrophie bénigne de la prostate ou
d’un autre problème d’inflammation de la prostate. Il faut
se rendre compte que l’APS est un paramètre continu. Bien
que le risque de cancer soit plus important lorsque les
valeurs sont plus hautes, il est possible, mais rare, d’avoir
un cancer de la prostate lorsque les valeurs sont faibles.
Un premier résultat peu élevé au dosage de l’APS per-
met de repérer un groupe de patients à très faible risque,
de sorte qu’un dépistage ultérieur deviendrait discutable
(tableau II5,6,8,10).
L’intervalle idéal entre les divers dosages d’APS reste
controversé puisque ce paramètre n’était pas très homo-
gène parmi les grandes études à répartition aléatoire. On
pourrait raisonnablement répéter les dosages tous les
deux ans et moduler cet intervalle entre un et quatre ans
selon le risque du patient par rapport à la moyenne.
Le seuil à partir duquel une valeur d’APS est considérée
comme élevée est également variable selon les différents
protocoles. À titre d’exemple, l’étude PLCO utilisait un seuil
d’APS comme indication d’une biopsie de la prostate à
3 ng/ml alors que la plupart des centres de l’étude ERSPC
fixaient le seuil à 4 ng/ml.
Il peut donc devenir complexe de décider de procéder ou
non au dépistage du cancer de la prostate en raison de ces
multiples facettes et controverses. Afin de mieux aider
les patients à en arriver à une décision personnalisée, le
médecin dispose de plusieurs outils cliniques. Le Collège
des méde cins du Québec a produit un dépliant intitulé : « Le
dépistage du cancer de la prostate : une décision qui VOUS
appartient ! »11. Une boîte à décision intitulée : « Le dosage
de l’antigène prostatique spécifique (APS) pour le dépis-
tage du cancer de la prostate »2 ainsi que le site Internet
www.prostatecancer.ca peuvent s’avérer fort utiles pour
informer les patients.
SI MON TAUX D’APS EST ÉLEVÉ,
QUE POURRAIT-IL M’ARRIVER ?
En présence d’un taux d’APS élevé, le patient est dirigé
vers un urologue qui discutera avec lui du rôle de la biop-
sie. Au moins huit échantillons doivent être prélevés sous
guidance échographique et envoyés en pathologie dans le
but de diagnostiquer le cancer, un adénocarcinome dans
99 % des cas.
La biopsie peut entraîner des coûts et des risques non négli-
geables, notamment en ce qui a trait à l’intervention, au
sur diagnostic et au traitement. Des infections conduisent
parfois à l’hospitalisation du patient dans de 0,6 % à 4,1 %
des cas12. Une étude a établi à 33 % le taux de complica-
tions modérées ou graves, comme la douleur, la fièvre et les
symptômes urinaires13. La mortalité associée à l’intervention
TABLEAU II TRÈS FAIBLE RISQUE DE CANCER DE LA PROSTATE5,6,8,10
Études Valeur d’APS et risques cliniques
PLCO h APS , 1 : risque , 0,6 % de cancer de la prostate sur six ans8
ERSPC h APS , 1 , NNS* : 24 642 et NNT† : 7245,6
MALMO h Sur 21 277 hommes, 75 % ont eu un taux d’APS , 1 à 45 ans. De ce groupe, moins de 1 % sont morts du cancer
de la prostate métastatique sur quinze ans.
• Si 2e dosage de l’APS , 1 : moins de 0,2 % de décès par cancer de la prostate métastatique
• Si 3e dosage de l’APS , 1 : risque de décès très faible, dépistage devient discutable10
* Nombre de dépistages nécessaire ; † nombre de patients à traiter
34
Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 11, novembre 2014

//
FORMATION CONTINUE
à l’intérieur de trente jours est toutefois rare (0,09 % selon
les données d’un registre canadien)14. La notion de surdia-
gnostic fait référence à la découverte, grâce au dépistage,
de problèmes qui ne sont pas cliniquement significatifs. Le
taux de surdiagnostic lié au dépistage du cancer de la pros-
tate est de quelque 40 % parmi les cas trouvés par dosage
de l’APS2.
Les risques du traitement local du cancer de la prostate
dé pendent de la modalité utilisée. Ainsi, une prostatectomie
radicale comporte un taux de mortalité opératoire d’en-
viron 0,5 % et entraîne de 40 % à 50 % de complications
sexuelles et de 10 % à 20 % de problèmes urinaires chez
les hommes traités2. La radiothérapie externe, quant à elle,
peut mener à un taux de troubles érectiles de 20 % à 45 %,
d’incontinence urinaire de 2 % à 16 % et de problèmes in tes-
tinaux de 6 % à 25 %15.
La biopsie servira aussi à établir le score de Gleason, un fac-
teur prédictif du degré d’agressivité du cancer, de manière à
connaître les catégories de risque. Un cancer de faible risque
serait classé T2a ou moins lorsque le score de Gleason est
d’au plus 6 et le taux d’APS, inférieur à 10. Un cancer de
risque élevé serait plutôt classé T2c ou plus lorsque le taux
d’APS est supérieur à 20 ou que le score de Gleason est de
8 ou plus (tableau III16). Ces paramètres aideront à préciser
si des examens d’imagerie additionnels sont nécessaires,
comme une scintigraphie osseuse (pour les métastases
TABLEAU III CATÉGORIES DE RISQUE DU CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ
Catégorie de risque
Score
de Gleason
Stade
clinique
APS
(ng/ml)
Caractéristiques
de la biopsie
Densité
de l’APS
Très faible < 6 et T1c et , 10 et Moins de 3 carottes
positives ; < 50 % cancer
de toutes les carottes
< 0,15 ng/ml/g
Faible < 6 et T1c, T2a et , 10
Intermédiaire 7 ou T2b ou 10 – 20
Élevé 8 – 10 ou T2c ou . 20
Source : Nelson JB. Observation for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol 2014 ; 32 (13) : 1295-8. Reproduction autorisée.
TABLEAU IV OPTIONS DANS LA PRISE EN CHARGE D’UN CANCER DE LA PROSTATE LOCALISÉ
Prise en charge Description Indications Risques Avantages
Observation
(watchful waiting)
Sans biopsie
systématique ; palliation
lors de l’évolution
du cancer
Risque de très faible
à faible et espérance
de vie estimée de moins
de dix ans
Évolution néoplasique Éviter les eets néfastes
d’un traitement radical
Surveillance active Biopsies systématiques ;
intervention à visée
curative lors de
l’évolution du cancer
Risque de très faible
à faible et espérance
de vie estimée de plus
de dix ans
Évolution du cancer ;
risques associés à la biopsie
de surveillance (septicémie)
Éviter les eets néfastes
d’un traitement radical
Intervention
chirurgicale
Prostatectomie radicale
avec diérentes
techniques
Espérance de vie
estimée de plus
de dix ans
Incontinence, troubles
érectiles
Établir le stade définitif
et faire l’exérèse
complète de la prostate
Radiothérapie 6
hormonothérapie
Radiothérapie
externe, curiethérapie,
protonthérapie
Espérance de vie
estimée de plus
de dix ans
Trouble mictionnel, glande
prostatique en place : risque
de récidive, rectite, cystite
et sténoses radiques
Diminuer le risque
d’incontinence par
rapport à la chirurgie
Source : Nelson, JB. Observation for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol 2014 ; 32 (13 ) : 1295-8. Reproduction autorisée.
35
lemedecinduquebec.org

osseuses) ou une tomodensitométrie abdominopelvienne
pour évaluer la présence ou l’absence d’adénopathies. L’ap-
proche thérapeutique sera ainsi déterminée selon l’âge, les
maladies concomitantes et l’espérance de vie.
Les études ont montré que le dépistage est surtout associé
à la découverte d’un cancer localisé (RR de 1,79) et, dans un
degré moindre, d’un cancer avancé (RR de 0,80). À la suite
d’un diagnostic de cancer de la prostate localisé, différentes
options de prise en charge peuvent être évoquées, notam-
ment l’observation, la surveillance active, la prostatectomie
radicale et la radiothérapie (tableau IV16). L’espérance de
vie estimée, les autres maladies du patient, le risque d’un
cancer évolutif ainsi que les effets indé sirables de chaque
intervention comptent parmi les facteurs dont il faut tenir
compte dans le processus décisionnel16 (ta bleau IV16). Les
dernières années ont vu émerger la stra tégie de surveil-
lance active d’un cancer de la prostate localisé à faible
risque d’évolution. Il s’agit de reporter le moment du
traitement définitif afin d’éviter les effets néfastes des
interven tions. Cette approche nécessite un suivi attentif
associé à la répé tition des touchers rectaux, du dosage
de l’APS et des biopsies de la prostate (souvent chaque
année). Elle vise à réduire au minimum les traitements
excessifs, sans pour autant compromettre la survie à long
terme. Plusieurs nouveaux tests permettront possible-
ment de mieux distinguer les patients ayant un cancer
plus agressif de ceux où la surveillance active est appro-
priée, notamment les tests de l’oncotype DX spécifique à
la prostate, Prolaris ou PCA3 (surexpression de Prostate
Cancer Antigen 3). Certains patients peuvent ressentir de
l’anxiété en se sachant atteints d’un cancer de la prostate
non traité et décider, après quelques années, de passer au
traitement curatif, soit une intervention chirurgicale ou
la radiothérapie. La surveillance active est différente de
l’observation (watchful waiting), cette dernière consistant
à observer un patient souffrant d’une maladie localisée
asymptomatique qui ne bénéficierait probablement pas
d’un traitement radical, soit en raison d’une espérance de
vie plus courte du patient ou de maladies concomitantes
importantes. Lorsqu’on choisit l’observation, un traitement
palliatif, par exemple à base d’hormonothérapie, est institué
dès qu’une évolution du cancer est notée. Par ailleurs, tant
la prostatectomie radicale que la radiothérapie peuvent
offrir un potentiel curatif, mais ont des effets indésirables
qui leur sont propres. La décision thérapeutique découle
évidemment d’un consentement libre et éclairé après dis-
cussion, avec le patient, des avantages et inconvénients de
chaque stratégie. La découverte d’un cancer incurable au
moment du dépistage représente malheureusement l’échec
de cette stratégie à prévenir la mortalité attribuable à cette
maladie. Le diagnostic par le dépistage plutôt qu’à l’appari-
tion de symptômes est toutefois certainement avantageux
en ce qui a trait à la morbidité attribuable au cancer. De
plus, grâce aux progrès des dernières années dans le trai-
tement du cancer de la prostate métastatique, la qualité de
vie autant que la survie des patients se trouvent améliorées.
CONCLUSION
Bien que les études actuelles ne montrent probablement
pas suffisamment d’avantages à instaurer un processus de
dépistage systématique dans la population, comme celui
qui existe pour le cancer du sein, les données probantes
penchent tout de même pour un dépistage personnalisé
après consentement éclairé. Malheureusement, au Qué-
bec, beaucoup d’hommes n’ont pas accès à un médecin
de famille de façon régulière ou ne font affaire qu’avec un
service de consultation sans rendez-vous. Les patients
les plus en forme et possiblement les plus susceptibles
de bénéficier d’un dépistage risquent ainsi d’échapper à
un diagnostic au moment opportun alors qu’un dépistage
systématique aurait pu les rejoindre.
RETOUR AU CAS DE MONSIEUR P.
Après vos explications judicieuses et un toucher rectal
normal, Monsieur Provencher a pris le temps de réfléchir.
À la visite subséquente, il opte pour le dosage sanguin de
l’APS. Son résultat étant de 4,8 ng/ml, vous le dirigez en
urologie pour une évaluation clinique plus approfondie. //
Date de réception : le 30 mai 2014
Date d’acceptation : le 13 juin 2014
La Dre Catherine Sperlich et le Dr Trung Nghia Nguyen n’ont signalé
aucun intérêt conflictuel
BIBLIOGRAPHIE
1. Moyer VA, U.S. Preventive Services Task Force. Screening for prostate cancer:
US Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Inter
Med 2012 ; 157 (2) : 120-34.
2. Collège des médecins du Québec. Le dépistage du cancer de la prostate –
Mise à jour 2013. Lignes directrices du Collège des médecins du Québec.
Montréal : Le Collège ; 2013. Site Internet : www.cmq.org/fr/Public/Profil/
Commun/Nouvelles/2013/~/media/Files/Lignes/Lignes-depistage-can-
cer-prostate-2013.pdf?51429 (Date de consultation : le 29 mai 2014).
3. Mottet N, Bastian PJ, Bellmunt J et coll. Guidelines on Prostate Cancer. Euro-
pean Association of Urology. Arnhem : L'Association ; 2014. Site Internet :
www.uroweb.org/gls/pdf/09%20Prostate%20Cancer_LRLV2.pdf (Date de
consultation : le 29 mai 2014).
4. Horwich A, Hugosson J, de Reijke T et coll. Prostate cancer: ESMO Consensus
Conference Guidelines 2012. Ann Oncol 2013 ; 24 (5) : 1141-62.
POUR EN SAVOIR PLUS...
h Cossette J. Dépister ou ne pas dépister, voici la réponse – Le point de vue de l’urologue. Le Médecin du Québec 2011 ; 46 (6 ) : 55-9.
h L’Abbé D. L’APS... judicieusement et avec doigté – Le point de vue de l’omnipraticien. Le Médecin du Québec 2011 ; 46 (6 ) : 47-52.
36
Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 11, novembre 2014

//
FORMATION CONTINUE
5. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et coll. Screening and prostate-cancer
mortality in a randomized European Study. N Engl J Med 2009 ; 360 (13) :
1320-8.
6. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et coll. Prostate-cancer mortality at
11 years of follow-up. N Engl J Med 2012 ; 366 (11) : 981-90.
7. Hugosson J, Carlsson S, Aus G et coll. Mortality results from the Göteborg
randomised population-based prostate-cancer screening trial. Lancet On-
col 2010 ; 11 (8) : 725-32.
8. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL III et coll. Mortality results from a rando-
mized prostate-cancer screening trial. N Engl J Med 2009 ; 360 (13) : 1310-9.
9. Wever EM, Hugosson J, Heijnsdijk EA et coll. To be screened or not to be
screened? Modeling the consequences of PSA screening for the individual.
Br J Cancer 2012 ; 107 (5) : 778-84.
10. Lilja H, Cronin AM, Dahlin A et coll. Prediction of significant prostate cancer
diagnosed 20 to 30 years later with a single measure of prostate-specific
antigen at or before age 50. Cancer 2011 ; 117 (6) : 1210-9.
11. Collège des médecins du Québec. Le dépistage du cancer de la prostate :
une décision qui vous appartient ! Montréal : Le Collège ; 2013. Site Inter-
net : www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/Nouvelles/2013/~/media/Files/
Depliants/Depliant-depistage-cancer-prostate-2013.pdf?51429 (Date de
consultation : le 29 mai 2014).
12. Gonzalez CM, Averch T, Boyd LA et coll. AUA/SUNA white paper on the inci-
dence, prevention and treatment of complications related to prostate needle
biopsy. Linthiaum : American Urological Association ; 2012. Site Internet :
www.auanet.org/common/pdf/practices-resources/quality/patient_safety/
AUA-SUNA-PNBWhitePaper.pdf (Date de consultation : le 11 août 2014).
13. Rosario EJ, Lane JA, Metcalfe C et coll. Short term outcomes of prostate
biopsy in men tested for cancer by prostate specific antigen: prospective
evaluation within ProtecT study. BMJ 2012 ; 344 : d7894.
14. Nam RK, Saskin R, Lee Y et coll. Increasing hospital admission rates for
urological complications after transrectal ultrasound guided prostate biopsy.
J Urol 2010 ; 183 (3) : 963-8.
15. Hoffman RM. Screening for Prostate Cancer. UpToDate 2014. Site Internet :
www.uptodate.com (Date de consultation : le 11 août 2014).
16. Nelson JB. Observation for clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol
2014 ; 32 (13) : 1295-8.
SUMMARY
Prostate Cancer Screening: Still Worthwhile? Regulatory
agencies have questioned the benefits of widespread
screening for prostate cancer and have recommended
against screening programs in favour of screening only
after patient counselling. Given that there are concerns
about the overdiagnosis and overtreatment of this cancer,
it is recommended to screen at-risk individuals for prostate
cancer until the age of 70 years, including men with a family
history, BRCA mutation carriers, black men, and men without
serious chronic conditions or a life expectancy of less than
ten years. Studies have shown a reduction in prostate
cancer-specific mortality on the order of 21% to 44%, but no
survival gain. The screening tests recommended are a rectal
examination of the prostate and measurement of PSA in the
blood. If these are positive, the patient will be referred to a
urologist for prostate biopsy and further testing. Prostate
cancers diagnosed through screening will likely be of a lower
grade. After evaluation of comorbidities, the Gleason score
on biopsy and patient choice, treatment options will
include observation, watchful waiting, radiotherapy or
radical prostatectomy.
37
lemedecinduquebec.org
1
/
5
100%