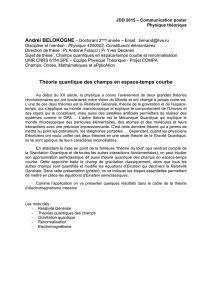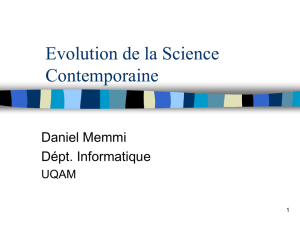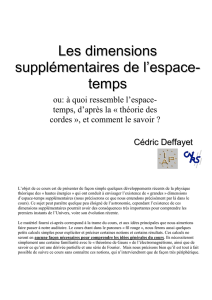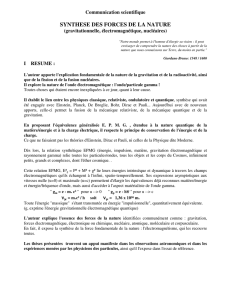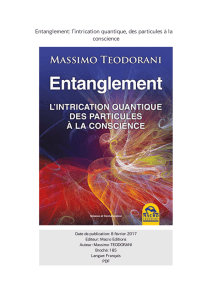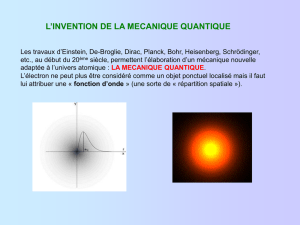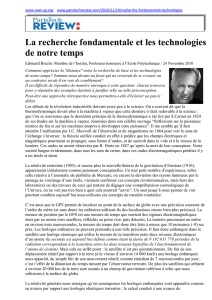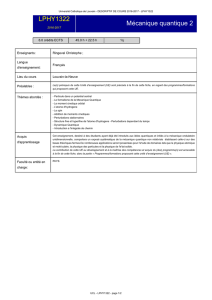Multiplier les théories… raisonnablement

du e siècle
78 • La Recherche
|
JUILLET-AOÛT 2012 •
Nº 466
dossier
Il est toujours hasardeux – voire
dangereux – de tenter de tirer les
conclusions ou les leçons d’une
histoire qui n’est pas achevée. Or,
l’histoire de la physique du « XXe
siècle » n’est évidemment pas terminée.
Entendons par là l’histoire de la méca-
nique quantique, et de ses ramifications
vers la physique des particules élémen-
taires d’une part, et celle de la relativité
générale, et de ses ramifications vers la
cosmologie, d’autre part. Les immenses
questions soulevées par ces nouvelles
Quelles leçons tirer des avancées en
physique de ces dernières années ? La réalité
expérimentale qui s’impose à nous, parfois
brutalement, invite à réfléchir à la pluralité
des voies explorées.
PAR Aurélien Barrau, professeur
à l’université Joseph-Fourier, chercheur au
laboratoire de physique subatomique et
cosmologie de Grenoble du CNRS, membre
de l’Institut universitaire de France.
Multiplier les théories…
raisonnablement
voies d’investigation sont, en grande
partie, toujours ouvertes. Certes, des
résultats décisifs devraient être obte-
nus dans les années à venir, mais faut-il
attendre un dénouement ultime pour
tenter d’y voir plus clair ?
Rapport à la diversité. Ce serait sans
doute doublement regrettable : d’abord
parce qu’une telle issue est vraisembla-
blement lointaine, à supposer qu’elle
se produise, et, surtout, parce que la
science acquise et admise – comme
ossifiée – n’est déjà plus réellement de
la science en tant que pensée du doute
et de la déconstruction. Il est donc rai-
sonnable de s’interroger sur les leçons
des découvertes et errances de ces der-
nières années. Et ce, me semble-t-il,
tout spécialement du point de vue du
rapport que la physique entretient avec
diérentes formes de diversité.

Nº 466
• JUILLET-AOÛT 2012
|
La Recherche • 79
Multiplier les théories…
raisonnablement
> LE CONSTAT
Avec le recul, on peut s’étonner
de l’entêtement à concentrer la
majorité des recherches dans une
voie unique.
> LA RECOMMANDATION
Plaider pour une plus grande
et plus profonde diversité des
pistes d’investigation.
> LA MISE EN GARDE
La diversité a aussi des effets
pervers, dont il faut se méfier.
Il est presque inévitable de plaider
aujourd’hui pour une plus grande et
plus profonde diversité de chemins sui-
vis. Prenons deux exemples. D’abord, le
plus incontournable, celui de la supersy-
métrie dans le domaine de la physique
de l’infiniment petit. Il s’agit d’une élé-
gante hypothèse suivant laquelle tou-
tes les particules connues auraient un
« partenaire » non encore découvert. Elle
permettrait de résoudre beaucoup de dif-
ficultés du « modèle standard » de la phy-
sique des particules et apparaît légitime-
ment comme une extension naturelle de
ce dernier. Ses avantages sont non seule-
ment techniques mais aussi esthétiques.
Sans même mentionner qu’elle offre
l’une des seules explications sérieuses à
l’énigme de la matière noire dans l’Uni-
vers. Il était évidemment nécessaire de
sonder cette piste. Elle a suscité – à juste
titre – des eorts considérables de façon
presque monopolistique depuis plus de
trente ans. Ces eorts ont été nécessaires
pour bien comprendre les méandres de
cette théorie complexe. Ils ne furent pas
vains. Néanmoins, il semble que les résul-
tats actuels du LHC ne corroborent pas
cette théorie. Aucune trace, à ce jour, de
particule supersymétrique. Bien évidem-
ment, la théorie n’est pas encore réfutée
et, même à l’issue du programme LHC,
elle ne saurait l’être tout à fait. Mais elle
est susamment en diculté pour que
la question se pose : « Et si la supersymé-
trie n’était pas correcte ? » C’est une éven-
tualité qu’il n’est plus possible d’ignorer.
Les jeunes physiciens s’étaient habitués
à ce que l’assentiment de leurs pairs soit
le seul critère d’évaluation d’une pos-
ture scientifique. Cette réalité expéri-
mentale qui s’impose aujourd’hui, pres-
que avec violence, n’était plus dans les
mœurs de la physique des hautes éner-
gies. Quelles leçons en tirer aujourd’hui ?
Sans doute un certain étonnement face
à l’entêtement avec lequel une voie uni-
que a condensé l’immense majorité des
recherches en physique « au-delà du
modèle standard ». Nous disposons de
peu d’hypothèses alternatives à la super-
symétrie. Et pourtant, le modèle standard
est incomplet. N’eût-il pas été sain d’en-
courager quelques autres pistes promet-
teuses ? A-t-il été vraiment judicieux de
mener autant d’analyses extrêmement
détaillées sur le potentiel scientifique des
futures expériences dans le seul cadre
du MSSM (Modèle SuperSymétrique
Minimal), balayé en quelques mois de
fonctionnement du LHC ? Quand bien
même la supersymétrie se révélerait in
fine exacte, n’eût-il pas été sage de ne pas
y investir tous nos eorts ?
Gravitation quantique. Un deuxième
exemple appelle le même type de
réflexion : les recherches en gravitation
quantique, même si dans ce domaine
les tests expérimentaux ne sont pas
encore d’actualité. Graal de la physique
théorique, la gravitation quantique est
un cadre permettant de concilier les
grands principes de la physique d’Eins-
tein, d’une part, et de ceux de la physique
de Heisenberg et de Schrödinger, d’autre
part. Depuis plusieurs décennies la théo-
rie des cordes, qui tente d’unifier toutes
les particules et interactions fondamen-
tales en les décrivant comme diérents
modes de vibration de petite cordes élé-
mentaires, concentre la grande majorité
des eorts dans la discipline. C’est, là
encore, un pari tout à fait raisonnable.
Pourtant, et sans que cela ôte quoi
que ce soit à sa crédibilité et à son élé-
gance, aucune indication expérimentale
ne plaide aujourd’hui en faveur de cette
théorie. Il semblerait donc essentiel, en
ce domaine également, de diversifier les
tentatives. La communauté scientifique
semble l’avoir compris – au moins en
France : la gravitation quantique à bou-
cles, par exemple, connaît aujourd’hui
un essor fulgurant. Elle consiste à réin-
terpréter la structure même de l’espace
en combinant les leçons de la relativité
générale et de la physique quantique.
Seuil critique. Mais ces études sont
d’une immense difficulté, technique
comme conceptuelle, et il existe un
« seuil critique » en dessous duquel une
communauté scientifique ne peut pas
être crédible et performante. Si la gravi-
tation quantique à boucles a enfin, et fort
heureusement, passé ce seuil en France,
il n’en est pas de même pour d’autres
approches également prometteuses…
Ne faudrait-il pas envisager, là aussi,
« L’Univers de particules », une
exposition interactive permanente
du CERN, présente au grand public
les avancées et enjeux de la
physique contemporaine.
© MICHAEL JUNGBLUT/ 2010 CERN
>>>

du e siècle
80 • La Recherche
|
JUILLET-AOÛT 2012 •
Nº 466
dossierdossier
© P. CARRIL/ NOVAPIX
Multiplier les théories…
raisonnablement
la possibilité de l’échec avec un peu
plus de conviction ? Peut-on se permet-
tre de voir travailler l’essentiel des phy-
siciens théoriciens du monde entier,
depuis si longtemps, sur si peu de modè-
les si spéculatifs ?
En contrepoint de ce plaidoyer pour
une plus grande diversité des voies d’in-
vestigations, trois arguments doivent
tempérer tout excès en ce sens. Le pre-
mier tient au coût considérable du déve-
loppement d’un modèle sérieux : des
dizaines de chercheurs à plein temps,
au moins, pendant plusieurs décennies.
Il n’est tout simplement pas matérielle-
ment possible d’étudier toutes les idées
a priori intéressantes.
Manque d’idées. Le deuxième est lié
à ce qu’il ne sut pas d’invoquer la mul-
tiplicité pour qu’elle surgisse ! Prenons
l’exemple de la matière noire* de l’Uni-
vers. Il serait extrêmement souhaitable,
tout le monde en convient, de disposer de
nombreux modèles alternatifs pour l’ex-
pliquer. Et ce n’est pas l’institution scien-
tifique qui freine de tels développements.
Le fait est que ce sont ici les idées crédibles
et convaincantes qui font défaut ! Ce n’est
pas un simple problème de politique, c’est
un problème de physique…
Le troisième est lié aux eets parfois
pervers de la diversité. Considérons l’ac-
célération de l’expansion cosmologique.
Magnifique exemple d’une profusion
presque illimitée de modèles. Les théo-
ries tentant d’expliquer cette observation
sont quasiment aussi nombreuses que
les physiciens travaillant sur le sujet. Au
point qu’il est dicile de les classer et de
comprendre véritablement leurs fonde-
ments physiques. Pourtant, une simple
constante cosmologique, prédite par la
théorie de la relativité générale,
permet d’expliquer simplement
ce phénomène. Disposer d’ex-
plications de remplacement est
évidemment intéressant, mais
faut-il à ce point s’acharner à éla-
borer des modèles extrêmement
complexes – et parfois bancals –
alors même que le paradigme
dominant s’accommode de l’ob-
servation ? Ne faut-il pas aussi se
méfier de l’attrait vertigineux de
la diversité ?
Derrière ces remarques se cachent
sans doute quelques interrogations plus
fondamentales encore sur la nature de
la physique et sur ce que l’on en attend.
En particulier, la question d’une théorie
ultime* se pose généralement quant à
la forme que celle-ci devrait revêtir. Ou
éventuellement quant à la distance qui
nous en sépare. Mais elle aborde rare-
ment la dimension cruciale de la pos-
sibilité même de son existence. Est-il
aujourd’hui incontestable qu’une telle
théorie doive exister et qu’elle doive être
unique ? Ne peut-on pas concevoir une
description du réel intrinsèquement plu-
rielle ? Et ce, au sein du mode physico-
mathématique qui nous intéresse ici.
Des astuces adaptées. Il est tout à fait
évident que toutes les propositions ne se
valent pas. L’immense majorité des idées
saugrenues est bien évidemment indé-
fendable et très aisément réfutable. Cela
ne fait aucun doute. Mais il est aussi légi-
time de se demander si certains modè-
les ingénieux ne deviendraient pas très
certainement des branches de physique
respectables si susamment d’eorts
et de moyens leur étaient consacrés. La
vision simpliste d’une science fonction-
nant par élimination méthodique des
propositions réfutées, sur le modèle du
philosophe des sciences Karl Popper, ne
me semble bien évidemment pas cor-
recte. Les modèles de gravitation quan-
tique notamment font souvent des pré-
dictions incompatibles avec le monde réel
(l’existence de 9 dimensions spatiales en
théorie des cordes en est une). Ces incom-
patibilités peuvent parfois être dépassées
par des astuces adaptées (par exemple
en supposant que ces dimensions exis-
tent mais sont très petites). Ces astuces
demandent parfois beaucoup d’ingénio-
sité et, une fois trouvées, elles deviennent
bien davantage que de simples tours de
passe-passe. Mais elles témoignent d’une
intrication entre le monde et les théories
beaucoup plus complexe et subtile que
ce qu’on pourrait être tenté de supposer.
N’est-il pas envisageable que des eorts
susants investis dans le développement
d’un modèle, dont la base est raisonnable,
parviennent à le rendre viable ? Au prix,
parfois, d’un changement de prisme sur le
réel. Bien sur, certains modèles pourront
conduire à des prédictions diérentes et
être ultérieurement départagés. Mais
n’en va-t-il pas de l’essence même de la
physique que de disposer de plusieurs
modèles diérents, non encore disqua-
lifiés, à un instant donné de son histoire ?
Et, parce qu’aucun modèle n’est éternel,
n’est-il pas ontologiquement sensé de
les considérer comme simultanément
justes ? Une nouvelle voie de pensée, qui
serait un pluralisme sans laxisme et sans
nihilisme, s’entrouvre peut-être. Elle reste
en grande partie à inventer.
n
>>>
Pour en savoir plus
>Aurélien Barrau et Jean-Luc Nancy, Dans quels
mondes vivons-nous ?, Galilée, 2011.
>Carlo Rovelli, Et si le temps n’existait pas ?,
Dunod, 2012.
*
représente
l’essentiel de la matière de l’Univers mais elle
est invisible et sa nature reste inconnue.
*
serait capable
d’unifier toutes les particules et toutes les
interactions.
Les prédictions des théories de
gravitation quantique, comme la théorie
des cordes ici vue par un artiste, sont
souvent incompatibles avec la réalité.
Faut-il pour autant réfuter ces théories ?
1
/
3
100%